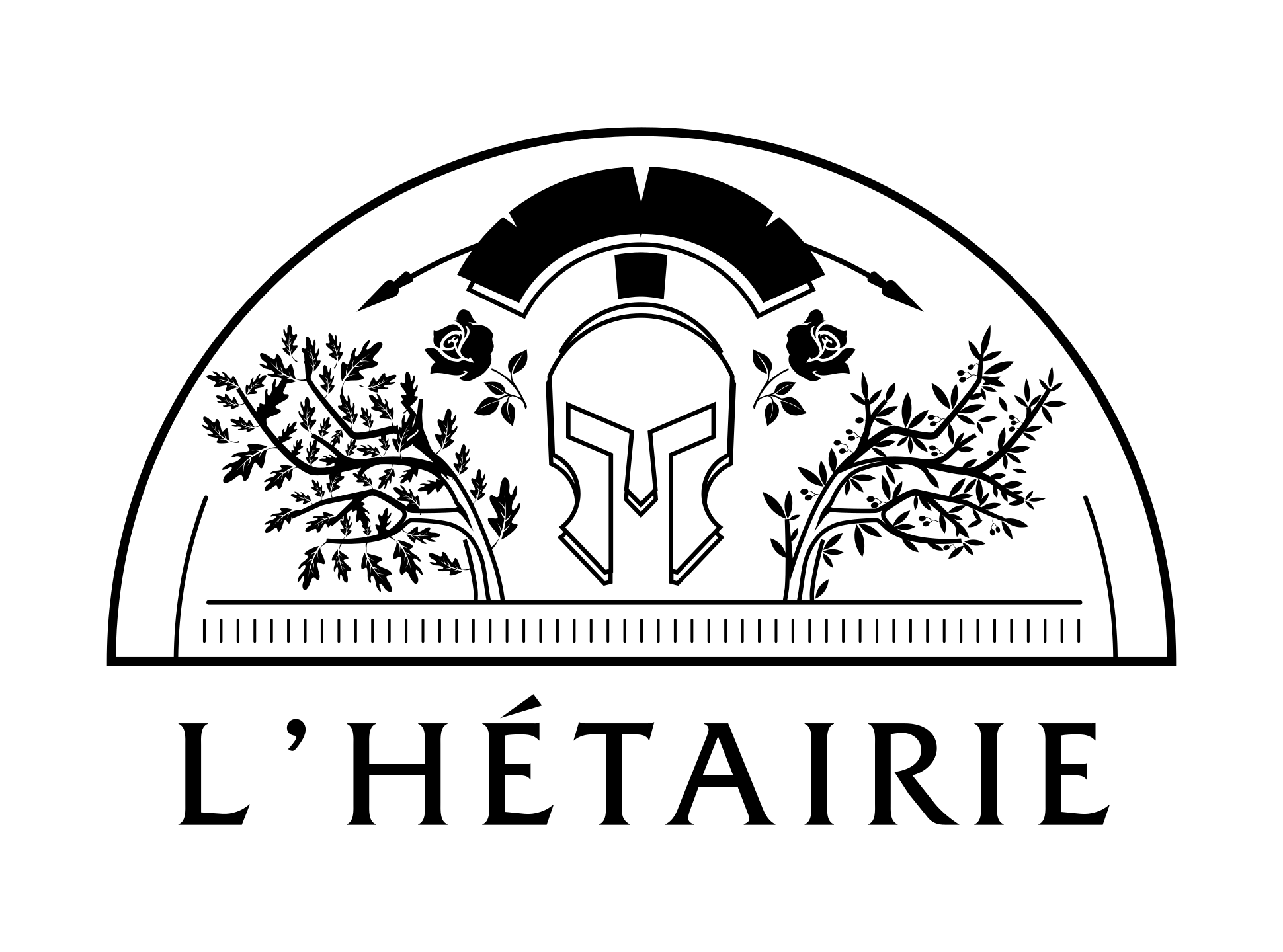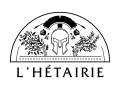Londres-Washington: la relation est-elle toujours spéciale ? [Tribune #44]
Lors d’une conférence de presse donnée le 3 mai dernier conjointement avec son homologue britannique, le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, déclarait que les États-Unis n’avaient ni allié, ni partenaire plus proche que le Royaume-Uni. Il s’agissait, à l’occasion de la rencontre préparatoire des ministres des Affaires étrangères des pays du G7, de réaffirmer les liens intimes unissant Londres et Washington par-delà les aléas de l’histoire et les accidents de l’alternance.
Les recompositions de l’exécutif américain depuis l’arrivée aux affaires de l’administration Biden et la redéfinition post-Brexit de la place de Londres dans le monde posent en effet la question de la résilience de cette communauté de destin transatlantique. L’histoire des « relations spéciales » témoigne de leur opportunisme réciproque.
Back to basics : origines d’une expression et d’une diplomatie
En convoquant les mânes de Winston Churchill, le secrétaire Blinken aura sans doute plu à l’actuel Premier ministre britannique, Boris Johnson, dont on connaît la passion pour celui à qui il a consacré un essai biographique remarqué [1]Boris JOHNSON, The Churchill Factor: How One Man Made History, Londres, Hodder & Stoughton, 2014.. En effet, l’emblématique Premier ministre avait évoqué cette « relation spéciale » entre les deux pays à l’occasion d’un discours prononcé en 1946 au Westminster College de Fulton (Missouri) devant le président Truman. Le propos avait pourtant été accueilli avec tiédeur à Washington. Londres, en revanche, entendait fonder une « tradition anglo-américaine » [2]Arnold WOLFERS et Laurence W. MARTIN, The Anglo-American Tradition in foreign affairs, New Haven, Conn., Yale University Press, 1956. en politique étrangère face au déclin sanctionné de la puissance britannique [3]Correlli BARNETT, The collapse of British power, Londres, Eyre Methuen, 1972..
Depuis, les historiens se divisent en trois approche pour définir la réalité de cette relation [4]Alex DANCHEV, “The Cold War ‘Special Relationship’ Revisited”, Diplomacy and Statecraft, 2006, 17, p. 579-595. :
- Selon les « évangélistes », la « relation spéciale » s’enracine dans une philosophie politique et culturelle partagée qui doit déterminer le fonctionnement des relations internationales [5]Harry Cranbrook ALLEN, Great Britain and the United States: A History of Anglo-American Relations (1783–1952), Londres, Oldhams Press, 1954..
- Selon les « fonctionnalistes », tenant d’une interprétation réaliste des relations internationales, la « relation spéciale » repose davantage sur la défense des intérêts nationaux, expliquant la priorité portée à l’approfondissement des échanges dans les domaines du renseignement, de la défense et du nucléaire [6]William ROGER LOUIS et Hedley BULL (dir.), The special relationship: Anglo-American relations since 1945, Oxford, Clarendon Press, 1989..
- Selon les « terminalistes », enfin, les préoccupations sécuritaires communes au binôme américain et britannique ont souffert de la fin de la Guerre froide et de la rétractation de la puissance britannique [7]John DICKIE, “Special” No More: Anglo-American Relations: Rhetoric and Reality, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1994.. Les compromissions récentes des deux alliés au Moyen-Orient ont ainsi conduit certains historiens à faire de la « relation spéciale » le « Lazare des relations internationales » [8]Steve MARSH et John BAYLIS, “The Anglo-American “special relationship”: The Lazarus of international relations”, Diplomacy and Statecraft, 2006, 17, 1, p. 173-211.. Mais certains historiens préfèrent évoquer un « partenariat tendu » [9]Thomas K. ROOB, A strained partnership? US–UK relations in the era of détente, 1969–77, Manchester, Manchester University Press 2014. ; car même la correspondance d’intérêts stratégiques dans un contexte de Guerre froide n’empêche pas l’expression de rivalités de puissances à l’échelle régionale, comme le montrent les exemples du Moyen-Orient [10]James BARR, Lords of the Desert: Britain’s Struggle with America to dominate the Middle East, Londres, Simon & Schuster, 2018. et du golfe Persique [11]Tore T. PETERSEN, Anglo-American Policy toward the Persian Gulf, 1978-1985: Power, Influence and Restraint, Eastbourne, Sussex Academic Press, 2015., qui résonnent encore aujourd’hui.
Back to normalcy : une relation en résurgence après Trump ?
Toute rhétorique que soit cette résurgence par Blinken des fondamentaux de la relation bilatérale, celle-ci a été saluée par la presse outre-Manche, qui s’était souvent émue du comportement erratique et de la diplomatie disruptive de l’ancien locataire de la Maison Blanche. Les relations transatlantiques ont en effet fini par être rangées au rang des « dommages collatéraux » des années Trump. L’ancien ambassadeur britannique à Washington, Kim Darroch, a laissé dans ses mémoires une photographie préoccupée de l’état d’esprit partisan et tribal prévalant dans les deux pays durant son exercice [12]Kim DARROCH, Collateral Damage: Britain, America and Europe in the Age of Trump, Londres, Williams Collins, 2020.. Malgré le soutien de Theresa May, Darroch avait été contraint à la démission après la publication par la presse de câbles diplomatiques dépeignant le président comme instable et incompétent.
L’arrivée de Boris Johnson à Downing Street semblait à même de réchauffer les liens entre Londres et Washington. Dès le mois de juin, le président Trump se réjouissait de la perspective du départ de Theresa May et exprimait sa conviction que son successeur désigné ferait « un très bon travail. » Mais la sympathie de façade n’a pas résisté à l’épreuve des faits. Le « fantastique accord de libre-échange » promis par l’administration Trump pour accompagner le Brexit n’a finalement pas vu le jour. Par ailleurs, les positionnements du président américain sur les grandes questions internationales, comme la dénonciation du compromis de Vienne de 2015 sur la nucléarisation de la République islamique d’Iran, ont montré des désaccords de principes confirmant la vanité de la « relation spéciale » invoquée.
Back to business : quelles perspectives pour cette relation ?
La perspective d’une arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche a suscité une certaine inquiétude dans les rangs du parti conservateur britannique. Elle aura eu le mérite de catalyser une prise de conscience de la nécessité à restaurer les conditions d’une relation plus constructive. L’entreprise était d’autant plus impérative que l’inclination réciproque entre les deux dirigeants n’allait pas de soi. Lors d’une levée de fond en amont de la campagne présidentielle américaine, le candidat à l’investiture démocrate avait ainsi taxé le Premier ministre britannique de « clone physique et émotionnel du président Trump. »
La question du Brexit risque d’être une pierre d’achoppement de la restauration de la « relation spéciale », à moins qu’elle ne permette d’en mesurer la résilience. Le président Biden, descendant d’immigrés irlandais, sera très attentif aux conséquences économiques et sociales du Brexit sur sa patrie d’origine. La menace agitée par Johnson d’enfreindre le droit international pour éviter les contrôles douaniers entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord avait suscité bien des remous de part et d’autre de la Manche et de l’Atlantique. Le secrétaire Blinken n’a d’ailleurs pas omis de mentionner la question nord-irlandaise à l’issue de sa rencontre avec son homologue britannique.
De surcroît, au-delà de la rhétorique, le secrétaire d’État américain n’a pas fait une priorité de la « relation spéciale ». On le présente d’ailleurs surtout comme francophone, sinon francophile. La revitalisation des alliances et des partenariats des États-Unis à travers le monde témoigne des priorités stratégiques de l’administration Biden : le Royaume-Uni n’est que le cinquième pays qu’il a visité, après le Japon, la Corée du Sud, la Belgique et l’Afghanistan ; et la cartographie de ses déplacements confirme le « pivot » américain vers l’Asie ainsi que la volonté de rassurer ses partenaires quant à l’engagement américain dans l’Alliance atlantique. Or, il paraît évident que le Royaume-Uni détaché de l’Union européenne aura perdu de sa valeur stratégique pour des États-Unis ne pouvant plus l’utiliser comme une « mule de Troie » permettant leur entrisme sur le vieux continent [13]Keith DIXON, La Mule de Troie : Blair, l’Europe et le nouvel ordre américain, Broissieux, Edition du Croquant, 2003..
En parallèle, la Revue intégrée de sécurité, de défense, de développement et de politique étrangère publiée par le gouvernement Johnson au mois de mars afin de donner une feuille de route aux ambitions de « Global Britain », témoigne de priorités que l’agenda du sommet du G7 confirme : la protection de l’environnement, la stratégie à adopter face à la Chine, la gestion de la crise sanitaire. Elle consacre une réorientation stratégique vers la zone indo-pacifique qui entend ainsi accompagner en synergie le pivot des États-Unis vers l’Asie. L’allié américain est d’ailleurs toujours présenté comme le plus important partenaire stratégique Grande-Bretagne post-Brexit. En revanche, la France est davantage mentionnée par la Revue que les États-Unis. Car, loin de renoncer à ses anciens partenaires continentaux, Londres prévoit en effet de poursuivre avec eux un dialogue émancipé des contraintes communautaires dans le cadre de relations bilatérales ou de coalitions ad hoc, en particulier le format E3 avec l’Allemagne et la France. Enfin, selon l’un de ses proches collaborateurs, Johnson aurait pourtant déclaré au président lors d’un entretien téléphonique qu’il n’aimait pas l’expression de relation spéciale qui ferait apparaître le Royaume-Uni comme faible et nécessiteux. « L’Amérique de retour » devra donc compter avec une « Grande-Bretagne aux horizons mondiaux », pour peu qu’elle se donne les moyens de ses ambitions. Avant le grand échiquier indo-pacifique, les modalités de négociation d’un accord de libre-échange entre Londres et Washington constitueront un étalon instructif du rapport de force.
Notes
| ↑1 | Boris JOHNSON, The Churchill Factor: How One Man Made History, Londres, Hodder & Stoughton, 2014. |
| ↑2 | Arnold WOLFERS et Laurence W. MARTIN, The Anglo-American Tradition in foreign affairs, New Haven, Conn., Yale University Press, 1956. |
| ↑3 | Correlli BARNETT, The collapse of British power, Londres, Eyre Methuen, 1972. |
| ↑4 | Alex DANCHEV, “The Cold War ‘Special Relationship’ Revisited”, Diplomacy and Statecraft, 2006, 17, p. 579-595. |
| ↑5 | Harry Cranbrook ALLEN, Great Britain and the United States: A History of Anglo-American Relations (1783–1952), Londres, Oldhams Press, 1954. |
| ↑6 | William ROGER LOUIS et Hedley BULL (dir.), The special relationship: Anglo-American relations since 1945, Oxford, Clarendon Press, 1989. |
| ↑7 | John DICKIE, “Special” No More: Anglo-American Relations: Rhetoric and Reality, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1994. |
| ↑8 | Steve MARSH et John BAYLIS, “The Anglo-American “special relationship”: The Lazarus of international relations”, Diplomacy and Statecraft, 2006, 17, 1, p. 173-211. |
| ↑9 | Thomas K. ROOB, A strained partnership? US–UK relations in the era of détente, 1969–77, Manchester, Manchester University Press 2014. |
| ↑10 | James BARR, Lords of the Desert: Britain’s Struggle with America to dominate the Middle East, Londres, Simon & Schuster, 2018. |
| ↑11 | Tore T. PETERSEN, Anglo-American Policy toward the Persian Gulf, 1978-1985: Power, Influence and Restraint, Eastbourne, Sussex Academic Press, 2015. |
| ↑12 | Kim DARROCH, Collateral Damage: Britain, America and Europe in the Age of Trump, Londres, Williams Collins, 2020. |
| ↑13 | Keith DIXON, La Mule de Troie : Blair, l’Europe et le nouvel ordre américain, Broissieux, Edition du Croquant, 2003. |