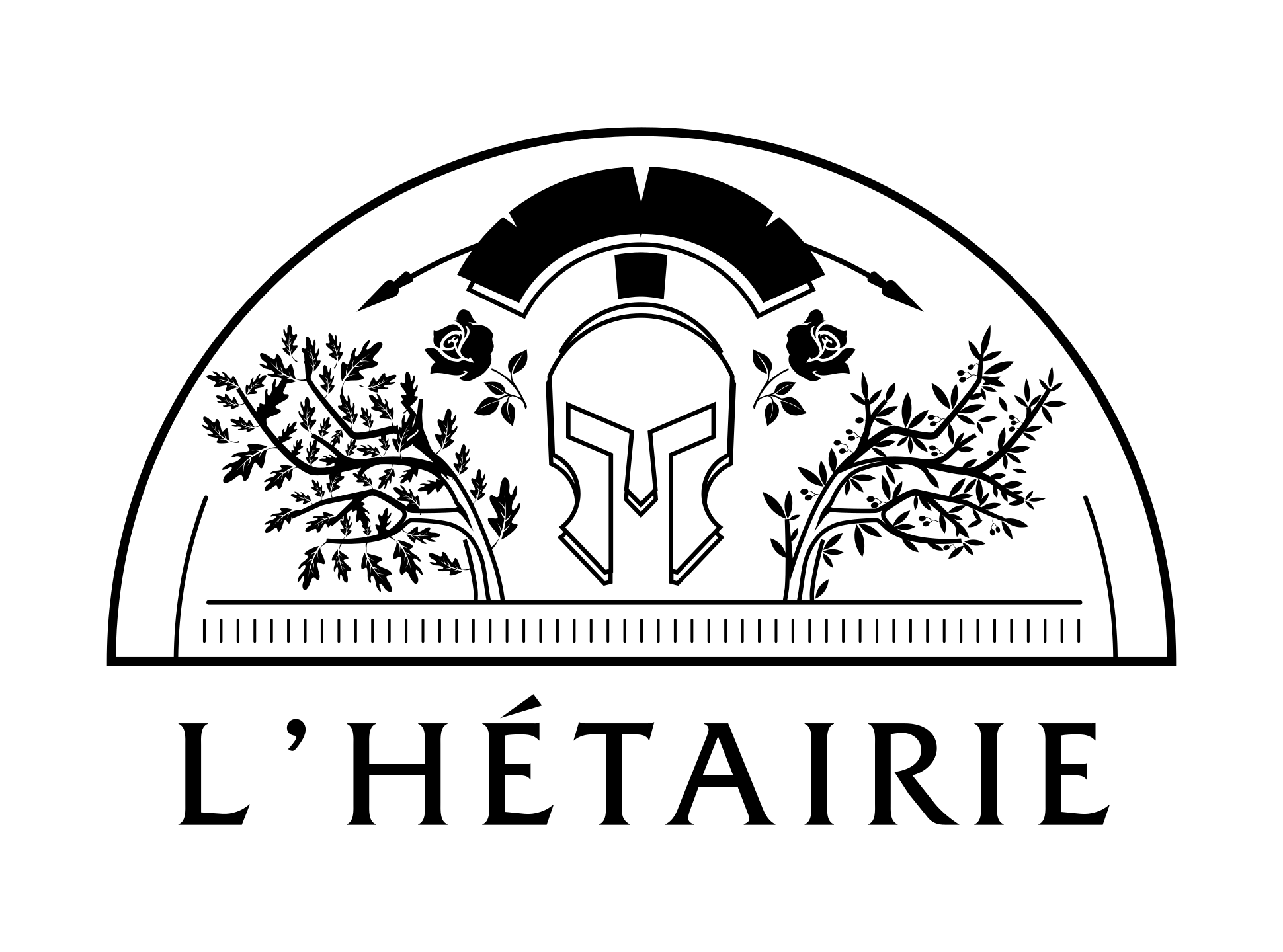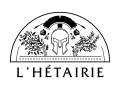Dépénaliser l’usage du cannabis : nouvelle stratégie ou renoncement ? [Note #11]
A nos lecteurs
Comme de coutume désormais, L’Hétairie souhaite nourrir le débat d’idées en publiant des contributions de sensibilités très différentes sur la même thématique.
C’est le cas de la présente note qui aborde le sujet, toujours polémique, de la consommation de produits stupéfiants. Elle sera suivie par une série de publications sur le même objet permettant de présenter les différentes nuances qui existent en ce domaine. Car une politique publique ne saurait être définie et mise en œuvre dans l’ignorance des opinions divergentes.
L’idée d’une forme de dépénalisation de l’usage du cannabis n’est évidemment pas nouvelle, mais les apparitions récurrentes de ce serpent de mer n’ont pas toujours obéi aux mêmes causes. Aujourd’hui, curieusement, sa sortie du flot des débats semble plus que jamais l’approcher d’une issue palpable alors même que l’idéologie libertaire, ou du moins permissive, sur l’usage des « drogues douces » ne se fait plus guère entendre.
Il est vrai que le consensus général s’est formé autour de l’idée qu’il n’y a pas de drogues « douces » et, en dépit des occasionnels usages thérapeutiques parfois laissés au cannabis ou à ses dérivés, la grande majorité des responsables publics est convaincue des ravages sociaux et sanitaires que génèrent ces substances ainsi que des indéniables conséquences en matière de sécurité.
Pourtant, il ne faudrait pas penser que les courants favorables à une légalisation du cannabis aient dételé ; simplement, il est des situations où il vaut mieux ne pas agiter de chiffon rouge : l’idée d’une contraventionnalisation constituerait déjà pour ces courants un progrès, alors autant ne pas l’entraver.
Car, cette fois-ci, la question de l’usage des produits stupéfiants est revenue dans l’actualité essentiellement sur le terrain pénal, à la faveur – hélas – d’un appareil policier et judiciaire en crise profonde, devenu inopérant et confinant à l’absurde dans bien des domaines, plombé par des contraintes de procédure dont les professionnels s’accordent à dire qu’elles sont souvent disproportionnées par rapport aux fautes poursuivies et aux sanctions prononcées.
Un dispositif répressif tronqué : l’impunité des consommateurs à l’origine d’un cercle vicieux
L’usage de stupéfiants[1] cf. l’article L. 3421-1 du code de la santé publique. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688173 (de même que le transport et la détention liés à l’usage[2] Ainsi que vient de le rappeler la Cour de Cassation (Cass. Crim. 14 mars 2017, n° 16-81805), la détention ne s’envisage en principe qu’indépendamment de l’usage ; elle est … Continue reading) est classé dans la catégorie pénale des délits, passible du tribunal correctionnel au regard des peines encourues (au maximum un an d’emprisonnement et 3750 euros d’amende). L’intérêt de cette classification délictuelle est pluriel :
- permettre un éventail de sanctions plus large (qui peut le plus peut le moins) ;
- marquer l’importance que le corps social attache à la lutte contre le fléau de la toxicomanie ;
- ouvrir des possibilités procédurales (exercice de la contrainte) qui comptent pour beaucoup, tant les moyens de lutte doivent – du moins en théorie – être à la hauteur des ambitions de la lutte contre la toxicomanie et les trafics.
Mais ce dernier point est devenu très relatif car, sous l’influence d’une vision médico-sociale de la toxicomanie qui fait de l’usager un malade (les faits sont d’ailleurs sanctionnés par le Code de la Santé Publique, non par le Code Pénal), la Justice ne condamne quasiment pas le seul usage de stupéfiants, préférant simplement « faire la leçon » (rappel à la loi) ou se replier derrière l’alibi médical (stage de sensibilisation), comme la loi l’y invite[3] cf. l’article 41-1 du Code de procédure pénale. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000029345305. Ainsi, en 2015 sur près de 100.000 usagers de drogues livrés à la justice pénale, 52% environ ont-ils fait l’objet d’une alternative aux poursuites, dont un simple rappel à la loi dans trois cas sur quatre[4] Louise VIARD-GUILLOT, « Le traitement judiciaire des infractions liées aux stupéfiants en 2015 », Infostat Justice, mars 2017, n°150. … Continue reading.
On peut aussi comprendre cette réticence à sanctionner au regard de la nature de l’infraction : l’usager de produits stupéfiants ne crée pas d’autre victime que lui-même, reste en général suffisamment discret pour ne pas troubler l’ordre public, etc.
La Justice se durcit toutefois lorsque la prise de stupéfiants devient dangereuse en se combinant à des actions à risques comme la conduite d’un véhicule : au même titre que pour le conducteur alcoolisé, les sanctions tombent. Mais c’est alors la prise de risque qui est punie plus que l’illicéité du produit consommé.
A ce titre, toujours en 2015, pour un peu plus de 35.500 personnes interpellées pour usage de stupéfiants associé à la conduite d’un véhicule, moins de 2% ont fait l’objet d’une alternative aux poursuites ! 300 seulement ont écopé d’un simple rappel à la loi[5] Ibidem..
Mais ce que l’on comprend moins, c’est que cette réticence à sanctionner ait fait l’économie de la comparaison avec d’autres formes de délinquance, en particulier dans le domaine de la sécurité routière, où l’indulgence est rarement de mise.
En effet, si la sécurité routière, et en son sein la recherche d’une diminution de la mortalité, est à très juste titre une priorité nationale, il faut noter que pour atteindre leurs objectifs, les pouvoirs publics ont depuis plusieurs années conclu qu’une rigueur dans les contrôles et une sévérité dissuasive dans les sanctions étaient les principaux vecteurs de résultats. Certes, d’autres vecteurs y concourent (la prévention, l’information, la communication), mais la conclusion reste qu’on ne progresse réellement en dessous de leur seuil d’efficacité que par une stratégie de contrôle et de répression à même de changer les mentalités et les comportements.
On peut alors s’étonner de ne pas voir la même logique prévaloir en matière de stupéfiants : si la lutte contre la toxicomanie est réellement une priorité, pourquoi toutes les qualifications pénales qui y concourent ne font-elles pas aussi l’objet d’une politique répressive rigoureuse, s’ajoutant aux actions de prévention déjà à l’œuvre (et sans doute à amplifier encore) ?
De même, comment expliquer le paradoxe d’une répression constante et sévère des trafics de stupéfiants, et la relative impunité des consommateurs ? Pour le résoudre, il faudrait considérer – comme ce fut longtemps le cas – que les consommateurs sont victimes des trafiquants. Or tous les produits stupéfiants ne sont pas addictifs au point de rendre le consommateur « esclave » de son dealer. Et ce n’est certainement pas le cas des fumeurs de cannabis qui pourraient parfaitement – sauf exceptions – se dispenser de ce vice.
La toxicodépendance justifie l’approche médicale et le fait que la contrainte judiciaire liée à l’infraction de consommation de stupéfiants s’exerce dans le sens d’une obligation de soins. Mais ce schéma est très loin de correspondre aux consommateurs des multiples variétés de stupéfiants qui sont « sur le marché ».
Dans cette perspective, l’image du toxicomane réduit à la misère par son addiction, pour lequel une peine d’amende n’aurait ni sens ni utilité, est largement erronée. Le profil de l’usager de cannabis, et plus encore pour celui de cocaïne, est souvent suffisamment solvable pour être sensible à la sanction.
En vérité, aucune de ces explications ne justifie si peu de sanctions prononcées à l’encontre des consommateurs de stupéfiants, et notamment le fait qu’ils échappent à toute conséquence pécuniaire.
Un dispositif policier démobilisé… mais consentant
En revanche, on pourrait trouver un début de réponse dans le volume des interpellations réalisées par les services de police et de gendarmerie, lequel irait complètement obstruer un circuit judiciaire déjà très encombré. Des réponses « alternatives » ou en « circuit court » seraient donc préférées par les magistrats qui évitent aussi de cette manière de se retrouver aux prises avec les courants politiques, philosophiques et professionnels tenants d’une approche médico-sociale de la toxicomanie.
Cette observation ne vise pas à critiquer ces derniers, mais seulement à constater lucidement que ces deux voies de traitement (pénale vs médico-sociale), sans être incompatibles, ne font pas vraiment bon ménage. L’idée d’une sanction pénale rigoureuse et dissuasive s’accommode mal de celle de la prise en charge et de l’accompagnement médico-social du toxicomane « malade ».
Côté policier, on n’échappe pas non plus à l’ambigüité. La consommation de stupéfiants est prise très au sérieux car elle est le support des trafics qui eux-mêmes constituent l’essentiel des économies souterraines gangrenant nombre de quartiers populaires où s’installent trop de zones de non-droit.
Mais la réponse pénale n’est pas à la hauteur de ces enjeux, notamment à l’encontre des consommateurs pourtant à l’origine de ce cercle vicieux. Le mécanisme est tellement connu qu’on s’étonne de la relative indifférence de services de police judiciaire.
Au demeurant, la notion de « police judiciaire » recouvre deux réalités très distinctes :
- celle des services de la Sécurité Publique qui vont traiter les consommateurs et les petits trafics, souvent interpellés par les BAC[6] Brigades Anti-Criminalité. ou les groupes d’enquête spécialisés « stups » ;
- celle de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (la « PJ ») qui va traiter les trafics importants[7] Le schéma est un peu différent à la Préfecture de Police et au sein de la Gendarmerie Nationale, mais la distinction y existe aussi..
Les premiers pourraient se désoler de la faiblesse des sanctions qui laisse inéluctablement revenir dans ses filets des usagers multi-réitérants et étend la contagion à des nouvelles proies peu effrayées, mais en pratique ils trouvent dans cette absurdité quelques menus avantages.
- D’abord celui des statistiques : c’est hélas une vérité, ces services appuient leurs résultats « d’initiative » en grande partie sur l’interpellation de consommateurs de stupéfiants, essentiellement de cannabis. Et, quoi qu’on en dise, les « chiffres » dictent toujours leur loi, à défaut d’indicateurs plus « intelligents ». Ainsi, l’usager de produits stupéfiants interpellé constitue-t-il à la fois un « fait constaté » et un « fait élucidé ». Le taux d’élucidation atteint donc les 100%. Dans l’agrégat statistique de la délinquance globale, plus on intègre d’usagers de stupéfiants, plus le taux moyen d’élucidation remonte, pouvant masquer un taux d’élucidation trop faible pour d’autres délits. Bien sûr, dès lors qu’on observe les délinquances par thèmes, ou plus précisément encore par qualifications pénales, cet artifice statistique disparaît. Il reste néanmoins bien utile, et témoigne en outre d’un certain volontarisme des forces de police dans la recherche des délinquants.
- Ensuite la profusion des consommateurs a un effet de révélation des petits et grands trafics destinés à les fournir, ainsi que de toute la délinquance connexe articulée autour de ces trafics (recels, blanchiment, etc.). A titre d’exemple, les petits trafics sont une forme de « passage obligé » pour quantité de délinquants multicartes en voie de « professionnalisation » qui, de ce fait, et compte tenu de modes opératoires bien connus, deviennent plus repérables et identifiables par les services d’enquête. De même, l’identification et l’interpellation de tous ces protagonistes permet aussi d’alimenter divers fichiers, notamment le FAED[8] Ficher Automatisé des Empreintes Digitales., et multiplie d’autant les possibilités de recoupements ultérieurs pour ceux qui se livreraient à d’autres formes de délinquance. Ainsi de façon un peu perverse, grâce à la profusion des consommateurs, ces services peuvent-ils en définitive débusquer et « traiter » de nombreux délinquants émergents et révéler autant d’infractions : détentions d’armes, recels, vols et escroqueries, etc.
Quant à la « PJ », le monde des consommateurs lui est indifférent en termes de répression : il ne sert qu’à la gestion de la preuve contre les trafiquants par le biais des écoutes téléphoniques, des surveillances, photographies, géolocalisations, et autres témoignages confondants. Là encore aucun intérêt n’existe à modifier l’approche « en volume » de cette délinquance sans victimes. Et tant pis si, tels les têtes d’une hydre, les trafics se renouvellent sitôt démantelés et croissent même sous la pression d’une demande que rien ne vient freiner ; l’activité des services de PJ est assurée pour des cycles sans fin.
Ces services ne sont certes pas comptables de la politique pénale aboutissant à la quasi-absence de répression du consommateur de stupéfiants, mais ils s’en sont accommodés sans désir de déplacer le curseur de la réponse sociétale.
En dépit de ces accommodements déraisonnables, c’est bien le problème de la gestion du volume qui mine les forces de sécurité intérieure ; car malgré des procédures au formalisme parfois simplifié que mettent en œuvre les services de police et de gendarmerie « du quotidien » en accord avec les parquets, le temps investi par les unités d’interpellation et/ou d’investigation est devenu trop important[9] La mesure exacte n’en a jamais été prise, mais selon le rapport d’information parlementaire de MM. Poulliat et Reda du 25 janvier 2018 : « La direction centrale de la … Continue reading au regard d’autres délinquances que les contraintes de procédure, cette fois non simplifiées, ne permettent plus de traiter.
Cet alourdissement de la procédure pénale dénoncé par tous les services d’enquête – et syndicats de police – depuis plusieurs années, est notamment lié aux réformes successives du droit de la garde-à-vue. Or, comme prévu et annoncé, les effets négatifs de ces réformes se sont manifestés dans la durée, autant sur le fond (résultats des investigations) que sur la capacité de traitement des services (volume et répartition des faits délinquants auxquels les services sont en mesure de répondre par des investigations). En quelques années, les faibles marges de manœuvre ont été épuisées et dépassées, faisant reculer l’action des services sur nombre d’anciennes « priorités ». Les derniers chiffres 2017 de la délinquance constatée et élucidée le confirment malheureusement.
De fait, la lutte contre les cambriolages – pourtant déclarée prioritaire depuis les années Sarkozy – enregistre cette année encore une hausse de 2% des faits constatés, après une hausse de 4% en 2016. Les escroqueries et infractions assimilées continuent quant à elles de progresser de plus de 5% par an, sur fond de mutation vers de la cyber-délinquance et du détournement de moyens de paiement électroniques[10] Chiffres Ministère de l’Intérieur 2017.. Les taux d’élucidation se maintiennent grâce aux apports des techniques de police scientifique (PTS) croisées avec des fichiers toujours plus étoffés qui amènent des éléments de preuve remplaçant de longues enquêtes « traditionnelles » et il faut s’en féliciter. Mais, a contrario, se développe une part de petite délinquance pour laquelle la PTS ne peut intervenir pour des motifs de temps et de coût, et les enquêteurs n’ont pas de temps à investir. Trop souvent ces faits ne font plus l’objet d’aucune investigation (dégradations, petits vols et escroqueries, etc.).
En outre depuis 2015 la menace terroriste a absorbé une partie des capacités des services et a modifié le classement des priorités, des urgences. Elle a aussi réordonné l’échelle des valeurs : le temps consacré à traquer les fumeurs de cannabis devient injustifiable quand d’autres crimes, délits et menaces à la dangerosité immédiate requièrent la mobilisation des services.
Le contexte est donc aujourd’hui favorable à un changement de paradigme dans la lutte contre l’usage de stupéfiants, dans le sens d’une simplification-accélération du processus policier et judiciaire devant aboutir au traitement et à la sanction de ces faits.
Contraventionnalisation ou amende délictuelle forfaitaire ? Un débat qui relance le doute sur la volonté politique
Les options annoncées sont d’une part la contraventionnalisation, et d’autre part l’amende délictuelle forfaitaire.
La première paraît plus simple dans la gestion de la procédure qui pourrait être réduite à sa plus simple expression, mais elle présente au moins trois inconvénients majeurs :
- En premier lieu en abaissant la gravité apparente des faits (de délit à contravention), elle délivrerait un message permissif qui pourrait toucher une partie des consommateurs actuels et futurs. Consommer des stupéfiants ne serait pas plus grave que de traverser en dehors des clous. La jeunesse pourrait être particulièrement influencée par ce signal. L’interdit étant plus faible, la consommation pourrait se banaliser.
- Ensuite, comment gérer la récidive : est-on toujours un simple contrevenant après avoir été « verbalisé » 10 ou 15 fois ? Or, il paraît pertinent que la récidive soit considérée comme la cause d’un trouble plus important, et rehausse les faits dans le champ délictuel. Organiser les conditions de cette récidive semble juridiquement complexe.
- Par ailleurs, de quelle stratégie la contraventionnalisation participerait-elle ? Pas d’une stratégie de santé publique puisque disparaîtraient toutes les informations, incitations ou obligations de soins tandis que la sanction serait banalisée. Pas d’une stratégie pénale non plus puisque les consommateurs passeraient sous les radars du casier judiciaire, de la contrainte, de la garde-à-vue, et seraient bien moins susceptibles de constituer un appui suffisant pour caractériser les trafics.
Pour toutes ces raisons et d’autres encore, cette option présente des risques de rupture trop élevés dans les moyens de la lutte contre la consommation, le narcotrafic et la criminalité associée.
La seconde option, l’amende délictuelle, évite une partie de ces écueils en laissant l’infraction au niveau délictuel ; elle n’est pas pour autant exempte de risques pour l’avenir si elle n’était pas résolument associée à un renforcement de la volonté de l’État de lutter autant contre l’usage des stupéfiants que contre les trafics.
Or c’est là que le bât blesse : depuis des années, pour des raisons politiques les pouvoirs publics et les parlementaires ont été victimes d’un dilemme et n’ont jamais voulu infléchir le sens de la lutte contre les stupéfiants. Ainsi concernant le trafic, les promoteurs d’une dépénalisation de l’usage y voyaient-ils la solution pour rendre sans objet le trafic clandestin, tandis que les opposants prédisaient un report des trafics vers des drogues encore plus dangereuses.
Il faut reconnaître que d’un côté la politique officiellement répressive de la France n’a jamais fait reculer la toxicomanie (nous en avons examiné les raisons) et que, d’un autre côté, les exemples européens de libéralisation de l’usage du cannabis sont autant loués par certains pour leur modernité que dénoncés par d’autres pour avoir induit une inflation des consommateurs de cette drogue, et d’autres plus dangereuses encore, comme la cocaïne et l’héroïne. On observe d’ailleurs que la consommation de cocaïne suit des hausses exponentielles, en devenant presque aussi commune que celle du cannabis. L’exemple espagnol des années 1980 à nos jours est à cet égard particulièrement significatif[11] L’Espagne est le premier point d’entrée des stupéfiants en Europe, et le premier pays consommateur, toutes substances confondues (cf. le rapport annuel de l’Observatoire … Continue reading.
De fait, d’un pays européen à l’autre, les différences de politiques et de législations demeurent très importantes avec toutefois – il faut le regretter – un point commun : aucune n’a permis de faire reculer la consommation de stupéfiants ni les trafics et l’économie souterraine associés.
Quoi qu’il en soit, la question n’est pas à ce stade de trancher le débat de société sur la complaisance du corps social face à certaines conduites addictives, ni celui, philosophique, du paradoxe intrinsèque de la recherche d’un plaisir destructeur, mais de savoir si, et comment, la France souhaite s’engager dans une stratégie cohérente de lutte contre la consommation et les trafics de stupéfiants en s’appuyant sur les qualifications pénales définies dans ce champ.
Or on l’a vu, en dépit d’un arsenal répressif potentiellement sévère, il ne peut être tiré aucune conclusion de l’efficacité d’une telle option puisqu’en réalité elle n’est pas appliquée et que, non seulement les sanctions sont quasi-inexistantes pour les simples consommateurs qui ne sont donc pas dissuadés par le risque, mais qu’en outre le prix des stupéfiants reste stable [12] En Europe, les prix du cannabis (résine, herbe) n’ont pas véritablement augmenté sur les dix dernières années, tandis que la teneur en principe actif (delta-THC) a très significativement … Continue reading dans un contexte d’offre abondante[13] Les saisies de cannabis et de cocaïne, en nombre comme en quantité, repartent à la hausse après la baisse qui avait suivi le pic des années 2005-2009. Cf. le rapport précité de 2017., facilitant l’accès aux drogues.
C’est ici qu’il faut observer que, en matière de consommation de produits stupéfiants, les nouvelles formes de poursuites et de sanctions promues par le débat actuel viendraient se superposer à des dispositifs existants qui auraient pu être ajustés à cette fin, mais n’ont pas été utilisés par les professionnels concernés. Il n’a manqué que la volonté et une stratégie.
Sous le précédent quinquennat ont en effet été adoptées deux dispositions essentielles pourtant restées sans effets :
- l’une législative – la transaction pénale – introduite dans notre droit par la loi du 15 août 2014[14] Loi n°2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales ; pleinement effective avec la publication au Journal … Continue reading,
- l’autre réglementaire avec, en décembre 2016[15] Décret n° 2016-1202 du 7 septembre 2016 portant simplification des dispositions du code de procédure pénale (troisième partie : décret)., la fusion des formalismes procéduraux de l’enquête pénale (hors information judiciaire).
Mais ces deux outils présentaient une caractéristique constitutive d’un avantage autant que d’un inconvénient : ils n’étaient rattachés à aucune politique pénale et ne poursuivaient qu’un objectif de simplification et d’accélération du traitement de certaines infractions correctionnelles de bas niveau et dites « de masse » les plus courantes, en y incluant explicitement l’usage de cannabis.
Or, là où on aurait pu espérer que les professionnels (services d’enquête et magistrats) s’en emparent pour repenser leurs modes opératoires ainsi que l’approche policière et judiciaire de la lutte contre l’usage et les trafics de stupéfiants, mais aussi par voie de conséquence dégager des marges de manœuvre dans d’autres domaines, il n’en a rien été.
Sans doute faute d’incitation, d’instructions traduisant en objectif une volonté politique en la matière, ces textes ont-ils été ostensiblement boudés tant par les policiers que les magistrats, et ce avant même qu’un problème de constitutionnalité ne soit soulevé à l’encontre de la transaction pénale[16] cf. Décision n° 2016-569 QPC du 23 septembre 2016 : … Continue reading, puis des dispositions réglementaires soient annulées en avril 2017 par le Conseil d’État[17] CE, 24 mai 2017, 395321 et 395509. sans être, hélas, réintroduites dans l’arsenal judiciaire.
Les motivations à ne rien en faire de ces professionnels ont été diverses. Certains ont-ils estimé avec acrimonie ne pas avoir été préalablement assez consultés ? Les chapelles, les prés-carrés, les habitudes, les divisions, ont fait le reste, montrant au passage comment des administrations pourtant confrontées à des difficultés anciennes et majeures de leur fonctionnement ne parviennent pas à se remettre en question ni à saisir les opportunités avec réactivité et esprit de progrès.
Ces deux dispositifs combinés pouvaient pourtant, peu ou prou, aboutir à ce qui est aujourd’hui proposé sous l’hypothèse de « l’amende délictuelle forfaitaire », dispositif déjà existant puisqu’issu de la loi du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la Justice du 21ème siècle[18] Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033418805&categorieLien=id.
Annonces Collomb : une refondation de la lutte contre la consommation et les trafics de stupéfiants ?
On peut se féliciter que le ministre de l’Intérieur ait annoncé, le 25 janvier dernier, que le Gouvernement optait pour cette « amende délictuelle forfaitaire » et qu’il marque, ainsi, une possible refondation de la politique de lutte contre la consommation et les trafics de stupéfiants en France.
La question va maintenant se poser de la praticité de ce nouveau dispositif, de la cohérence opérationnelle et stratégique qu’il va permettre. Une autre question, tout aussi cruciale, est celle de la volonté des services de police et judiciaires d’appliquer effectivement une stratégie de lutte, dans des formes et sur une durée qui nécessairement demanderont du temps pour produire des effets mesurables.
Le paradigme que ce dispositif peut porter est inverse à celui prôné par les partisans d’une légalisation de l’usage des drogues (au moins le cannabis) qui, selon eux, éradiquerait les trafics devenus sans objet. En effet, l’amende délictuelle forfaitaire n’a de sens que si on considère au contraire qu’elle va permettre d’appliquer des sanctions réelles, rapides et dissuasives (par leur montant) à l’encontre des consommateurs.
L’idée est alors d’assécher les trafics en agissant sur la demande, laquelle doit se raréfier car soumise au risque d’amendes rendant plus onéreuses ces substances dont la consommation n’avait jamais reculé du fait de leur accessibilité. De la sorte, la stratégie en la matière rejoint très pragmatiquement celle de la lutte contre l’insécurité routière, ou encore contre le tabagisme : c’est le prix qui modifiera les comportements et fera reculer la demande.
Il faut donc assortir à ces nouvelles modalités de sanction une politique pénale volontariste et déterminée :
- fixer un montant d’amende à la fois suffisant et modulable ;
- établir un régime de récidive qui maintienne la peine d’amende au-delà de la première condamnation, tout en réservant la possibilité de basculer vers des obligations de soins ;
- limiter autant que possible les contraintes de procédure, notamment en réglant au plus court la question du sort des produits stupéfiants saisis (problématique de la destruction) ;
- maintenir un haut niveau de vigilance, de recherche et d’interpellation des consommateurs ;
- optimiser le recouvrement des amendes (globalement insatisfaisant) quitte à faire de leur acquittement un point de blocage d’autres procédures engageant des fonds publics (bourses, etc.) ou encore l’accès aux concours publics… Ce dernier point peut choquer mais une fois encore quelle est la fin poursuivie ? L’automobiliste qui persiste dans ses comportements dangereux est sanctionné et écarté du droit de conduire, au risque de perdre son emploi, de subir des frais supplémentaires en transport, en stages, en nouvel examen de passage du permis de conduire, etc. Au nom de quelle exception l’usager « ludique » de produits stupéfiants, qui plus est multi-réitérant, devrait-il échapper à cette accumulation de conséquences, alors qu’elle est précisément la cause déterminante d’une modification des comportements face au risque ?
Ici encore, il faut éviter l’écueil d’une approche socialement biaisée du phénomène, qui tendrait à imaginer le cannabis comme la « drogue du pauvre » touchant principalement les personnes et quartiers déjà défavorisés qu’une répression aveugle condamnerait à l’exclusion sociale. Au contraire, les sommes qui alimentent les trafics de cannabis, de cocaïne et autres amphétamines, comme le profil des consommateurs interpellés, montrent que l’image terrible des « accros » au crack plongés dans une spirale infernale de misère et de violence ne représente qu’une infime minorité des consommateurs de stupéfiants[19] Le crack ou « free base » est un dérivé du chlorhydrate de cocaïne, par adjonction de bicarbonate ou d’ammoniac, présentant une potentialité addictive élevée, avec des conséquences … Continue reading.
Le cas des consommateurs mineurs doit aussi être considéré avec la même détermination, tout en respectant les particularités que leur état nécessite. Mais justement, la facilitation de la sanction des majeurs doit permettre de rendre effectives les actions de prévention et d’éducation des mineurs usagers de stupéfiants, y compris à travers des peines de substitution.
Dans la lutte contre les trafics, la stratégie doit aussi évoluer. Si une action résolue place les consommateurs dans une situation de plus en plus risquée, la demande de produits stupéfiants évoluera vraisemblablement sous deux aspects :
- Le premier sera une baisse de la demande globale, dans des proportions difficiles à anticiper mais qui dépendront directement de la pression exercée sur les consommateurs et détenteurs.
- Le second sera une exigence de sécurité croissante de la part des consommateurs-acheteurs au moment où ils voudront se fournir en produits stupéfiants. Les modes opératoires des revendeurs (le deal dans les cités sensibles notamment), s’ils protègent les dealers (drogue dissimulée, réseau de « choufs », etc.) sont généralement peu sécurisés pour les acheteurs qui encourent notamment le risque d’une interpellation dans les temps proches de leurs achats. Si aujourd’hui ce risque leur apparaît supportable du fait des probabilités raisonnables de « malchance » d’être contrôlé et de la quasi-certitude de ne pas être sanctionné, il ne le sera vraisemblablement plus quand les services de police, forts de procédures simplifiées, rapides, et porteuses d’une sanction significative, effective et immédiate, seront en mesure de relever et traiter ces infractions en nombre. De fait, le « circuit commercial » dans sa partie terminale (celle qui lie le petit détaillant et le consommateur) sera nécessairement déstabilisé et confronté à un recul des acheteurs habitués à se rendre sur des » points de deal » pour se fournir.
Les trafics, et en particulier ceux abrités dans les quartiers populaires où les forces de sécurité éprouvent les plus grandes difficultés à pénétrer et à surveiller, mais dont ils pourront plus facilement écarter les acheteurs soumis au risque de sanctions rapides et dissuasives, devront donc tenter de renouveler leurs modes opératoires pour écouler leur « marchandise ». Ce faisant, même si l’ingéniosité des trafiquants est notoire (commandes à distance, livraisons à domicile, etc.), ils s’exposeront nécessairement.
De nouvelles techniques de détection, de contrôle, d’investigation, devront donc être développées parallèlement par les services d’enquête pour contrer l’évolution des trafics vers d’autres formes et parvenir à faire reculer les réseaux.
La pression sur les petits et grands trafics pourra donc enfin s’exercer autant par le haut (la lutte contre les réseaux internationaux) et par le bas (la pression exercée sur la « distribution » et la consommation).
Il n’y a sans doute pas de miracle à espérer de ces mesures, mais potentiellement un gain significatif d’efficacité issu d’une politique devenue enfin cohérente et volontaire. Ce volontarisme devra aussi être celui des services de police et de gendarmerie, et des magistrats, qui auront à s’inscrire dans une stratégie renouvelée. Il faudra utiliser les marges de manœuvre libérées par la simplification et l’économie de temps liées à la procédure de l’amende délictuelle pour accentuer durablement la pression sur les trafics.
Les outils législatifs, réglementaires, matériels et humains devront être au service d’un objectif poursuivi vainement depuis des décennies, à la condition que la réforme annoncée ne vise pas seulement à désengorger les commissariats, brigades, et services judiciaires.
Si l’ambition du projet devait se limiter à « verbaliser » les consommateurs sans s’intégrer à une stratégie globale de lutte contre la toxicomanie et les trafics, une routine s’installerait rapidement et il ne fait guère de doutes que les trafiquants y trouveraient toutes les occasions de prospérer, à nouveau.
Au risque d’avoir délivré une vision que d’aucuns pourraient trouver caricaturalement policière, l’idée d’une répression plus systématique de l’usage de stupéfiants vise, autant que possible, uniquement à éloigner les consommateurs de ces substances et à dissuader notre jeunesse de s’en approcher.
La prise en charge médico-sociale des consommateurs toxicodépendants ne doit pas en souffrir, mais ne doit plus servir de paravent à une forme de laisser-aller judiciaire qui, même pour cause d’insuffisance des moyens, dessert l’objectif de santé publique poursuivi.
Aucun des pays européens ayant libéré, à divers degrés, la consommation de certains stupéfiants n’en a retiré d’avantage sanitaire. Au contraire, la multiplication des drogues de synthèse, l’augmentation des degrés de pureté ou de principe actif, ou inversement l’utilisation de produits de coupage toxiques, le détournement des produits médicamenteux, etc., y accroissent le nombre des polyconsommateurs, pour une prévalence de la consommation de cannabis environ cinq fois supérieure à celle des autres substances.
La France ne serait donc pas à rebours de l’Europe en confirmant la prépondérance d’une politique pénale ferme et déterminée dans la lutte contre la consommation et les trafics de stupéfiants.
Notes
| ↑1 | cf. l’article L. 3421-1 du code de la santé publique. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688173 |
| ↑2 | Ainsi que vient de le rappeler la Cour de Cassation (Cass. Crim. 14 mars 2017, n° 16-81805), la détention ne s’envisage en principe qu’indépendamment de l’usage ; elle est beaucoup plus sévèrement sanctionnée car on considère alors qu’elle s’inscrit dans la perspective d’un trafic. Toutefois, par assimilation, on peut rapprocher la détention de l’usage en démontrant in concreto qu’une petite quantité transportée se rapporte à l’usage personnel, et dès lors poursuivre pour des faits d’usage quand bien même ces derniers n’auraient pas été directement constatés. |
| ↑3 | cf. l’article 41-1 du Code de procédure pénale. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000029345305 |
| ↑4 | Louise VIARD-GUILLOT, « Le traitement judiciaire des infractions liées aux stupéfiants en 2015 », Infostat Justice, mars 2017, n°150. http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_Infostat_150.pdf |
| ↑5 | Ibidem. |
| ↑6 | Brigades Anti-Criminalité. |
| ↑7 | Le schéma est un peu différent à la Préfecture de Police et au sein de la Gendarmerie Nationale, mais la distinction y existe aussi. |
| ↑8 | Ficher Automatisé des Empreintes Digitales. |
| ↑9 | La mesure exacte n’en a jamais été prise, mais selon le rapport d’information parlementaire de MM. Poulliat et Reda du 25 janvier 2018 : « La direction centrale de la sécurité publique de la police nationale estime, quant à elle, que chaque procédure pour usage représente en moyenne 5 heures de travail et 10 heures en cas de garde à vue. Le temps de travail consacré au traitement de ces infractions par les forces de l’ordre peut être estimé à plus d’un million d’heures en 2016 pour 182 161 faits constatés, parmi lesquels 31 477 faits ont donné lieu à une garde à vue, soit 600 équivalents temps plein ». Cette évaluation nous paraît conforme à l’état actuel de la situation, étant précisé qu’il y a une dizaine d’années, hors garde-à-vue, une heure suffisait pour traiter un usage de produits stupéfiants. |
| ↑10 | Chiffres Ministère de l’Intérieur 2017. |
| ↑11 | L’Espagne est le premier point d’entrée des stupéfiants en Europe, et le premier pays consommateur, toutes substances confondues (cf. le rapport annuel de l’Observatoire européen des drogues du 4 juin 2015). La dépénalisation totale de l’usage du cannabis en 1983 a provoqué une explosion des consommations au point que, dix ans plus tard, la loi a été modifiée pour que seul l’usage dans un contexte privé ne soit pas sanctionnable (loi Corcuera du 21 février 1992, https://www.boe.es/boe/dias/1992/02/22/pdfs/A06209-06214.pdf). Ces dernières années, la consommation de cannabis en Espagne, dont la mesure est compliquée du fait de sa dépénalisation partielle, semblait être inférieure à celle de la France, mais sa banalisation augmente constamment, comme en témoigne l’autorisation par la loi, en 2017, des Cannabis social clubs, en Catalogne. |
| ↑12 | En Europe, les prix du cannabis (résine, herbe) n’ont pas véritablement augmenté sur les dix dernières années, tandis que la teneur en principe actif (delta-THC) a très significativement augmenté. Le prix de la cocaïne est en baisse, et le degré de pureté en hausse (Cf. le Rapport annuel de l’Observatoire européen des drogues et toxicomanie 2017, http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4541/TDAT17001FRN.pdf). |
| ↑13 | Les saisies de cannabis et de cocaïne, en nombre comme en quantité, repartent à la hausse après la baisse qui avait suivi le pic des années 2005-2009. Cf. le rapport précité de 2017. |
| ↑14 | Loi n°2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales ; pleinement effective avec la publication au Journal officiel du 15 octobre 2015 du décret n°2015-1272du 13 octobre 2015 pris pour l’application des articles 41-1-1 du code de procédure pénale et L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure. |
| ↑15 | Décret n° 2016-1202 du 7 septembre 2016 portant simplification des dispositions du code de procédure pénale (troisième partie : décret). |
| ↑16 | cf. Décision n° 2016-569 QPC du 23 septembre 2016 : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2016-569-qpc/decision-n-2016-569-qpc-du-23-septembre-2016.147863.html |
| ↑17 | CE, 24 mai 2017, 395321 et 395509. |
| ↑18 | Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033418805&categorieLien=id |
| ↑19 | Le crack ou « free base » est un dérivé du chlorhydrate de cocaïne, par adjonction de bicarbonate ou d’ammoniac, présentant une potentialité addictive élevée, avec des conséquences très désocialisantes. Sa consommation est – sauf exceptions – circonscrite à une population marginalisée, localisée dans le nord-est parisien. 753 personnes ont été interpellées pour consommation de crack en France en 2010, à rapprocher des 160.000 usagers interpellés cette année-là, tous stupéfiants confondus (Rapport OFDT 2013). La toxicodépendance au crack est de celles qui justifient une approche médico-sociale de sa consommation. |