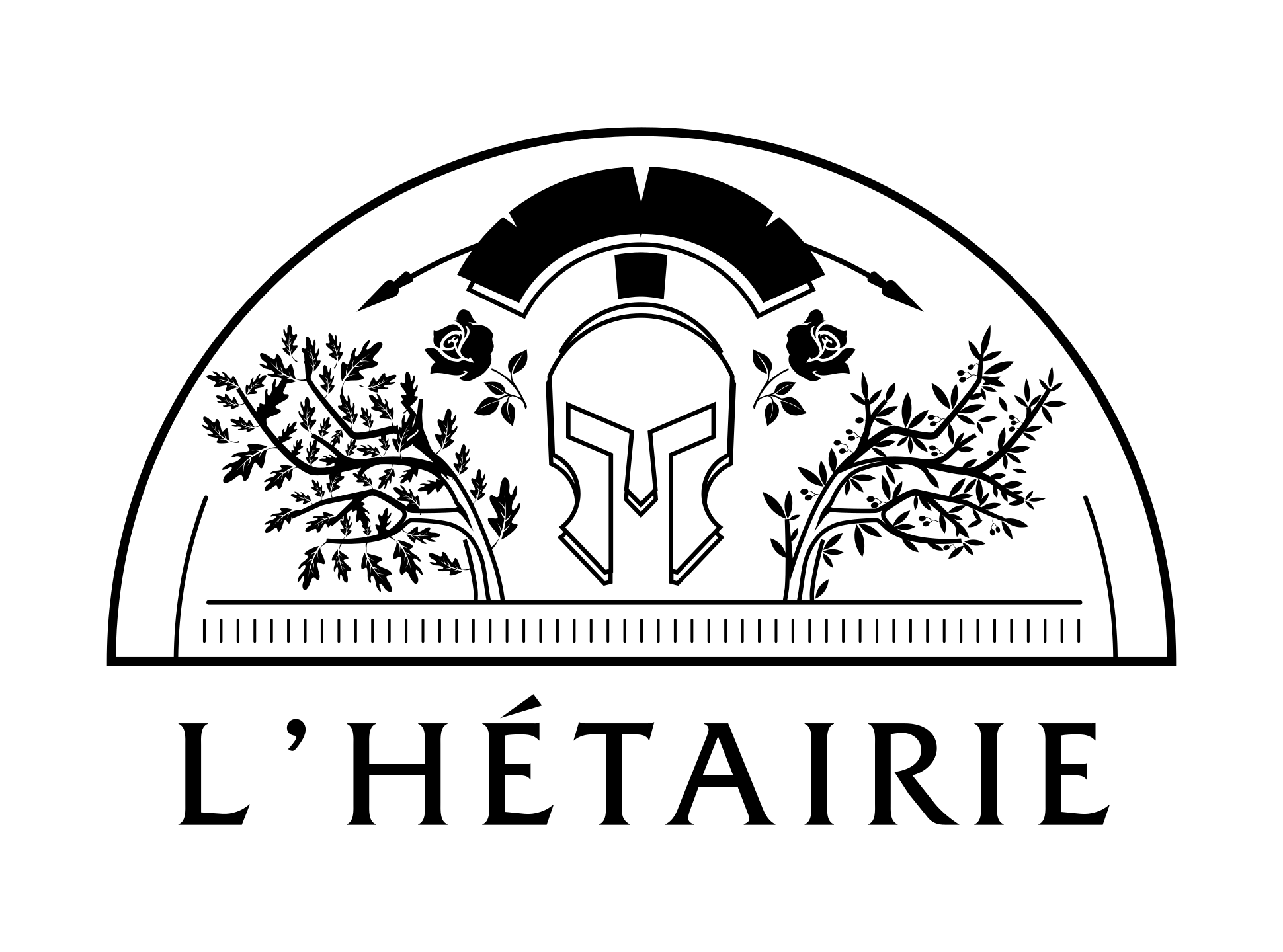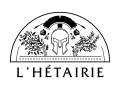La loi de 1905 : « un concordat non-dit » [Note #30]
Comme pour les grands philosophes, le succès de la laïcité et de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’Etat se mesure certainement à tout ce qu’on prétend leur faire dire et qu’elles ne disent pas.
La signification et les implications des règles de droit ou des concepts juridiques restent toutefois tributaires des textes qui les fondent et des interprétations qu’en font les juridictions en charge de les appliquer. Le droit ne laisse donc guère de place aux fantasmes. Autrement dit : il interdit de prendre ses désirs politiques pour des réalités juridiques.
Bien évidemment les règles de droit peuvent toujours changer, spécialement dans un système démocratique. Mais avant de les changer, encore faut-il bien mesurer ce qu’elles permettent et ce qu’elles prohibent.
En raison de sa charge symbolique, la loi de 1905, plus encore que d’autres lois, ne peut échapper à cette démarche. Par ailleurs, une révision de la loi de 1905 ne pourrait s’opérer que dans le cadre imposé par la Constitution qui proclame dans son article 1er que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances », mais aussi dans le cadre imposé par la Convention européenne des droits de l’Homme qui consacre également la liberté de religion.
La laïcité : une obligation de neutralité qui pèse avant tout sur les pouvoirs publics
Comme en témoigne la rédaction même de l’article 1er de la Constitution qui rappelle le respect de toutes les croyances, la laïcité n’est nullement un concept hostile à la liberté de religion. Elle correspond à la manière dont la République française garantit la liberté de croire ou de ne pas croire, de pratiquer ou de ne pas pratiquer sa religion.
Certes, le concept de laïcité a été historiquement conçu en opposition au primat de l’église catholique et son rôle dans le champ politique et social. C’est en ce sens qu’avaient œuvré les lois Ferry et la loi Goblet pour l’enseignement. La laïcité a donc été un vecteur de la sécularisation de la société française. Mais aujourd’hui, c’est parce que l’Etat n’a pas de religion qu’il reconnaît à tous la liberté de religion. La loi de 1905 elle-même, avant d’affirmer dans son article 2 que « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte », proclame dans son article 1er : « la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ».
Cette obligation de neutralité ne pèse que sur les agents du service public qui, dans le cadre de leur fonction, ne peuvent manifester leur croyance (ainsi, un agent du service public ne peut-il arborer un signe religieux). Elle s’impose également aux édifices publics, mais uniquement à ceux bâtis après l’entrée en vigueur de la loi de 1905. Il existe donc en France une multitude d’édifices publics ornés de connotations religieuses : les palais de justice édifiés au XIXème siècle regorgent par exemple de toiles à connotations catholiques.
En revanche, cette obligation de neutralité ne s’impose pas aux usagers des services publics, aux personnes qui n’incarnent pas la puissance publique: un justiciable peut se rendre dans un palais de justice avec un insigne religieux ou un administré dans une administration. Pour interdire le port des signes religieux ostensibles dans les établissements d’enseignements primaires et secondaires, le législateur a donc été obligé d’adopter la loi du 15 mars 2004, car cette prohibition ne découlait nullement de la Constitution telle qu’interprétée par le Conseil d’Etat. De même, la laïcité ne joue a fortiori pas dans les relations de travail dans le secteur privé, comme l’a montré l’affaire de la crèche Baby-Loup.
La laïcité n’interdit même pas que la République subventionne les cultes. A ce titre, la loi de 1905 ne s’applique pas dans certains territoires d’Outre-mer, comme la Guyane ou la Polynésie. Le Conseil d’Etat a ainsi jugé que « le principe constitutionnel de laïcité qui s’applique en Polynésie française et implique neutralité de l’Etat et des collectivités territoriales de la République et traitement égal des différents cultes, n’interdit pas, par lui-même, l’octroi dans l’intérêt général et dans les conditions définies par la loi, de certaines subventions à des activités ou des équipements dépendant des cultes[1]CE, 16 mars 2005, ministre de l’Outre-Mer c/ président de la Polynésie française.».
De même, s’agissant de l’Alsace-Moselle, le régime concordataire issu de la loi du 18 germinal an X s’applique. Et le Conseil constitutionnel, saisi de sa comptabilité avec le principe de la laïcité, a jugé que le constituant avait souhaité que ce principe ne s’applique pas à l’Alsace-Moselle. La Constitution contiendrait ainsi une dérogation implicite. Surtout, à cette occasion il a estimé que la laïcité impose que « la République ne reconnaît aucun culte » et que « celle-ci ne salarie aucun culte ». Nulle trace de l’interdiction des subventions. Leur interdiction ne découle donc pas de la laïcité, mais de l’article 2 de la loi de 1905. En outre, au-delà de cette interdiction de principe, et en l’état du droit, de nombreux transferts financiers demeurent possibles entre l’Etat et les cultes.
La loi de 1905 permet le financement des lieux de culte, mais dans des conditions discriminatoires
L’imparfaite séparation entre les Eglises et l’Etat opérée par la loi de 1905 se manifeste essentiellement dans les modalités de gestion des lieux de culte. Depuis l’époque révolutionnaire, les lieux de culte appartiennent aux pouvoirs publics, communes et Etat principalement. Le seul moyen d’assurer une parfaite séparation des églises et de l’Etat eût été de rétrocéder en 1905 l’ensemble des églises, temples ou synagogues aux associations cultuelles dont la loi prévoyait par ailleurs la création. Dans la mesure où l’Etat et les communes sont finalement demeurés propriétaires, la loi a logiquement précisé dans son article 13 qu’ils « pourront engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi ». Cette rédaction est d’ailleurs en elle-même trompeuse car elle présente ces dépenses comme une simple faculté alors qu’il s’agit en pratique d’une obligation : le propriétaire reste responsable des dommages causés par un défaut d’entretien de l’édifice.
Quand bien même l’article 19 de la loi de 1905 affirme que « ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques », tous les édifices cultuels bâtis avant l’entrée en vigueur de la loi de1905 bénéficient d’aides financières des collectivités publiques. Seuls les édifices construits postérieurement sont la pleine propriété des associations religieuses qui en assurent la gestion.
Cette solution est tout à fait avantageuse pour les religions qui existaient en France en 1905, mais défavorise celles qui se sont depuis développées et spécialement l’Islam. Toutefois, le législateur n’a pas été indifférent à cette situation :
- Une loi du 24 février 1996 a permis aux communes ou aux départements de garantir « les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux »[2] Articles L 2252-4 et L 3231-5 du code général des collectivités territoriales..
- En outre, depuis 2006, le code général des collectivités territoriales permet qu’un terrain ou un bâtiment communal puisse faire l’objet d’un bail emphytéotique au profit d’une association cultuelle. La durée d’un tel bail (qui peut aller jusqu’à 99 ans) et les droits dont bénéficie son titulaire lui assurent à la fois sérénité et autonomie. Si sur le terrain a été construit un édifice, à l’expiration du bail, la collectivité en devient propriétaire. En outre le Conseil d’Etat a admis qu’un tel bail puisse être conclu pour une redevance annuelle d’un euro symbolique sans que cela ne porte atteinte à l’article 2 de la loi de 1905.
Ces aménagements de la loi de 1905 – que certains qualifieront d’arrangements – ne s’avèrent pas pour autant suffisants pour effacer la différence de traitement entre les trois religions existantes en 1905 et celles qui se sont depuis développées. Il est même possible de discerner dans cette différence une véritable discrimination. Or, dans le droit de la Convention européenne des droits de l’Homme comme dans le droit de l’Union européenne sont interdites à la fois les discriminations directes et les discriminations indirectes :
- Une discrimination directe est, si l’on peut dire, une discrimination assumée qui affiche ouvertement une distinction fondée sur un critère par ailleurs prohibé par la loi comme le sexe, la race ou la religion.
- Une discrimination indirecte est une discrimination implicite, parfois même inconsciente et involontaire : une distinction est opérée sur un critère en apparence neutre, mais qui produit un effet discriminatoire. Par exemple, si une entreprise distingue les travailleurs à temps complet des travailleurs à temps partiel, cette distinction conduit en pratique à une discrimination en raison du sexe dans la mesure où la très grande majorité des travailleurs à temps partiel sont des femmes.
Or c’est bien à une telle discrimination indirecte que conduit, dans la réalité, l’application de la loi de 1905. Les édifices cultuels bâtis avant 1905 – et donc les religions qui les occupent – bénéficient d’une aide financière des collectivités publiques, là où les religions qui n’existaient pas à cette époque ne disposent d’aucune aide, hormis celles prévues dans le code général des collectivités territoriales.
Le législateur devrait s’emparer de cette situation :
- Il y a d’abord un motif juridique. Il n’est en effet pas certain que le droit français soit compatible avec les articles 9 (liberté de religion) et 14 (principe de non-discrimination) de la Convention européenne des droits de l’Homme telle qu’interprétée par la Cour de Strasbourg.
- Il y a surtout un motif politique. Alors que la République proclame l’égalité de tous devant la loi, n’est-ce pas contradictoire avec le maintien par le législateur d’un dispositif qui conduit, pour des raisons d’appartenance religieuse, à réserver un traitement moins favorable à une partie des citoyens ? Alors que la nécessité d’intégration est sans cesse évoquée, peut-on laisser subsister de telles différences de traitement qui nourrissent un sentiment d’exclusion ? La liberté et l’égalité sont consubstantielles et la première des libertés est assurément le droit à l’in-différence.
Si l’on ne voulait pas, pour des raisons symboliques, toucher à la loi de 1905, il s’avère possible de prévoir, dans le code général des collectivités territoriales, des dispositions précisant la manière dont les communes ou leur groupement pourraient participer au financement de la construction d’édifices cultuels en lien avec des dispositions précisant les modalités par lesquelles elle participent à l’entretien des édifices cultuels dont elles sont d’ores et déjà propriétaires. De telles dispositions ne paraissent pas impossibles à mettre en place, d’autant qu’existent déjà des subventions publiques au bénéfice des activités cultuelles.
Les nombreuses exceptions à l’interdiction des subventions posée par la loi de 1905
Dans le champ d’application de la loi de 1905, les subventions aux associations qui présentent un objet cultuel sont interdites, sauf pour l’organisation de service d’aumôneries dans les prisons, les hôpitaux, les écoles et les armées. Surtout, un ensemble de lois prévoit de nombreuses autres exceptions.
Ainsi, depuis la loi Debré de 1959, l’Etat subventionne-t-il les établissements d’enseignement privés sous contrat qui, bien souvent, ont un caractère confessionnel. Le code de l’éducation prévoit également que « les établissements d’enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l’Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l’établissement ».
S’agissant des cultes, il faut distinguer les associations cultuelles prévues par la loi de 1905 des associations diocésaines propres à l’église catholique ou des associations loi de 1901. Le régime de la loi de 1905 est plus favorable, mais certains cultes comme l’Islam ont privilégié les associations loi de 1901 qui leur permettent de mêler activités cultuelles et culturelles, sans pour autant pouvoir bénéficier de subventions directes pour les activités cultuelles.
En effet, seules les associations cultuelles et les associations diocésaines ou les associations loi de 1901 reconnues d’utilité publique peuvent recevoir une libéralité, c’est-à-dire se voir donner un bien (le plus souvent immeuble) en pleine propriété par un acte notarié. Le code général des impôts exonère de droits de mutations (droits de succession) ces libéralités. En outre, lorsqu’elles sont propriétaires d’un local affecté à l’exercice du culte, elles sont exonérées de taxes foncières et de taxes d’habitation. Toute exonération d’impôts constitue évidemment une subvention dans la mesure où elle représente un manque à gagner pour les finances publiques.
De même, les associations cultuelles, les associations diocésaines, comme les associations loi de 1901, peuvent recevoir des dons manuels (somme d’argent, biens meubles) qui ouvrent droit à une réduction d’impôts elle aussi constitutive d’une subvention indirecte.
Outre ces subventions de la République, les associations bénéficient surtout de la générosité publique. Pour le culte musulman, le débat actuel porte sur la nécessité de contrôler les financements étrangers et de manière générale les associations afin d’éviter toute dérive radicale.
Des associations à vocation cultuelle déjà contrôlées par les pouvoirs publics
Les finances de toutes les associations sont soumises à différents contrôles :
- Lorsqu’elles bénéficient de subventions pour un montant annuel supérieur à 153 000 euros, elles doivent faire appel à un commissaire aux comptes.
- De surcroît, la Cour des comptes peut contrôler les associations faisant un appel public à la générosité « afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par un appel public à la générosité ».
- Les libéralités dont bénéficient les associations cultuelles sont soumises à une déclaration au préfet qui a la possibilité de s’y opposer si l’association ne répond pas aux conditions cumulatives et nécessaires à sa création, à savoir l’exercice public et exclusif du culte, le respect de l’ordre public, la définition de la circonscription religieuse, la composition de l’association et enfin les statuts précis définissant l’objet de l’association.
- Pour les financements étrangers, on ne peut négliger le rôle d’institutions comme TRACFIN. Il paraît en revanche difficile d’interdire ou de limiter les financements étrangers. Dans une affaire française où était en cause le contrôle de capitaux étrangers au profit de l’église de scientologie, la Cour de justice de l’Union européenne s’était montrée hostile à la mise en place d’un régime d’autorisation administrative[3]CJCE, 14 mars 2000, Association Eglise de scientologie de Paris et Scientology International Reserves Trust c/ Premier ministre, Aff. C-54/99., un régime de déclaration préalable semble le maximum qui puisse être imposé.
Au-delà de ces contrôles financiers, les pouvoirs publics ne sont pas démunis pour surveiller les associations à vocation cultuelle qui connaîtraient des dérives. L’article L 212-1 du code de la sécurité intérieure confère au Président de la République le pouvoir de dissoudre , par décret en conseil des ministres, des associations qui inciteraient notamment à la haine, à la discrimination raciale ou au terrorisme. De telles mesures ont déjà été adoptées contre l’association Rahma de Torcy Marne-la-Vallée et l’association « Fraternité musulmane Sanâbil (Les Epis) ».
Par ailleurs l’article 3 de la loi de 1901 donne au Tribunal de grande instance le pouvoir de dissoudre une association contraire à l’ordre public. Il peut être saisi par toute personne intéressée ou par le ministère public.
Dans ce cadre, la récente proposition de loi tendant à imposer aux ministres des cultes de justifier d’une formation les qualifiant à l’exercice de ce culte apparaît fort surprenante. Elle vise d’abord à interdire aux associations à vocation cultuelle de recourir aux associations loi de 1901, et leur impose de s’inscrire dans le cadre de la loi de 1905. Il s’agit là bien évidemment d’une discrimination en raison de la religion, probablement contraire à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’Homme. En outre, elle prévoit d’imposer aux ministres du culte « une formation spécifique leur assurant une connaissance suffisante des principes civils et civiques ainsi que des rites de cette confession, dispensée et sanctionnée par une instance suffisamment représentative de ce culte sur le territoire national ». Ministre du culte deviendrait ainsi presque une profession réglementée, comme les avocats ou les coiffeurs ! Une telle disposition ne paraît guère compatible avec le principe de laïcité qui, selon le Conseil constitutionnel, implique que « la République garantisse le libre exercice des cultes ».
En définitive, avant de réviser la loi de 1905, le législateur devrait particulièrement méditer la célèbre préconisation de Montesquieu, « les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires ». Il est vrai que Montesquieu était libéral et combattait le despotisme ; il ignorait tout du néolibéralisme et de sa volonté de tout régimenter… et qu’un concordat, même non-dit[4]Selon l’expression du philosophe et membre de l’Académie française Jean-Luc Marion., vise à la concorde et non à la discorde.
Notes
| ↑1 | CE, 16 mars 2005, ministre de l’Outre-Mer c/ président de la Polynésie française. |
| ↑2 | Articles L 2252-4 et L 3231-5 du code général des collectivités territoriales. |
| ↑3 | CJCE, 14 mars 2000, Association Eglise de scientologie de Paris et Scientology International Reserves Trust c/ Premier ministre, Aff. C-54/99. |
| ↑4 | Selon l’expression du philosophe et membre de l’Académie française Jean-Luc Marion. |