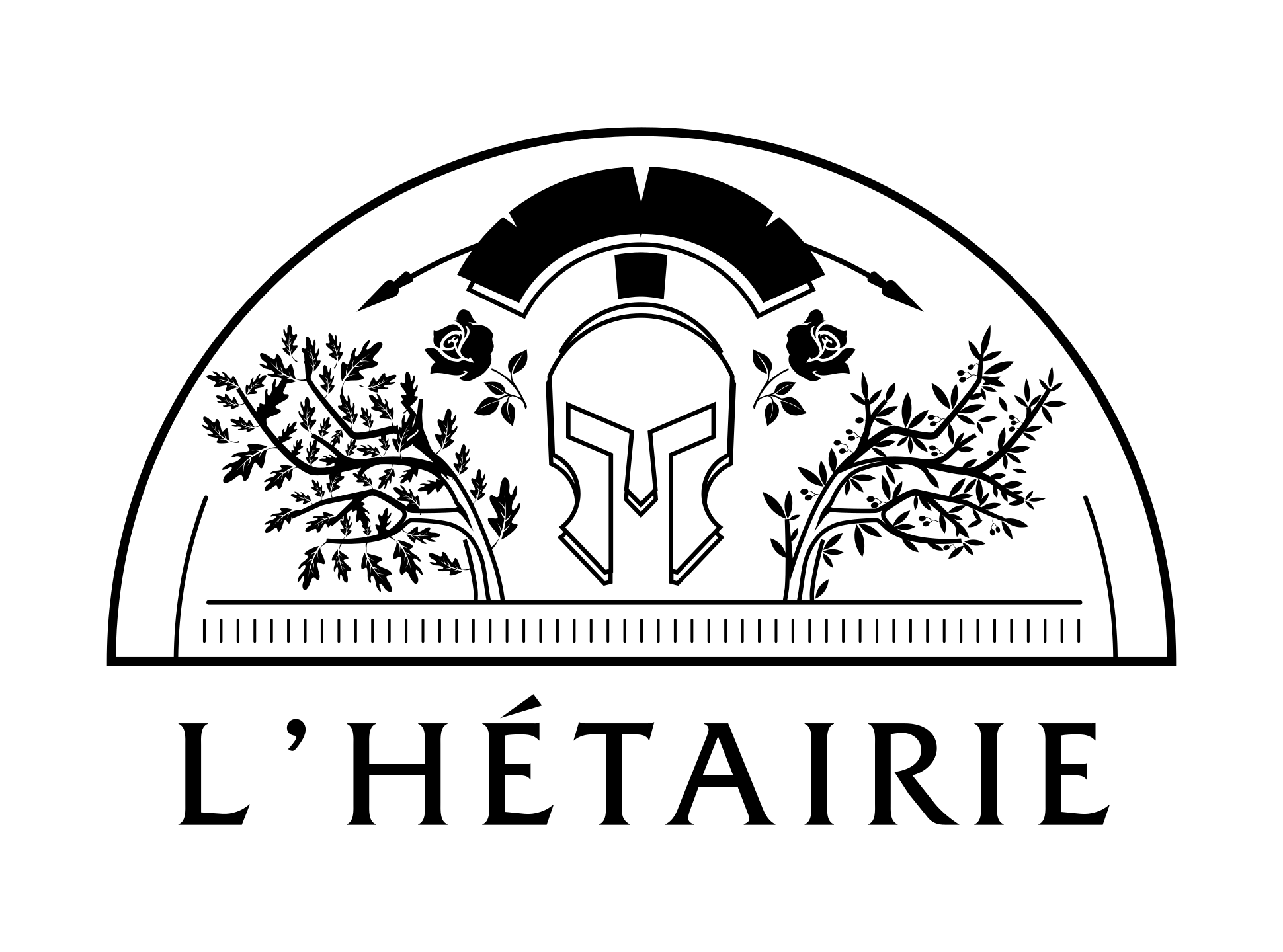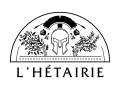Brève histoire de la responsabilité des Etats en matière d’activités spatiales [Note #44]
Le samedi 2 mars dernier, Space X en collaboration avec la NASA a réussi le lancement de la capsule Crew Dragon depuis le Space Kennedy Center, en Floride. L’engin s’est par la suite amarré de façon automatique à la Station Spatiale Internationale. Mission inhabitée – ou presque, puisqu’elle contenait dans son habitacle un mannequin dénommé Ripley (clin d’oeil à la saga Alien) ainsi qu’une peluche en forme de Terre -, Crew Dragon a pour ambition de relancer les vols habités. En outre, il s’agit de la première fois dans l’histoire de la NASA que celle-ci accepte de confier à une société privée le transport de potentiels futurs membres d’équipage.
Supposons maintenant un scénario catastrophe : une des navettes de ce type, appartenant à un acteur privé, rate son lancement et s’écrase sur un lieu habité. Qui sera responsable ? L’État sur le sol duquel s’est déroulé le lancement ? La société privée uniquement ? Les deux ? Personne ? Et, sous quelle forme cette responsabilité pourrait-elle se manifester ? Car le droit spatial, dans le domaine de la responsabilité pour des faits et actes réalisés dans l’espace, déroge aux principes communs du droit international public. A ce titre et dans le cas d’espèce, il peut faire office de droit spécial (lex specialis) qui dérogerait aux règles du droit général (lex generalis).
En effet, si en droit international public un Etat n’est en principe pas responsable des activités de ses particuliers lorsqu’ils n’agissent pas en son nom, la responsabilité internationale d’un Etat peut donc être engagée du fait d’une personne privée. Or, avec l’émergence d’acteurs privés de l’exploration et l’exploitation spatiale, tels Space X, Blue Origin ou Virgin Galactic, les risques d’incidents et d’accidents ne font qu’augmenter.
Question ô combien épineuse tant les enjeux sont grands et la jurisprudence internationale peu abondante en la matière, la responsabilité des Etats en droit spatial sera ici exclusivement examinée sous l’angle des conventions internationales, et selon trois types : juridique, politique et financier en ce qui concerne la prise en charge des demandes en réparation pour des dommages spatiaux.
La responsabilité dans le Traité de l’Espace de 1967
Délimitation de la responsabilité juridique
L’article VII du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes (plus simplement nommé Traité de l’Espace de 1967, véritable pierre angulaire du droit spatial) avance : « Tout État partie au Traité qui procède ou fait procéder au lancement d’un objet dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, et tout État partie dont le territoire ou les installations servent au lancement d’un objet, est responsable du point de vue international des dommages causés par ledit objet ou par ses éléments constitutifs, sur la Terre, dans l’atmosphère ou dans l’espace extraatmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, à un autre État partie au Traité ou aux personnes physiques ou morales qui relèvent de cet autre État. »
La richesse juridique de cet article mérite examen :
- En premier lieu, le principe de responsabilité semble uniquement s’appliquer aux Etats parties au Traité, sachant que l’ensemble des Etats de la planète ne l’ont pas nécessairement signé et ratifié et que, par conséquent, il ne revêt pas un caractère juridiquement contraignant au sein de leur droit national) ; néanmoins, les grandes puissances telles que la France, l’Inde, la Chine, les Etats-Unis et la Russie l’ont ratifié.
- Par ailleurs, son champ d’application spatial s’avère très vaste : il couvre à la fois les dommages causés non seulement sur Terre mais également dans l’atmosphère ou l’espace extra-atmosphérique. Or il est important de souligner qu’il n’existe pas de réelle frontière entre atmosphère et espace ; il est considéré qu’elle correspond à la ligne de Karman qui se situe à 100km au-dessus de la surface de la Terre.
- Mais le plus intéressant dans cet article réside dans le fait que l’État ayant causé un dommage ne doive répondre de ses actes que pour le cas où le dommage affecte un autre Etat partie au Traité, ou bien les personnes physiques ou morales relevant de cet autre Etat. Plusieurs conclusions découlent de cet élément :
- si le dommage concerne un Etat non partie au Traité, ou des personnes physiques/morales relevant de cet Etat non partie, la responsabilité de l’État contractant ne pourra pas être susceptible d’être engagée par le biais de la Convention ;
- les personnes physiques ou morales ont, par leur nationalité, le privilège de pouvoir obtenir réparation d’un Etat partie pour les dommages subis du fait d’une activité spatiale ;
- en principe, un Etat non-partie au traité ne pourra voir engagée sa responsabilité pour un dommage qu’il a causé en lien avec une activité spatiale.
L’histoire de la rédaction et de la négociation du Traité de l’espace rappelle que l’URSS ne souhaitait pas, pour des raisons économiques et politiques, que des entreprises privées s’engagent dans des activités spatiales. Finalement, elle finit par se rétracter puisque les activités commerciales spatiales nécessiteront l’autorisation et la surveillance continue des Etats qui s’y livrent.
La responsabilité à travers la Convention de 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux
La Convention de 1972, en son article II, énonce: « un Etat de lancement a la responsabilité absolue de verser réparation pour le dommage causé par son objet spatial à la surface de la Terre ou aux aéronefs en vol. »
Un travail définitionnel inédit
L’article I a) de la Convention définit les dommages comme « la perte de vies humaines, les lésions corporelles ou autres atteintes à la santé, ou la perte de biens d’État ou de personnes, physiques ou morales, ou de biens d’organisations internationales intergouvermentales, ou les dommages causés auxdits biens ». Cette définition est plutôt bien pensée puisqu’elle englobe un grand nombre de situations possibles et permet, sur le papier, une sécurité juridique importante pour les acteurs d’activités spatiales.
Concrètement, une situation de dommage couverte pourrait se traduire par les événements suivants : une navette spatiale ratant son décollage et s’écrasant sur une ville ; une capsule voulant rejoindre l’ISS se heurtant à un satellite national ou provenant d’un opérateur privé ; une sonde spatiale s’écrasant sur la Lune en détruisant une autre sonde spatiale déjà présente sur place…
| Une cartographie des débris spatiaux actuellement connus (la très grande majorité étant des satellites hors d’usage). La concentration de débris spatiaux au-dessus de l’hémisphère nord est en grande partie liée aux lancements russes. Cette image a de quoi donner des sueurs froides aux agences nationales, juristes spécialisés et organismes privés. A ce titre, le syndrome de Kessler, du nom d’un consultant de la NASA, désigne un scénario catastrophe où le volume des débris spatiaux est tel qu’il augmente par collisions de façon exponentielle, rendant impossible toute exploration spatiale et l’utilisation de satellites artificiels. Source : NASA Orbital Debris Program Office |
En outre, l’État de lancement est défini à l’article I c) de la Convention de 1972. La notion désigne l’État qui procède ou fait procéder au lancement d’un objet spatial. Sont également compris le territoire ou les installations qui servent au lancement d’un objet spatial. A titre d’exemple, SpaceX, entreprise privée dont le siège social se trouve en Californie a lancé en février 2019depuis Cap Canaveral en Floride SpaceIL, engin israélien ayant pour but de se poser sur la Lune en avril prochain. Cette définition multiple de l’Etat de lancement s’avère très protectrice pour les Etats potentiellement affectés par les activités spatiales. S’il y a plusieurs Etats de lancement, ils ont une responsabilité solidaire. Mais la Convention de 1972 ne donne pas de détails quant à la possible situation où deux Etats de lancement d’un objet spatial agissent en responsabilité l’un envers l’autre alors qu’ils sont solidairement responsables.
Enfin, une disposition de la Convention de 1972 est particulièrement intéressante puisqu’elle permet une certaine immunité des Etats de lancement ; autrement dit, on ne peut chercher leur responsabilité. En vertu de son article VII, les dispositions de la Convention ne s’appliquent pas au dommage causé par un objet spatial d’un Etat de lancement aux ressortissants de cet Etat de lancement et aux ressortissants étrangers s’ils participent aux opérations de fonctionnement de cet objet spatial.
Un éventail de situations couvertes par la Convention
L’article III pose cependant une responsabilité limitée des Etats de lancement : celle-ci ne sera engagée que si le dommage est imputable à lui-même ou à des personnes dont il doit répondre. En outre, cela vaut uniquement pour le dommage causé ailleurs qu’à la surface de la Terre, à un objet spatial d’un Etat de lancement ou à des personnes/ biens se trouvant à bord de l’objet spatial d’un autre Etat de lancement.
La Convention instaure également un mécanisme de responsabilité solidaire pour tout dommage pouvant résulter du lancement d’un objet spatial par deux ou plusieurs Etats (article V). Cette disposition permet ainsi de ne pas aboutir à des situations où un Etat de lancement refuserait de se voir attribuer quelque responsabilité quand un autre Etat était également lanceur.
Cependant, il existe des cas où l’État de lancement verra exonérée sa responsabilité absolue ; ils sont énoncés à l’article VI de la présente Convention. Pour cela, l’Etat doit établir que le dommage résulte :
- en totalité, ou au moins en partie ;
- d’une faute lourde[1] En droit français des contrats, la faute est dite lourde si elle s’avère particulièrement grave, résultant du comportement du débiteur, à savoir celui à qui revient l’exécution de la … Continue reading, d’un acte ou d’une omission ;
- commis dans l’intention de provoquer un dommage ;
- de la part d’un Etat demandeur ou des personnes physiques ou morales que cet Etat représente.
Mais ce n’est pas un hasard si la responsabilité absolue est exonérée quand le dommage résulte « d’un acte ou d’une omission commis dans l’intention de provoquer un dommage » ; le droit spatial doit toujours être analysé sous le prisme de l’Histoire. Or, lorsque cette Convention a été rédigée, en 1972, la Guerre Froide fait rage et il n’est donc pas surprenant que les deux puissances spatiales de l’époque, à savoir l’URSS et les Etats-Unis, conservent une méfiance légitime dans le domaine. Par ce type de convention, les Etats souhaitent consolider un terreau sécuritaire, sans oublier que les actes de sabotage ne sont pas impossibles.
Prise en charge des demandes en réparation et règlement des différends spatiaux
La Convention de 1972 a inséré un mécanisme permettant de traiter des demandes en réparation en cas de dommages liés à des objets spatiaux. A l’origine, le bloc occidental souhaitait, contrairement à l’URSS le recours à une compétence obligatoire de la Cour Internationale de Justice, la création d’un organe judiciaire principal des Nations-Unies pour régler les conflits entre Etats ou l’établissement de procédures arbitrales (un mode alternatif de résolution des litiges, en dehors du circuit des tribunaux étatiques). Il serait tout à fait possible d’imaginer des contrats spatiaux entre personnes privées insérant une clause compromissoire, laquelle prévoit qu’en cas de litige relatif au contrat, ce dernier soit soumis à une procédure arbitrale. Et, en cas de litige impliquant un acteur public ou l’une de ses émanations, le droit national de l’État concerné devrait autoriser le recours à l’arbitrage. En France, par exemple, un décret autorise certaines catégories d’établissements publics à caractère industriel et commercial (article 2060 du Code civil).
En définitive, la Convention de 1972 a prévu que les demandes en réparation sont formulées par la voie diplomatique et traitées par une Commission de règlement des demandes pour les Etats victimes d’accidents. Conformément à l’article X paragraphe 1 de la Convention, cette demande en réparation peut être présentée dans un délai d’un an à compter de la date du dommage ou de l’identification de l’État de lancement responsable. Ce délai s’avère donc relativement court mais il permet d’éviter de rechercher la responsabilité étatique pour des faits commis il y a des décennies, ce qui rendrait le processus tentaculaire et, à terme, peu efficace.
La Commission de règlement des demandes est composée de trois membres (article XV) : un désigné par l’État demandeur, un par l’État de lancement et le Président nommé d’un commun accord par les deux parties. Cette procédure ressemble très exactement à la constitution d’un tribunal arbitral, avec un nombre impair de membres afin que la résolution du litige n’achoppe pas sur une égalité de voix.
Les décisions rendues par la Commission sont publiques et motivées, définitives et obligatoires si les Etats le souhaitent. S’ils ne le souhaitent pas, la Commission rend une sentence définitive qui vaut seulement recommandation, c’est à dire qu’elle ne comporte pas d’obligation juridique directe. La Commission est chargée de déterminer si la demande en réparation est fondée et, le cas échéant, le montant à affecter (article XVIII). Il convient de noter qu’en vertu de l’article XI de la Convention, les Etats victimes peuvent agir en dehors de celle-ci, en exposant leurs prétentions auprès des instances juridictionnelles ou organes administratifs d’un Etat de lancement. Il y a donc un large choix laissé aux parties dans le mode de règlement du différend spatial.
La délicate obligation financière des Etats en cas de dommage
Supposons qu’un dommage particulièrement grave se produise, tel que la destruction d’un satellite par un autre satellite dans l’espace à la suite d’une collision. En dehors du fait que cette collision va entraîner des centaines de débris spatiaux et causer un danger potentiel pour les autres objets spatiaux lancés par l’Homme, habités ou non, comment le montant des réparations est-il calculé? La seule compensation du coût de fabrication de l’objet? La prise en compte des futurs dégâts potentiels causés par cette collision ? Si cette collision est le fruit d’une négligence ou pire, d’un acte délibéré, l’indemnisation sera-t-elle conséquente ? L’article XII de la Convention de 1972 permet d’éclairer ce type de situation, véritable casse-tête juridique.
Ainsi, le montant de la réparation que l’État de lancement devra payer pour le dommage créé doit être « de nature à rétablir la personne, physique ou morale, l’État ou l’organisation internationale demandeur dans la situation qui aurait existé si le dommage ne s’était pas produit ». Autrement dit, si un satellite a coûté 200 millions de dollars, la réparation sur la base de la Convention atteindra le montant hypothétique de 200 millions de dollars. Si des dommages sont présents au sol, il est possible de s’imaginer que le montant augmentera pour couvrir les coûts de reconstruction d’éventuelles infrastructures affectées.
Le montant de cette réparation sera également déterminé, non en application d’un quelconque droit national, mais en référence au droit international, avec la prise en compte des principes de justice et d’équité. A nouveau, si les parties décident de ne pas recourir à la Convention de 1972 au profit d’un arbitrage, le montant attribué pour les dommages pourrait s’avérer bien plus important, jouant ainsi en défaveur de l’attractivité financière du système de réparation de la Convention.
| Image de l’Opération Morning Light, nom donné aux recherches de débris de Cosmos 954, satellite espion de l’Union soviétique tristement célèbre pour être le premier incident spatial nucléaire de l’Histoire. Entré dans l’atmosphère le 24 janvier 1978 au-dessus du Canada, il déclencha des recherches de débris nucléaires sur le sol canadien à l’aide de compteurs Geiger pour mesurer la radioactivité. Crédit photo : Gouvernement fédéral des Etats-Unis. |
Le droit spatial considère également que la responsabilité financière et générale incombe à l’État de lancement. Celle-ci est en théorie sans exonération possible et sans limite de montant ou de délai.
En définitive, la Convention de 1972 sur la responsabilité n’a malheureusement que très peu servi. Il faut citer, en guise d’exemple, le cas du satellite soviétique Cosmos 954 qui, en 1978, a causé des chutes de débris sur le territoire canadien (la photographie ci-dessus montre les recherches de débris). Un accord entre l’URSS et Canada fut alors conclu le 2 avril 1981 avec un montant de réparation couvrant la chute de matériel radioactif et le coût des recherches de celui-ci. A défaut de l’institution d’une véritable Cour spécialisée dans le règlement des litiges spatiaux, il est pour l’heure difficile de dégager une jurisprudence constante sur la responsabilité des Etats dans les activités spatiales.
Pour aller plus loin :
Simone Courteix, «Droit de l’espace », Répertoire de droit international, décembre 1998.
Mireille Couston, Droit spatial, Paris, Editions Ellipse, 2014.
Armel Kerrest,« Actualités du droit de l’espace : la responsabilité des Etats du fait de la destruction de satellites dans l’espace », Annuaire français de droit international, 2009, n’55.
« Israël s’apprête à lancer une mission vers la Lune », Courrier International, 21 février 2019.
Notes
| ↑1 | En droit français des contrats, la faute est dite lourde si elle s’avère particulièrement grave, résultant du comportement du débiteur, à savoir celui à qui revient l’exécution de la prestation, qui adopte un comportement insouciant, irresponsable. |