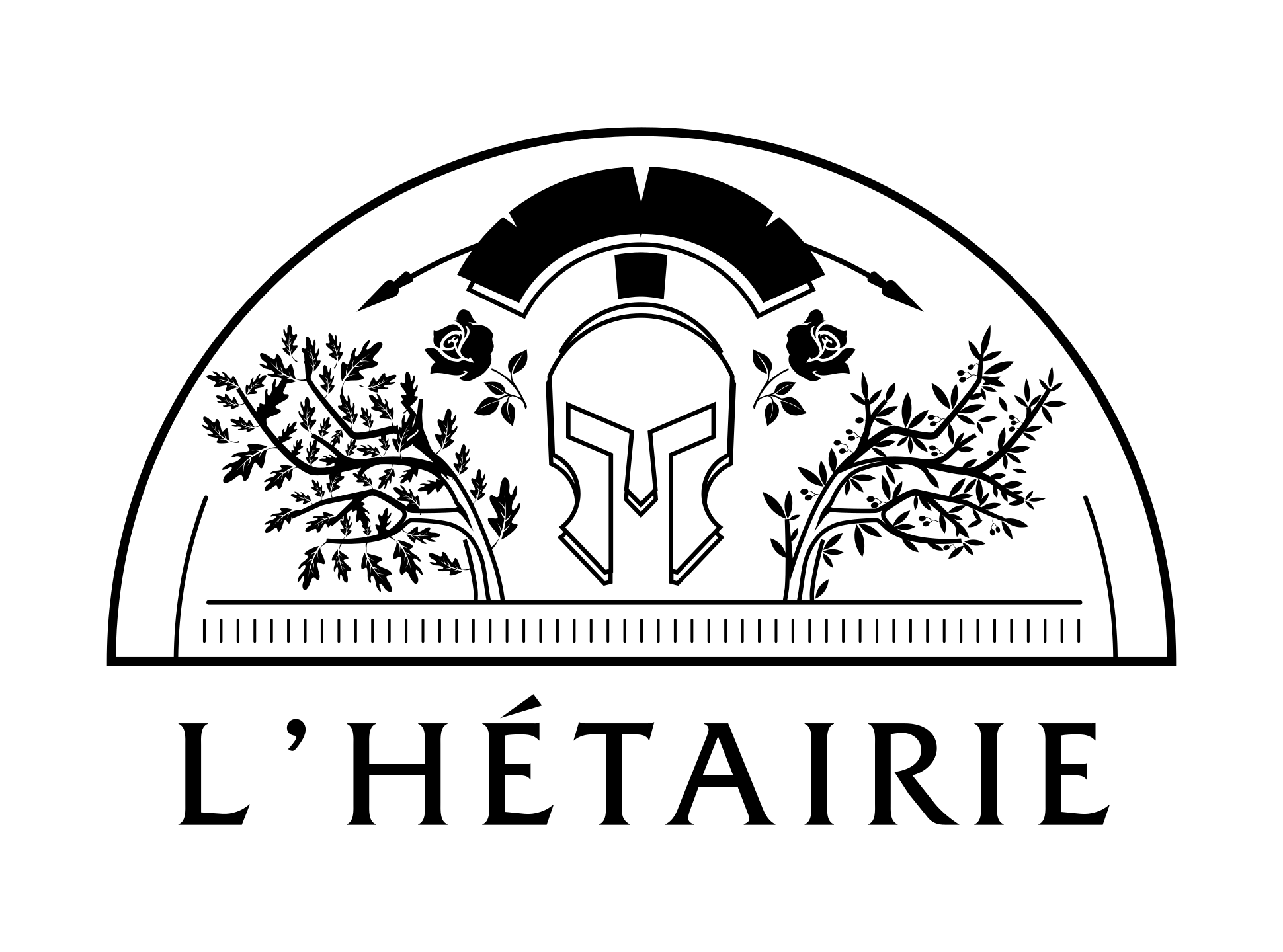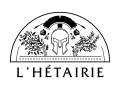Les ravages d’un mal indolore : encadrer les risques liés au bruit [Tribune #29]
Dans les entreprises, les salariés font-ils l’objet de sensibilisation au risque de l’exposition au bruit pour leur santé ? Cette question concerne nombre d’acteurs : préventeurs, professionnels de la santé, dirigeants, etc. Or, pour l’aborder il est nécessaire de distinguer :
- les bruits lésionnels, au-delà de 80 dB(A) pour un bruit continu ou 135 dB(C) pour un bruit impulsionnel ; on les retrouve dans le secteur industriel ou dans le BTP ;
- des bruits gênants non lésionnels, autour de 50-60 dB(A), qu’on retrouve dans le secteur tertiaire (les bureaux).
Le cas du secteur industriel
Dans le secteur industriel, il existe une réglementation[1] Directive européenne 2003/10/CE du 6 février 2003 transposée en droit français par le décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006.) qui fait preuve de précision tant du point de vue de l’évaluation des risques que des actions de prévention à mettre en place par l’employeur. Le volet sensibilisation est également cité par le Code du travail (article L. 4121-2) au travers des principes généraux de prévention. En l’occurrence, la réglementation prévoit que l’employeur :
- consulte et fasse participer les travailleurs à l’évaluation des risques, aux mesures de réduction et, si besoin, au choix des protecteurs individuels contre le bruit (PICB) quel que soit le niveau de bruit subi par le salarié ;
- forme et informe les travailleurs sur les risques, les résultats de l’évaluation et l’utilisation des PICB lorsque le niveau de bruit dépasse la valeur d’exposition de 80 dB(A) pour un bruit continu (ou 135 dB(C) pour un bruit impulsionnel).
Si l’on se réfère au nombre de déclarations des maladies professionnelles en lien avec le bruit (tableau 42 du régime général de la sécurité sociale), on observe une baisse lente mais régulière depuis 2003 (année où l’on a ajouté un certain nombre de professions dans la liste des activités à risque). Il existe des facteurs multiples à l’origine de ces progrès, les mesures de prévention en font partie et semblent donc être objectivement efficaces.
Cependant, ce nombre de déclarations est encore trop élevé (704 en 2016). On estime également que le nombre de personnes atteintes de surdité professionnelle est bien plus important que le nombre de déclarations réelles. Et dans ce contexte, la question du déficit de sensibilisation est cruciale.
Un déficit de perception du risque lié à une exposition sonore à niveau élevé existe dans la population active (comme dans la population en général, à l’instar des adolescents qui s’exposent à des niveaux de musique très élevés sous leur casque d’écoute ou dans les salles de concert). Pourquoi ?
- Sans doute parce que le bruit ne fait pas mal, et qu’on ne se rend pas immédiatement compte de ses effets nocifs (de la même manière que pour une exposition à un produit toxique inodore). Les dégâts se constatent trop tardivement alors que des pertes auditives irréversibles sont à déplorer.
- De plus, il existe dans la population en général, un déni de ses propres pertes auditives. Il est en effet difficile d’accepter et d’évoquer ses difficultés d’audition, sauf quand elles sont flagrantes. On préfère cacher son handicap et se recroqueviller sur soi plutôt que de le reconnaitre. Le même phénomène se produit dans l’environnement professionnel avec peut-être en plus la peur de perdre son emploi.
Il reste donc un long chemin à parcourir pour sensibiliser les salariés exposés au bruit et l’on pourrait s’inspirer des actions de l’association JNA (Journée Nationale de l’Audition) qui réalise un important travail auprès du grand public (mobilisation des professionnels, sensibilisation du public, actions de dépistage).
Le cas du secteur tertiaire
Dans le secteur tertiaire, le contexte s’avère totalement différent. Les niveaux sonores rencontrés dans les bureaux ne sont pas lésionnels car ils se situent majoritairement entre 50 et 60 dB(A). Pour de tels niveaux sonores, l’oreille interne ne subit pas de dommage. Mais le risque se fait plus sournois, car tout se passe au niveau cognitif. En effet, la conjugaison d’une activité qui nécessite de la concentration et d’une exposition aux bruits de parole génère une gêne, une fatigue cognitive qui, sur le long terme, peut avoir des conséquences sur la qualité du sommeil, le stress, etc.
En dépit du consensus sur ces effets (les enquêtes de terrain et les travaux en laboratoire en attestent), aucune réglementation n’existe pour protéger les salariés. La raison tient sans doute au fait que la notion de gêne sonore ou de fatigue cognitive est difficile à objectiver. Néanmoins, de nombreux travaux scientifiques montrent l’existence d’interactions entre les bruits de parole et les tâches réalisées dans les bureaux.
Depuis quelques années, les acousticiens tirent le signal d’alarme et s’engagent pour faire évoluer les normes. Sur le terrain de la prévention, les experts se mobilisent pour que des actions se mettent en place, en particulier des actions de sensibilisation auprès des spécialistes de santé et des employeurs. Une norme française a vu le jour en 2016 spécifiquement sur ce sujet (NF S31-199). Elle préconise une démarche d’évaluation des risques et des recommandations pour la conception et l’aménagement des bureaux.
Les experts français défendent aujourd’hui cette norme au niveau international pour rendre applicables ses principes généraux dans tous les pays du monde et éviter un déséquilibre des conditions de travail, par exemple entre les centres d’appels en France et ceux dans des pays où le droit du travail est beaucoup plus lâche.
En outre, l’INRS et l’ensemble des Carsat sont en première ligne afin d’aider les entreprises à améliorer les situations existantes, mais aussi afin de préconiser des aménagements intérieurs pour de nouveaux locaux. Ils œuvrent à l’information des employeurs de leur possibilité de s’appuyer sur la norme N S 31-199, former les services de santé au travail, sensibiliser les employés sur les usages des espaces ouverts, etc. On le comprend aisément, la tâche s’avère compliquée car les relais dans les moyennes ou petites entreprises sont peu formés, trop peu nombreux et n’ont pas assez de poids face aux contraintes économiques.
Il faut ajouter à cela que le travail en bureau ouvert connaît une mutation permanente avec l’apparition de nouveaux modes d’organisation comme le flex-office ou les espaces de co-working pour lesquels différentes activités se mêlent, y compris certaines activités de détente : espace de restauration, espace de jeu, de repos. Pour ces nouveaux modes de travail, le bruit ne fait guère figure de priorité. Des zones de retrait sont parfois prévues (souvent très petites) pour que les salariés à la recherche de concentration puissent travailler dans le calme. On constate donc que le salarié doit chercher l’environnement sonore qui correspond à son travail alors qu’il faudrait adapter l’environnement sonore à son activité.
Pour finir, le manque de réglementation laisse entrer dans l’entreprise une myriade de gadgets technologiques, plus ou moins validés, qui prétendent apporter plus de confort aux salariés ou plus de rentabilité pour les entreprises. En réalité, les fabricants s’engouffrent dans le vide juridique au détriment des entreprises (ces systèmes sont souvent chers et leur efficacité n’est pas prouvée) et des salariés (ils servent de cobayes à des expérimentations in vivo). On pense par exemple aux systèmes de masquage sonore qui commencent à se répandre dans les entreprises en France et dont l’efficacité n’a pas été démontrée à ce jour.
Ainsi paraît-il urgent que le législateur s’empare du sujet. Une réglementation, si elle devait être mise en place, servirait de point d’ancrage aux actions de sensibilisation à destination des préventeurs, des dirigeants et des salariés, comme cela a été le cas pour les bruits industriels.
Notes
| ↑1 | Directive européenne 2003/10/CE du 6 février 2003 transposée en droit français par le décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006. |