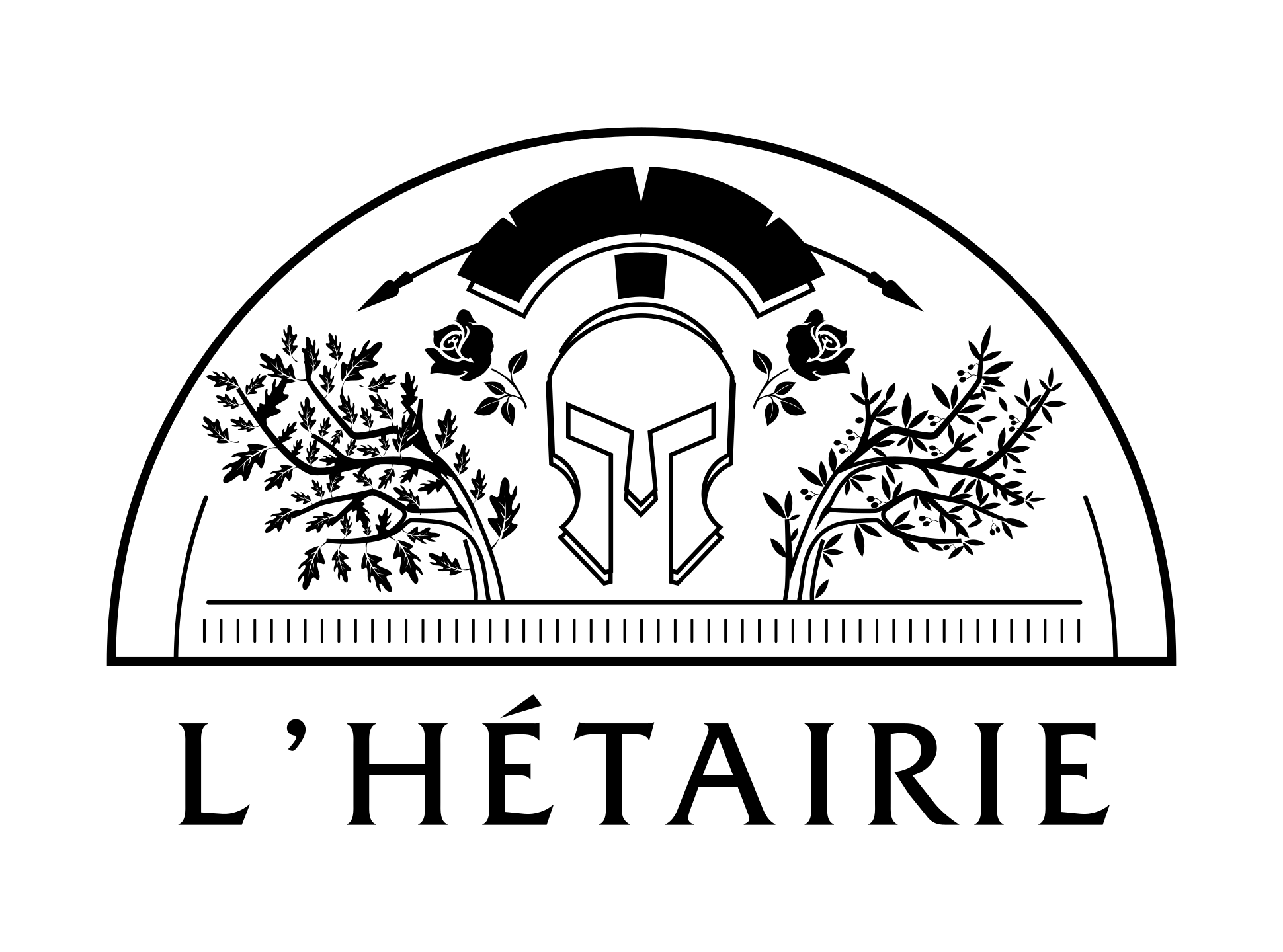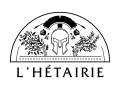COVID-19 : Nous ne pourrons tirer les leçons de la crise qu’à l’échelle européenne ! [Note #70]
« L’Union européenne est le premier mort du coronavirus ! ». Cette phrase lapidaire a marqué l’ouverture des hostilités par Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National, le mardi 24 mars dernier. Or l’offensive interroge, non pas la ligne politique habituelle du RN, visant à frapper l’Union européenne, source supposée unique de tous les maux des nations et des peuples du Vieux Continent ; elle interroge l’absence stratégique et médiatique de l’Union européenne, malgré le caractère sans précédent de la crise sanitaire que nous traversons. L’UE sortira-t-elle exsangue de cet épisode ou, au contraire, la pandémie va-t-elle entraîner un renouveau de la strate européenne ? Ceux qui croient en l’idéal européen sont en droit d’espérer des mesures résolues pour contrebalancer les errements constatés.
L’Europe dans la crise
La fermeture historique des frontières extérieures de l’Union européenne pour une durée d’un mois, décidée par le Conseil européen du 17 mars dernier, puis celle – tout aussi historique – des frontières nationales, ont constitué les mesures les plus marquantes pour tenter d’endiguer l’épidémie qui déferle sur le Vieux Continent. A leur suite, la majorité des 27 Etats membres ont peu à peu, et selon des modalités différentes, acté le confinement des populations. Et précisément, les mesures prises pour lutter contre l’épidémie n’ont guère fait l’objet d’une concertation à l’échelon supranational. En ont résulté des mesures très disparates d’un pays à l’autre, ajoutant de la confusion à la confusion. Citons par exemple l’Italie qui, dès le 11 mars, a établi un confinement généralisé de sa population, ouvrant la voie à la France 6 jours plus tard, puis à l’Espagne. Citons encore le calfeutrage de la Slovaquie fermant ses frontières à tous les pays, sauf la Pologne… Cette gestion erratique est également le fruit, à n’en pas douter, d’une impréparation massive des pays européens qui, sous le coup d’un vent de panique, décrétèrent des mesures d’exception sans même envisager une résolution globale à l’échelle de l’UE, niveau pourtant a priori plus efficace pour agir dans le cas d’une pandémie mondiale.
Une capacité fictive de coordination
Pourtant, l’article 168 du TFUE[1]TFUE : Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, signé à Rome en 1957 (acte fondateur de la Communauté Economique Européenne), qui s’est enrichi d’autres traités … Continue reading, mentionne les compétences de l’Union en matière de santé publique : « l’action de l’Union, qui complète les politiques nationales, porte sur l’amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé physique et mentale. Cette action comprend également la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention […] ainsi que la surveillance de menaces transfrontalières graves sur la santé, l’alerte en cas de menaces et la lutte contre celles-ci ».
Si l’UE intervient en complément de l’action des Etats – la santé publique étant une compétence partagée – l’Europe n’en garde pas moins un rôle de coordination, selon ce même article 168 : « Les Etats membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en contact étroit avec les Etats membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination, notamment des initiatives en vue d’établir des orientations et des indicateurs, d’organiser l’échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l’information périodiques ». La Commission européenne et le Parlement européen disposent donc de compétences même si le texte des traités apparaît extrêmement flou sur la réalité de leurs marges de manœuvre. L’action de l’UE répond, en l’espèce, à un rapport de force politique.
En effet, la capacité de la Commission et du Parlement à influer sur la coordination des politiques nationales est fonction de leur poids politique du moment, en partie lié à l’envergure des personnalités politiques qui les dirigent. A ce titre, on regrettera à nouveau l’action résolue des États – France incluse – pour maintenir la primauté du Conseil Européen sur les autres institutions de l’Union. Le renoncement au principe du « Spintzekandidat » à l’issue des élections européennes de mai 2019 n’en incarnait que le dernier avatar[2] Cf. la tribune d’Alexandre Riou pour L’Hétairie, 16 juillet 2019. .
De fait, si théoriquement l’Union européenne dispose de quelques moyens d’agir, à défaut d’un poids politique que les Etats auraient pu lui conférer, l’UE demeure très largement inter-gouvernementale et son architecture institutionnelle ne la prépare que très imparfaitement à la gestion de crises. Cet épisode établit clairement la nécessité de renforcer les compétences d’action en matière de santé. S’inspirant des lois fédérales adoptées dans la lutte face au crime aux États-Unis dans les années 1920-1930, on pourrait imaginer une coordination renforcée au niveau européen dès lors qu’une crise sanitaire touche plus de trois États. L’autorité européenne serait alors chargée de superviser le plan d’action et de coordonner la gestion de la crise, de distribuer les moyens nécessaires à l’endiguement de l’épidémie et de s’assurer des transferts d’informations entre les différentes agences et autorités nationales.
Une logique de « chacun pour soi », faillite de l’idéal européen
Pis encore, le manque de solidarité[3] Outre le fait qu’il s’agisse d’un des piliers du projet européen, une « clause de solidarité » figure très concrètement au sein de l’article 222 du TFUE. Celle-ci offre à … Continue reading entre les Etats laissera à n’en pas douter des stigmates. On pense notamment au refus de l’Allemagne de livrer du matériel sanitaire (respirateurs, masques) à une Italie dans une situation absolument catastrophique et hors de contrôle. L’Europe, si elle se définit toujours comme une « communauté de destins » a, sur ce point, failli à cette promesse fondamentale.
Au-delà de la manifestation de l’impréparation des États face à la propagation de l’épidémie, qu’ils ont très majoritairement longtemps cru pouvoir circonscrire hors de leurs frontières, cette attitude témoigne de la persistance des réflexes – voire des égoïsmes – nationaux, au détriment de l’intérêt général. Les épisodes plus récents de réquisition de masques ou de matériels sanitaires lors de leur transit vers un autre État s’ajoutent à ce constat.
A l’inverse, certains Länder ont accepté le transfert de patients lourdement atteints vers des hôpitaux allemands pour soulager la pression pesant sur les hôpitaux français puis italiens les plus touchés.
De louables mesures d’urgence
Bien que peu relayées médiatiquement, les institutions européennes ont cependant agi en édictant une batterie de mesures économiques et financières. Ces actions ont rencontré l’injustifiable réticence de plusieurs États, preuve du besoin de clarification des compétences respectives mais également de l’idéal européen supposément partagé.
En premier lieu, la Commission européenne a débloqué un plan de financement d’urgence de 37 milliards d’euros, adopté par le Parlement européen le jeudi 26 mars dernier. Ce plan vise à utiliser des fonds européens versés aux États, dont la partie non utilisée doit habituellement être reversée à la Commission. À titre exceptionnel, les États peuvent garder ces sommes, représentant 8 milliards d’euros au total, pour les flécher vers du soutien à la reprise. En outre, 29 milliards d’euros issus d’un cofinancement du budget de l’UE complètent ce dispositif pour un total de 37 milliards d’euros.
Par ailleurs, le jeudi 2 avril, la Présidente de la Commission européenne, Ursula Van der Leyen a fustigé les défaillances de plusieurs dirigeants européens : « beaucoup trop n’ont pensé qu’à leurs problèmes nationaux » plutôt qu’à la solidarité européenne. Elle a aussi admis que l’Union européenne n’avait pas suffisamment oeuvré pour apporter des réponses à la hauteur des enjeux de cette situation. C’est pourquoi elle a annoncé 100 milliards d’euros complémentaires, affectés en priorité aux pays les plus durement touchés (Italie et Espagne) à la fois par l’épidémie et par les défaillances de l’UE dans sa réponse à la crise, pour compenser les baisses de revenus les plus criantes.
Au surplus, lors de sa dernière session[4] Session de mars 2020., le Parlement européen a approuvé des mesures complémentaires telles que la possibilité pour les États de demander le soutien du Fonds de solidarité de l’UE[5] Le Fonds de solidarité de l’UE, créé en 2002 à la suite des importantes inondations survenues en Europe centrale a pour objectif de fournir un soutien financier uniquement aux États … Continue reading, ce qui constitue une première pour une crise d’ordre sanitaire !
Cependant, c’est du côté de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et de la Banque Centrale Européenne (BCE) que les mesures les plus fortes ont été prises. La BEI a ainsi établi un plan qui mobilise près de 40 milliards d’euros de financements. Ce dispositif se décline en 3 axes :
- Des programmes de garantie spécifiques pour les banques en s’adossant à des programmes existants afin de déployer 20 milliards d’euros.
- Un fonds de 10 milliards d’euros pour soutenir les fonds de roulement des PME/ETI.
- Des opérations financières d’acquisition de titres adossés à des actifs pour permettre aux banques un transfert de risque sur des portefeuilles vers les PME pour obtenir 10 milliards supplémentaires.
L’énoncé de ces mesures et les montants évoqués dissuadent d’affirmer que l’UE est restée sans agir. On pourra néanmoins objecter que :
- elle a tardé dans sa réponse, ce qui a sans doute amplifié la propension des États à tenter de gérer la crise de leur côté ;
- les mesures d’urgence prises, si elles ont le mérite d’exister, ne se haussent pas à la hauteur des enjeux de la crise et de ses conséquences sur le long terme. À ce titre, les mesures de soutien transitant par la BEI ou par le Mécanisme Européen de Stabilité (MES) ne s’avèrent pas pleinement satisfaisantes puisqu’il s’agit de concours remboursables pour des États qui peinent déjà à réaliser les investissements publics nécessaires. Si le passage par une cure d’austérité doit résulter de cet endettement supplémentaire, le redémarrage s’avérera très difficile, voire impossible.
C’est pourquoi la réaction de la Banque Centrale Européenne était attendue, après les déclarations de sa présidente qui a finalement décidé d’agir pour garder la situation sous contrôle. En effet, le 12 mars dernier, Christine Lagarde a de manière très peu opportune déclaré qu’il n’incombait pas à la BCE de « réduire les spreads[6] Les « spreads » désignent les écarts de valorisation des dettes publiques des États membres sur les marchés financiers. » avant d’immédiatement tempérer ses propos face à la forte augmentation des rendements des emprunts d’État italiens en réaction, faisant planer le spectre d’une nouvelle crise des dettes publiques de la zone euro.
Ce commentaire, s’il est conforme au rôle que les économistes orthodoxes et libéraux confèrent avec succès à la Banque depuis les années 1990, n’était clairement pas à la hauteur de la gravité de la situation. Par conséquent, la BCE a lancé dès la semaine suivante un programme d’achat d’obligations (le Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) de 750 milliards d’euros (6% du PIB européen), portant ainsi à 1 100 milliards ses achats d’actifs pour 2020. En annonçant qu’elle orientera ses achats en priorité vers l’Italie et les autres États en difficulté et en y incluant les titres grecs (exclus des précédents programmes d’achat d’obligations de la BCE), la Banque centrale entend décourager la spéculation et prévenir la résurgence d’une crise de la dette.
Il faut saluer cette inflexion avec le dogme, qui rompt avec l’orthodoxie habituelle. Si la BCE avait réagi avec la même rapidité lors de la crise financière de 2008-2009, les conséquences sur les dettes souveraines des États européens et sur l’économie réelle en auraient sans doute été amoindries. S’il faut donc saluer ce progrès, il n’en reste pas moins cantonné à des mesures d’urgence qui ne règlent aucune des questions qui vont se poser en sortie de crise.
Enfin, le Conseil européen a trouvé un accord, vendredi 10 avril, sur un fonds de réserve de 500 milliards d’euros, disponibles via le Mécanisme européen de stabilité (MES)[7] Créé en 2012 lors de la crise de la dette de la zone euro. qui va octroyer des lignes de crédit « de précaution » aux pays les plus touchés par la crise, sans les conditionnalités habituellement associées à ce type de financement. Concrètement, cette somme ne sera donc pas versée immédiatement mais disponible pour les États demandeurs. Ce faisant, elle est davantage destinée à rassurer les marchés qu’à organiser la solidarité des États membres et la reconstruction. C’est la grande limite de la réponse européenne à la crise. Certains semblent avoir redécouvert que convergence et solidarité devaient aller de pair, mais cette dernière valeur demeure fortement encadrée et soumise à des restrictions temporelles et volumétriques qui limitent son impact.
En substance, la gestion de la crise à l’échelle européenne ne s’est pas révélée optimale. Dans un premier temps, elle a été marquée par des tensions et concurrence nationales, en l’absence d’une coordination de la réponse sanitaire, économique et sociale à la pandémie. Néanmoins, dans un second temps, des mesures ont été prises de manière réactive pour assurer la solidarité de l’Union avec ses États membres les plus touchés sur le plan sanitaire et pour tenter d’endiguer la contagion de cette crise à la sphère financière. Mais il s’agit de mesures d’urgence qui, bien que nécessaires, ne permettront à elles seules ni de régler la crise, ni de faire face à ses conséquences lorsque le déconfinement sera progressivement mis en place et que l’épidémie reculera. Il s’avère donc urgent, en parallèle de la gestion de crise, de préparer la sortie de crise pour en amortir les conséquences. Il faudra alors mettre en œuvre un véritable changement de paradigme, pour panser les plaies révélées par la pandémie et mieux protéger l’Europe face à la possible récurrence de ce type d’épisodes.
Panser la crise, penser l’Europe
À ce stade, deux visions du monde fourbissent leurs armes pour imposer un scénario d’après-crise :
- La première est issue de l’alliance de la droite libérale et de la droite autoritaire, de plus en plus incarnée en France par La République En Marche. Sous couvert d’une « France Unie » pour sa reconstruction post-pandémie, des efforts continueront d’être demandés aux Français sommés d’accepter la remise en cause de leurs libertés fondamentales et des conquêtes sociales du XXe siècle.
- La seconde, alliance du nationalisme et du populisme, fera à travers cette crise le procès d’un monde ouvert, imposant comme seule solution celle de la fermeture hermétique des frontières, comme si la peste ou le choléra avaient attendu la mondialisation pour dévaster l’Europe médiévale et moderne.
Face à ce duel mortifère, il existe un espace politique pour une troisième voie, plus ambitieuse. Elle reste néanmoins à construire. La crise sanitaire bouscule les calendriers politiques préétablis et notre rapport au monde doit être réinterrogé. Face à l’accélération de la mondialisation qui accroît notre dépendance à des économies extérieures, face au défi du changement climatique qui accroît notre vulnérabilité et interroge notre modèle de développement, face au risque d’une récurrence de ces épisodes sanitaires, nous devons reconquérir une part de notre souveraineté économique.
Une telle trajectoire suppose des choix courageux, dont les conséquences seront moins lourdes si elle est menée à l’échelle européenne. Cette crise offre ainsi l’occasion de revenir aux sources de ce que fut la construction européenne. En effet, bien avant qu’elle ne se transforme en une vaste zone de libre-échange sous l’influence des puissances exportatrices et du Royaume-Uni, l’Europe des pères fondateurs fut pensée à la fois comme un espace de solidarité et de protection.
« Coronabonds » ou l’indispensable mutualisation des dettes publiques
Une fois passée l’urgence sanitaire, l’une des priorités consistera à assurer le rebond économique et amortir les chocs sociaux dans la majeure partie des États membres, touchés à divers degrés par le Covid-19. Or, contrairement à une idée largement répandue, le rebond n’a rien d’évident. La crise sanitaire et particulièrement les mesures de confinement de la population mises en place pour lutter contre le coronavirus vont générer des effets destructeurs sur l’économie. Rappelons que pour la France, l’OFCE évalue le coût mensuel du confinement à 60 milliards d’euros, soit 3% du PIB annuel.
Cette décroissance prend place dans un environnement économique déjà dégradé, avec des niveaux de dette publique – mais également de dette privée – importants. Le « monde d’après » cumulera ainsi beaucoup de dettes mais peu de ressources. Dans nombre de secteurs fortement pénalisés par le ralentissement, voire l’arrêt de l’activité économique, l’activité perdue ne se rattrapera pas (service à la personne ou tourisme par exemple). De fait, les ménages, qui pour certains auront perdu de l’argent en raison de la fin de leur activité ou de leur mise au chômage partiel, ne seront probablement pas saisis d’une frénésie consumériste. La peur générée par le virus et ses conséquences peuvent ainsi conduire à la constitution d’une épargne de précaution, pour ceux qui en auront la capacité.
Face au risque financier et bancaire, la Banque Centrale Européenne a agi comme elle le devait. Pour l’heure, le risque d’une crise immédiate de liquidités et d’une contagion de la crise au système financier semble écarté, ce qui ne réduit pas à néant ce risque pour les mois ou années à venir. Pour autant, la politique monétaire ne contribue guère à stimuler la dépense privée : la BCE peut fort bien accroître les possibilités de refinancement des banques et faciliter l’accès au crédit, encore faut-il que les acteurs économiques y aient recours. Par conséquent, c’est bien de dépense publique – par l’investissement – dont nous avons besoin et c’est l’arme budgétaire qu’il convient d’actionner.
Dès lors, il paraît évident, car le mouvement est déjà largement amorcé, que les États vont devoir s’endetter dans des proportions qui dépassent largement les ratios de PIB généralement admis (et déjà assouplis par la Commission). Compte tenu de ce que la zone euro demeure une zone monétaire incomplète, le risque reste élevé de voir le besoin d’endettement des États faire resurgir le spectre d’un éclatement de la zone euro. Car l’un des principaux problèmes réside dans ce que chaque émission nationale de titres de dette publique, bien qu’utilisant la même monnaie, ne bénéficie pas des mêmes taux fixés par les marchés financiers. Ce sont les fameux spreads, ou écarts de taux. Ainsi, au 1er avril, l’Italie se finançait-elle à 1,69% lorsque l’Allemagne pouvait émettre au taux négatif de – 0,39%.
L’unique solution qui permette aux États européens de recourir dans les mêmes conditions à l’émission de dette publique pour financer les investissements nécessaires à la reprise consiste donc en une mutualisation de la dette des États membres de la zone euro qui irait de pair avec une annulation partielle de la dette.
Dans les faits, il s’agirait, pour la Banque Centrale Européenne, d’émettre des « coronabonds », c’est-à-dire des titres de dette publique qui ne seraient pas allemands, français, grecs ou italiens mais européens, et d’en reverser ensuite le produit aux États. On le sait, pour des raisons à la fois historiques et culturelles, l’Allemagne et un certain nombre de pays d’Europe du Nord sont généralement opposés à une mutualisation des dettes, et mettent en avant l’argument de l’aléa moral (le procédé encouragerait la mauvaise gestion car celle-ci ne serait plus sanctionnée par un taux d’emprunt). Si l’argument pouvait s’entendre – bien que nous le réfutions – pour la crise de 2008, il se révèle particulièrement inopérant cette fois-ci, puisqu’aucun État n’est responsable de l’épidémie. Au surplus, les décisions du Conseil des gouverneurs de la BCE se prennent à la majorité des 2/3 ; par conséquent, il n’est pas nécessaire d’obtenir une unanimité.
L’émission de ces « coronabonds » s’avère essentielle car elle seule permettra aux États de disposer des ressources budgétaires suffisantes pour stimuler, par l’investissement public, le rebond de l’économie et apaiser les chocs sociaux.
Pour une relocalisation industrielle à l’échelle européenne
La crise sanitaire a mis en relief l’extrême dépendance de nos économies aux échanges internationaux. La mondialisation a connu une accélération ces 20 à 30 dernières années mais également un changement de nature puisqu’à l’internationalisation des échanges s’est ajoutée la délocalisation des unités de production, dans une logique de rationalisation des coûts. Or, la crise actuelle du coronavirus met cruellement en lumière la dépendance flagrante et dangereuse que nous entretenons notamment vis-à-vis de l’Asie et plus spécifiquement de la Chine. Une dépendance d’autant plus néfaste que la Chine exploite cette crise à des fins de propagande et de démonstration de force sur la scène internationale, afin d’apparaître comme la nouvelle superpuissance planétaire venant en aide aux puissances « occidentales vieillissantes et sur le déclin ». Face au désaveu stratégique que nous vivons aujourd’hui, force est de constater l’échec européen, par manque de volonté politique, à maintenir sur le sol européen les entreprises a minima stratégiques permettant de faire face à une de crise majeure.
Afin d’assurer nos besoins stratégiques, s’impose une relocalisation sur le territoire de l’Union européenne de nos productions. Cette relocalisation n’entre pas en contradiction avec la notion d’échange ni même avec le commerce international ; il ne s’agit pas d’une mesure protectionniste (nous continuerions à commercer, à échanger). L’objectif consiste simplement à maintenir sur notre continent, les savoir-faire et les capacités productives qui permettent d’assurer notre souveraineté économique et de mobiliser, en cas de crise, notre tissu industriel afin de subvenir à nos besoins. C’est une mesure de salubrité publique et d’indépendance stratégique. Du reste, elle répond à une évolution antérieure à la crise où, à la faveur de la guerre commerciale qui les oppose, les États-Unis et la Chine avaient amorcé ce mouvement de réinternalisation, sans que l’Europe n’ajuste sa stratégie. La crise sanitaire nous donne cette opportunité, sans quoi l’Europe deviendrait le terrain de jeu des deux géants.
Pour ne pas contrevenir aux principes de solidarité précédemment énoncés et prévenir la concurrence interne à l’installation des industries concernées, cette orientation suppose une harmonisation ambitieuse de la fiscalité des entreprises, ou à tout le moins des entreprises industrielles. Elle présente aussi l’avantage de proposer une véritable relance industrielle de l’Europe, une source de création d’emplois qui apparaît également comme un des enjeux majeurs de l’après-crise.
Elle implique aussi très probablement de faire évoluer notre politique commerciale. Lors de la création de la CEE (Communauté Économique Européenne), elle avait pour objectif, atteint progressivement entre 1958 et 1968, de supprimer les droits de douane à l’intérieur de ses frontières afin de faciliter les échanges intra-communautaires. Cette politique présentait un corollaire : la fixation d’un tarif extérieur commun, des droits de douanes harmonisés aux frontières extérieures de la CEE. Cette conception originelle s’est peu à peu effritée. Dans le cadre des négociations commerciales internationales sous l’égide du GATT puis de l’OMC, la CEE s’est révélée plus libérale que ses partenaires sur la réduction internationale des droits de douane. Il faut revenir à cet esprit originel de réciprocité de la politique commerciale. Une telle mesure emporterait très certainement des conséquences sur notre consommation et sur une partie de nos exportations, mais elle est une condition de la protection de nos industries. Elle doit s’accompagner, en particulier, d’un ajustement carbone à nos frontières, pour tenir compte des conditions environnementales de production et d’échanges.
Quoiqu’il en soit, cette redynamisation du tissu productif européen ne pourra s’opérer qu’avec un investissement public soutenu et au prix d’un effort budgétaire non négligeable, qui confirme l’importance de l’aspect monétaire précédemment évoqué.
Vers un renouveau de l’intervention publique.
La crise nous invite à revoir également de manière urgente l’ordre de nos priorités, et à soutenir la relance de l’économie par une valorisation méritée de tous les travailleurs exerçant une profession à haute utilité sociale : travailleurs – du secteur public comme du secteur privé – les moins rémunérés, ceux qui se situent en bas de l’échelle sociale. Aussi, la réussite d’éventuels plans de relance passera-t-elle par une politique durable de soutien à l’emploi.
La crise nous invite, enfin, à un changement de pied radical dans les politiques qui ont inspiré la plupart des États du monde et pénétré fortement les institutions européennes depuis les années 1980 et l’avènement du néolibéralisme (dans le sillage des victoires de Ronald Reagan aux États-Unis et de Margareth Thatcher au Royaume-Uni). Le dogme de l’équilibre budgétaire et de la diminution de la pression fiscale a promu une atrophie de l’État dont on constate les résultats aujourd’hui. Qui peut dire combien de morts auraient été évités si l’Italie, l’Espagne, la France avaient investi plus massivement dans la recherche et dans leurs systèmes de santé ?
Il faut en finir avec le dogme de l’équilibre budgétaire. La monnaie unique impose évidemment une forme de convergence, mais elle doit favoriser des différences de nature des économies entre les États membres et permettre à ceux-ci de réaliser les investissements nécessaires au bon fonctionnement des services publics essentiels comme au financement d’une transition écologique et énergétique ambitieuse. Pour cela, nous appelons à la mise en œuvre d’une véritable planification, à l’échelle des États membres bien sûr, mais surtout à l’échelle européenne. Car certains investissements auront nécessité d’être portés plus largement que par les États seuls. La Commission pourrait, d’autre part, jouer un rôle d’orientation des investissements, dont quelques-uns devraient être exclus des calculs de trajectoire budgétaire des États membres dès lors qu’ils remplissent un objectif servant l’intérêt collectif.
Cette crise doit nous permettre à la fois d’amorcer un virage tangible dans les politiques économiques et sociales conduites depuis plusieurs décennies, tout en renforçant la souveraineté européenne. L’histoire des crises montre que celles-ci peuvent incarner un accélérateur du changement. Cela suppose du courage et la clarté des choix politiques. Nous pouvons refaire de l’Union européenne une communauté de destins où les peuples relèvent ensemble les défis européens et mondiaux auxquels ce siècle des incertitudes nous confronte. L’Europe s’est construite sur des cendres ardentes pour bâtir une paix durable entre des nations déchirées par des siècles de conflits ininterrompus. Saisissons l’opportunité d’une rupture décisive !
Notes
| ↑1 | TFUE : Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, signé à Rome en 1957 (acte fondateur de la Communauté Economique Européenne), qui s’est enrichi d’autres traités complémentaires, jusqu’à celui de Lisbonne en 2007. |
| ↑2 | Cf. la tribune d’Alexandre Riou pour L’Hétairie, 16 juillet 2019. |
| ↑3 | Outre le fait qu’il s’agisse d’un des piliers du projet européen, une « clause de solidarité » figure très concrètement au sein de l’article 222 du TFUE. Celle-ci offre à l’UE et à ses Etats membres la possibilité de « fournir une assistance à un autre pays de l’UE victime d’une catastrophe naturelle ou humaine ». Elle a déjà été appliquée à plusieurs reprises, comme en 2004, lors des attentats de Madrid. |
| ↑4 | Session de mars 2020. |
| ↑5 | Le Fonds de solidarité de l’UE, créé en 2002 à la suite des importantes inondations survenues en Europe centrale a pour objectif de fournir un soutien financier uniquement aux États membres de l’UE faisant face à des catastrophes naturelles. |
| ↑6 | Les « spreads » désignent les écarts de valorisation des dettes publiques des États membres sur les marchés financiers. |
| ↑7 | Créé en 2012 lors de la crise de la dette de la zone euro. |