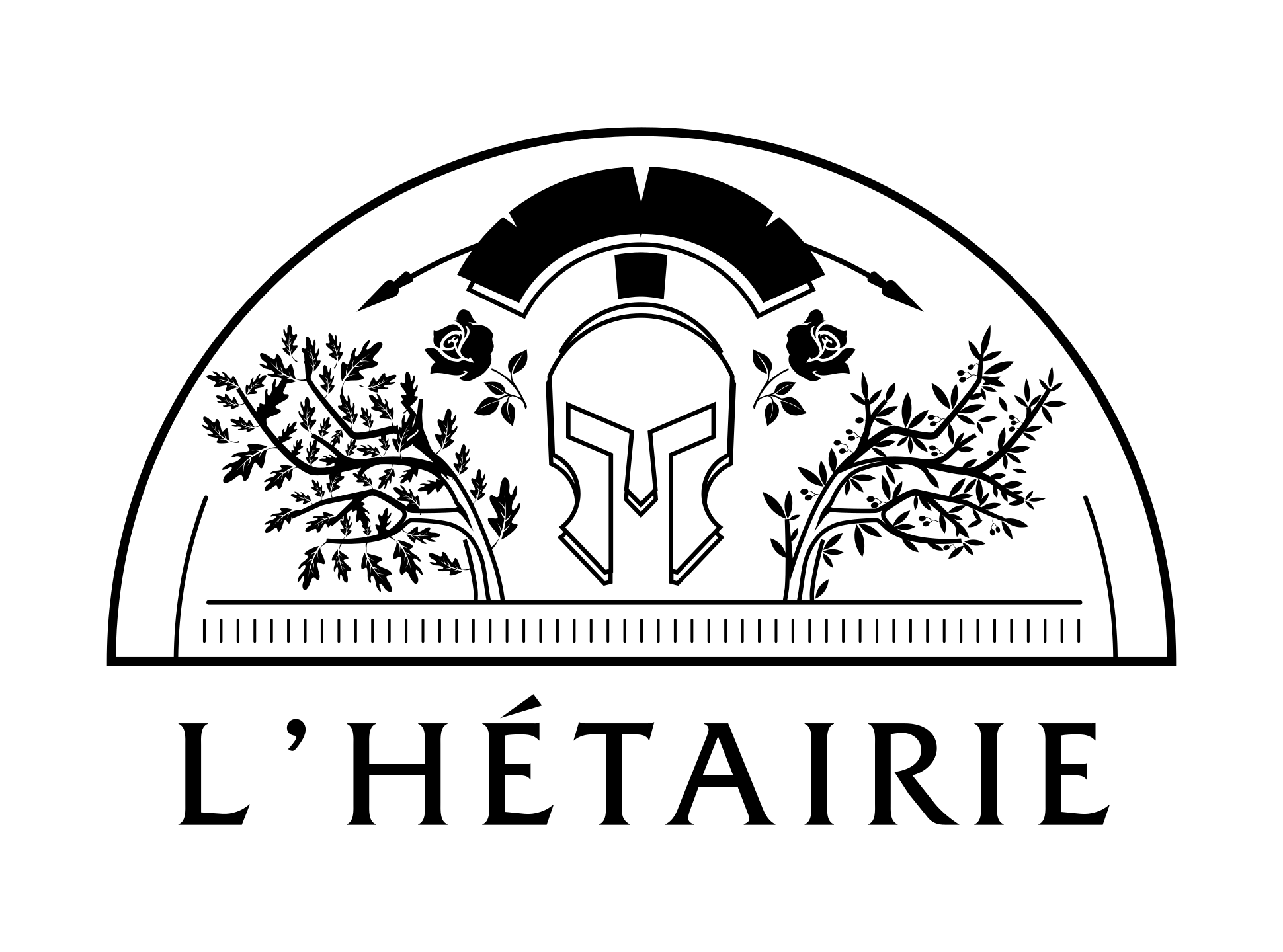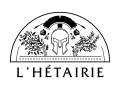Des cendres en héritage : quand l’obsession iranienne des « faucons » du président renoue avec l’aventurisme américain au Moyen-Orient [Note #50]
Au début des années 2000, au nom de la « guerre contre le terrorisme », l’administration Bush entendait justifier un sursaut interventionniste en Asie centrale et au Moyen-Orient. Moins de dix ans plus tard, les Etats-Unis font les frais de leurs errances en ce domaine et des conséquences de la crise financière de 2008 qui ont fragilisé les bases économiques et la légitimité diplomatique d’une « hyperpuissance » contestée.
Par ailleurs, au « leadership en retrait » pratiqué par l’administration Obama, répond un « leadership de rejet » qui conduit l’administration Trump à remettre en cause les engagements contraignants des Etats-Unis dans le monde. Conformément à des promesses de campagne résumées dans le slogan America First, le président ne souhaite plus faire supporter à son pays les coûts financier et humain de la puissance.
Afin de défendre les intérêts supposés de la base électorale qui l’a porté au pouvoir, le président s’est ainsi fait le porte-parole de « l’homme blanc en colère »[1] Marie-Cécile NAVES, Trump, la revanche de l’homme blanc, Paris, Textuel, 2018, 156 p.. Usant de la personnalisation des rapports, de l’outrance rhétorique et de la menace de sanctions, le « perturbateur en chef » entend peser dans les relations internationales qu’il voit comme un jeu à somme nulle dont il entend sortir vainqueur[2]Vincent BOUCHER, « Les réalités parallèles de la politique étrangère de Donald Trump », Les Grands Dossiers de Diplomatie n°50, « Géopolitique des Etats-Unis : renouveau … Continue reading. Ce rejet des cadres et des codes, dont l’efficacité tarde à convaincre, pose d’autant plus de questions que les incertitudes qu’il fait peser sont avivées par les tensions soulevées dans des régions déjà éprouvées par l’aventurisme américain.
Un leadership de rejet
Le 8 mai 2018, le retrait américain de l’accord nucléaire iranien a pu être lu dans le double cadre de la dénonciation de l’héritage Obama et de l’exorcisation des relations tumultueuses entre les deux pays[3]Sylvain GAILLAUD, « De fausses ruptures en retour du refoulé, la politique iranienne de Donald Trump », La Croix, 7-8 mai 2018..
Signé en juillet 2015 par le groupe P5+1 (Etats-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni, Allemagne), le Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) entendait limiter le programme nucléaire iranien pendant une décennie, en échange d’une levée des sanctions internationales et de contrôles renforcés. Avec une outrance langagière devenue sa marque, le président Trump a toujours considéré l’accord nucléaire iranien comme le pire jamais signé. Non seulement le texte n’encadrerait que temporairement la nucléarisation de l’Iran, mais il ne contraindrait en rien la politique régionale de la République islamique, ce qui contribuerait à heurter les intérêts de ses alliés israéliens et saoudiens. D. Trump avait d’ailleurs fait de sa dénonciation l’un de ses principaux thèmes de campagne. Il considère sa destruction comme d’autant plus urgente que s’approchent les échéances présidentielles. Le président a d’ailleurs justifié sa décision de retrait par le prétexte que l’Iran ne respectait pas ses engagements, contrairement aux renseignements de la CIA confirmés par les contrôles de l’Agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA). Car, dans le compromis de Vienne, la procédure dite de « snapback » permettait de réimposer des sanctions seulement en cas de violation des engagements pris par Téhéran.
Condamnée pour la pure forme par les pays partenaires du compromis, la dénonciation s’est donc traduite par le rétablissement de sanctions en deux temps : au début du mois d’août 2018, la première vague entend bloquer les transactions financières, les achats dans les secteurs de l’automobile et de l’aviation commerciale, ainsi que les importations de matières premières. Elle est complétée au mois de novembre par une seconde salve s’attaquant au secteur pétrolier et gazier. Or, avec 10% des réserves mondiales de pétrole, l’Iran dépend fortement des hydrocarbures qui représentent 40 % de ses recettes budgétaires. De fait, ces sanctions entendent non plus seulement empêcher le retour de l’Iran dans les cadres de l’économie mondialisée, mais aussi hypothéquer ses possibilités de développement à moyen terme.
Toutefois, les Etats-Unis accordent des dérogations provisoires à huit pays, autorisés à poursuivre leurs relations commerciales avec la République islamique sans que leurs entreprises ne soient privées du marché américain : la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, l’Italie, la Grèce, la Turquie et Taïwan. Loin de vouloir limiter la rigueur du régime de sanctions, ces « waivers » témoignent du souci de ne pas pénaliser des Etats alliés (à ce titre, les autres parties signataires en sont naturellement exclues). Ils témoignent aussi des risques pour Washington d’une politique justifiée par la défense des intérêts de l’« Amérique d’abord » : à cet égard, la crainte de mesures de rétorsions commerciales par la Chine, à l’heure où l’on ne parle pas encore de « guerre économique » avec Pékin, explique son inclusion dans les pays bénéficiant de dérogations. Mais, six mois plus tard, la suppression de ces « waivers » traduit à la fois une volonté d’approfondissement de la politique dite de « pression maximale » et de la détérioration croissante des relations des Etats-Unis avec leurs partenaires.
Les mesures prises ont été d’autant plus efficaces que leur dimension extraterritoriale a contraint les entreprises à s’y conformer sous le poids d’un véritable chantage économique. De fait, la « ruée vers l’Iran » a été de courte durée : les entreprises françaises qui convoitaient les marchés persans ont rapidement remis en question les investissements programmés dans les secteurs lucratifs de l’équipement et de l’énergie. La mémoire de l’amende infligée au groupe BNP Paribas est restée vivace : en 2015, la banque française avait été condamnée par la justice américaine à payer 8,9 milliards de dollars pour avoir contourné les embargos imposés par les Etats-Unis à Cuba, à l’Iran, au Soudan ou à la Libye, entre 2000 et 2010.
En Iran, cette politique de « pression maximale » a eu les effets économiques escomptés : l’économie devrait être en récession pour la deuxième année consécutive. Selon les derniers chiffres du Fonds monétaire international, le taux d’inflation atteint 40% et le rial a perdu 60% de sa valeur. Les sanctions auraient déjà privé l’Etat iranien de plus de 10 milliards de dollars. Même dans un pays où l’agitation sociale relève de la récurrence établie, les conséquences économiques de la politique de sanctions se font jour. La popularité du président Rohani, signataire du JCPOA, s’érode d’autant plus que le guide suprême de la Révolution, l’ayatollah Ali Khamenei, n’a pas omis de rappeler son opposition originelle à cet accord qui restaurait une forme de relation avec le « Grand Satan » américain. Loin d’être soudée dans cette épreuve de force, la jeunesse iranienne serait cependant plus encline à critiquer l’inflexibilité du régime et l’impuissance du Gouvernement. De retour de Téhéran, le journaliste Armin Arefi rapporte même que le président américain y est positivement perçu comme un dirigeant soucieux de défendre les intérêts de son peuple[4] Armin AREFI, Un printemps à Téhéran: la vraie vie en République islamique, Paris, Plon, 2019, 298 p..
Prenant acte de la non-application d’un compromis âprement négocié, l’Iran a décidé joué la carte de la réponse proportionnée mais démonstrative. Dans ce contexte, le 8 mai 2019, le président Hassan Rohani a annoncé ne plus se conformer à deux des engagements pris dans le cadre du JCPOA. Téhéran pourrait ainsi reconstituer ses réserves d’uranium enrichi, permettant le développement d’un usage militaire du nucléaire. Pour témoigner de sa détermination, l’Organisation iranienne de l’énergie atomique a déclaré le 23 mai avoir quadruplé sa production, tout en demeurant dans la limite de 3,75% fixé par l’accord de 2015.
De même, Téhéran a donné jusqu’au 7 juillet aux parties restantes du JCPOA pour garantir les bénéfices de son application par tous moyens. Abbas Araqchi, ministre adjoint des Affaires étrangères, a déclaré que l’Iran conditionnerait son maintien dans l’accord à un retour de ses exportations pétrolières à leur niveau antérieur aux sanctions. Déjà, en janvier 2019, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni avaient mis en place le mécanisme de compensation INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges). Il s’agissait de faciliter les transactions commerciales en contournant l’extraterritorialité des sanctions américaines. Mais le dispositif n’a pas convaincu en ce qu’il concerne les produits alimentaires et pharmaceutiques, déjà exclus des embargos mis en place par Washington. Par ailleurs, la non prise en compte du pétrole par le mécanisme le rend virtuellement inapte à susciter un regain de l’économie iranienne.
L’envol des faucons
La décision de Téhéran semble donner raison à l’agenda des « faucons » qui nichent dans les cercles du pouvoir : pousser l’Iran à la faute et le régime à la chute. Au printemps 2018, en amont de la dénonciation de l’accord, la valse des nominations à Washington avait témoigné d’un déplacement du centre de gravité de l’Establishment de politique étrangère vers un conservatisme botté, faisant craindre les risques d’une escalade dans le golfe Persique[5] cf. Sylvain GAILLAUD, « L’envol des faucons américains est de mauvais augure pour la stabilité du Golfe persique », L’Opinion, 25 mai 2018..
John Bolton : « Doctor Strangelove » au Conseil de sécurité nationale
Parmi les faucons les plus influents, John Bolton, Conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, n’a jamais dissimulé sa profonde hostilité à l’égard de l’Iran des ayatollahs. Quatre mois avant la signature de l’accord nucléaire, il exprimait dans une tribune pour le New York Times son incrédulité face à l’angélisme de l’administration Obama et appelait au bombardement de l’Iran, seule manière selon lui de contrôler les ambitions supposées du pays. Sa propension à vouloir régler les conflits par la force lui vaut, jusque dans les cercles républicains, le surnom de « Doctor Strangelove », par référence au personnage principal du film à succès de Stanley Kubrick qui met en scène un général incontrôlable, victime d’inclinations nucléaires en plein équilibre de la terreur au cours de la Guerre froide.
Vétéran des administrations républicaines, J. Bolton entame sa carrière au Département d’Etat sous la présidence de Ronald Reagan. Il bénéficie alors de la protection de Jesse Helms, appelé « Senator No » en raison de ses prises de position très conservatrices et de sa pratique de l’obstruction parlementaire. Il rejoint ensuite le département de la Justice en qualité d’Attorney General assistant au Bureau des affaires législatives de 1985 à 1988. A cette époque, il est impliqué dans l’affaire Iran-Contras : l’administration Reagan se lance dans un commerce d’armes en direction de l’Iran dans le but de soutenir les factions dites modérées du régime. Le jeune Hassan Rohani, alors membre du « conseil suprême de défense », est chargé par l’ayatollah Khomeini de mener à bien les négociations[6] David RIGOULET-ROZE, « Le « fantôme » de l’Irangate dans les négociations sur le nucléaire iranien », Politique américaine, vol. 26, n° 2, 2015, p. 49-68.. La vente est destinée à faciliter la libération d’otages américains détenus par le Hezbollah au Liban. Elle s’opère par l’intermédiaire de membres du gouvernement israélien, entremetteur récurrent. L’argent obtenu est ensuite utilisé pour financer la guérilla des Contras, au Nicaragua, en totale contradiction avec les interdictions posées par le Congrès américain. La révélation du scandale, en novembre 1986, discrédite l’aventurisme diplomatique américain au Moyen-Orient et fragilise l’administration Reagan, au point de faire émerger l’hypothèse d’une procédure d’impeachment.
Depuis son bureau, John Bolton fait obstruction à plusieurs reprises aux enquêtes parlementaires menées par le sénateur John Kerry qui, trente ans plus tard, négocie en qualité de secrétaire d’Etat avec ses partenaires du groupe P5+1 pour encadrer la nucléarisation de la République islamique. Le travail de Bolton rencontre à l’époque le soutien du jeune Dick Cheney. Ancien assistant de Donald Rumsfeld à la Maison-Blanche sous l’administration Nixon, ce fougueux représentant du Wyoming use de son pouvoir de conviction pour tempérer la volonté de la Chambre de démêler le scandale.
Sous l’administration Bush, Bolton est récompensé par le poste de Sous-Secrétaire en charge du contrôle des armes et de la sécurité internationale au Département d’Etat. Il monte alors un dossier contre Saddam Hussein, accusé de posséder des armes de destruction massive. Vingt ans plus tôt, au cours de la guerre Iran-Irak, l’hostilité traumatique envers la République islamique avait pourtant engagé l’administration Reagan dans une politique de « préférence irakienne » se traduisant par la fourniture de renseignements et des ventes d’armes à l’armée du rais, en contradiction avec la politique officielle de neutralité entre les belligérants.
En 2003, le Secrétaire d’Etat Colin Powell n’ignore pas la fragilité du dossier monté par John Bolton. La présentation qu’il en fait à l’Organisation des Nations unies doit permettre aux faucons de l’administration Bush d’obtenir un blanc-seing pour envahir l’Irak et renverser son dirigeant. Et quand la communauté internationale refuse, l’administration Bush n’hésite pas à passer outre.
A ce mépris des institutions du multilatéralisme répond une tendance marquée à instrumentaliser le renseignement à des fins politiques. Lors de son passage au Département d’Etat, Bolton empêche ainsi le Secrétaire d’Etat, Colin Powell à plusieurs reprises puis Condoleeza Rice à une occasion, d’avoir accès à des informations vitales pouvant influencer la stratégie américaine à l’égard de l’Iran dans un sens contraire à ses opinions.
Pour achever ce portrait, il convient de signaler qu’avant sa nomination à la tête du Conseil de Sécurité nationale, John Bolton a pris soin de démissionner de l’institut Gateston, un think thank de la droite conservatrice connu pour ses prises de position hostiles à l’islam. L’institut fut l’objet de plusieurs controverses relatives à la diffusion d’informations, non-vérifiées ou erronées, destinées à cautionner ses prises de positions.
En 2016, le sénateur républicain du Kentucky Rand Paul exhortait dans une tribune le président-élu Trump à ne pas choisir John Bolton pour le poste de Secrétaire d’Etat. Il semblait selon lui « déterminé [« hell-bent »] à répéter pratiquement toutes les erreurs de politique étrangère faites par les Etats-Unis durant les quinze dernières années ». Dans un système politique où la prise de décision en politique étrangère est traditionnellement concentrée à la Maison-Blanche et où les rivalités entre le Département d’Etat et le Conseil de Sécurité Nationale font souvent le jeu du dernier, Donald Trump a donc décidé de faire du héraut de la ligne dure contre l’Iran le plus proche de ses conseillers.
L’influence de John Bolton profite par ailleurs de l’économie interne d’une administration qui peine à obtenir confirmation du Congrès des nominations correspondant aux nouvelles inflexions de la politique menée. Ainsi le Département de la Défense se trouve-t-il depuis le début de l’année 2019 sans Secrétaire confirmé. Le dernier à avoir occupé le poste, James Mattis, a démissionné le 31 décembre 2018, en désaccord avec le président Trump, notamment sur la sortie unilatérale du JCPOA. Il était pourtant partisan de la fermeté vis-à-vis de la République islamique. A la tête de l’US Central Command, il a fréquemment appuyé la perspective d’une attitude plus agressive envers Téhéran. L’administration Obama a préféré s’en séparer, le jugeant trop enclin à une confrontation militaire hors-de-propos pendant la négociation de l’accord nucléaire. Mais l’opposition ouverte de Mattis au président Trump lui a valu de sévères humiliations : avant-même la date effective de sa démission, il est remplacé provisoirement par Patrick Shanahan. Or, le prolongement de cet interim a favorisé la concentration de la prise de décision en politique étrangère à la Maison-Blanche.
Michael Pompeo : un « maître espion » au Département d’Etat
Si le Conseiller du Président pour les Affaires de Sécurité Nationale apparaît comme le héraut de la ligne dure, le retour aux affaires de faucons sur les questions iraniennes est observable dans les autres agences et départements de la politique étrangère.
Pour remplacer à la tête du Département d’Etat un Rex Tillerson jugé trop partisan de l’accord nucléaire de 2015, le choix s’est porté sur Michael Pompeo, ancien directeur de la CIA et adepte assumé de la théorie du « regime change » qui avait permis de faire de l’Iran le relais de l’influence américaine dans le golfe Persique jusqu’à la Révolution islamique.
Membre du mouvement conservateur Tea Party, représentant pour le Kansas au Congrès, il a patiemment œuvré pour saper les négociations aboutissant à la signature du JCPOA puis pour empêcher le texte d’être validé par la Chambre. Deux mois avant l’élection de Donald Trump à la présidence, il publie dans le magazine Foreign Policy un article condamnant les soi-disant alliés des Etats-Unis qui acceptent de faire des affaires avec leur meilleur ennemi. Dans son dernier tweet avant sa nomination à l’agence de Langley, il ne tait pas son désir de « déconstruire cet accord désastreux passé avec le plus grand Etat soutenant le terrorisme au monde ». Son effort de déconstruction de l’accord nucléaire le conduit à vouloir orienter en ce sens l’action de la communauté américaine du renseignement :
- Ainsi annonce-t-il, peu après sa prestation de serment, sa volonté de déclassifier des documents retrouvés dans la planque d’Oussama ben Laden à Abbottabad, au Pakistan, sous prétexte de contribuer à une meilleure compréhension de l’ancien chef d’Al-Qaïda. Quelques mois plus tard, il révèle la raison ayant présidé à cette décision lors d’une rencontre organisée par la Fondation pour la défense des démocraties : il s’agissait bien de discréditer Téhéran en révélant des liens supposés entre la République islamique et la nébuleuse terroriste.
- Au mois de juin 2017, la création de l’Iran Mission Center (IMC), sous les auspices de la CIA, entend faire du pays l’une des cibles prioritaires dans la collecte du renseignement. Le centre a pour but de réunir des analystes, des opérateurs et des spécialistes afin de fonder l’action de la CIA. Depuis la rupture des relations diplomatiques entre Washington et Téhéran, après la prise d’otage de 1979, l’absence d’ambassade en Iran prive les officiers du renseignement américain de la couverture dont ils bénéficient habituellement. Il s’agit donc de palier l’intelligence gap pour mieux se donner les moyens des actions clandestines envisagées par les partisans d’une approche intrusive des questions iraniennes.
- Le 8 avril 2019, le placement par Mike Pompeo des Gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes surveillées par le Département d’Etat s’est opéré contre les avis des officiels du Pentagone. Il a immanquablement conduit à une riposte rhétorique de Téhéran.
En contradiction avec les renseignements fournis par la CIA et l’AIEA, Michael Pompeo compte logiquement parmi les hommes du président lui ayant conseillé de dénoncer la signature américaine.
Michael D’Andrea: « Ayatollah Mike » à l’IMC
La nomination de Michael D’Andrea à la tête de l’IMC passe pour le premier signe d’une volonté d’en découdre avec Téhéran. Baptisé « Ayatollah Mike » par ses collègues, il a gravi les échelons de l’Agence en présidant à la traque d’Oussama ben Laden ainsi qu’à la campagne de frappes de drones lancée par l’administration Bush et prolongée par l’administration Obama. Il aurait d’ailleurs inspiré le personnage du « Loup » dans le film de Kathryn Bigelow, Zero Dark Thirty, qui tente de reconstituer la traque d’Abbottabad. Issu d’une famille liée à la CIA pendant plusieurs générations, Michael D’Andrea est fréquemment décrit comme un bourreau de travail, l’idéal-type de la sentinelle iranienne répondant aux objectifs de l’administration Trump.
Au lendemain de sa nomination, le 4 janvier 2018, la République islamique accuse la CIA d’avoir soutenu les manifestations qui, pendant une semaine, ont déferlé dans les rues, appelant à un changement de régime. Leur bilan s’élève à 21 victimes et des centaines d’arrestations. L’accusation, reprise par le journal turcophone Takvim,identifie Michael D’Andrea comme la tête pensante d’une opération qui aurait consisté à l’envoi de 900 agents sous couverture d’hommes d’affaires afin d’aviver les tensions et d’embraser les manifestations. Le parallèle est rapidement établi avec le « coup d’état » du 28 Mordad : en août 1953, l’instrumentalisation par les services de renseignement américains et britanniques d’une révolte populaire avait opportunément conduit à la chute du Premier ministre Mossadegh. Ce dernier entendait nationaliser l’industrie pétrolière iranienne et menaçait de déstabiliser la région aux portes de la Russie soviétique. Le « coup » de Mordad permit une reprise en main du pays par le shah, devenu le garant des intérêts américains et britanniques dans le Golfe. L’épisode peuple la mémoire iranienne, si bien que le silence de Michael D’Andrea au sujet des manifestations de l’hiver 2017-2018 a interrogé.
« Hell-bent »
Pareil retour en force des faucons américains est décidément de mauvais augure pour la stabilité du Golfe persique. Leurs accointances intellectuelles et paternités politiques montrent à quel point leur obsession iranienne renoue avec l’aventurisme américain au Moyen-Orient. Le président n’hésite d’ailleurs pas à jouer avec les symboles, instrumentaliser les institutions internationales, recourir aux mémoires clivantes et s’appuyer sur des alliés israéliens et saoudiens dont l’inimitié de principe et les rivalités géopolitiques avec la République islamique sont connues.
Au demeurant, les outrances langagières de la « tweeto-diplomatie » trumpienne témoignent d’une « politique de provocation » qui n’est pas sans rappeler les éléments de langage de la « politique de confrontation »[7] Babak GANJI, Politics of Confrontation: The Foreign Policy of the USA And Revolutionary Iran, New York, I.B. Tauris, 2006. pratiquée par l’ayatollah Khomeini puis par le président Mahmoud Ahmadinejad à l’égard du « Grand Satan » américain. Conscient de la vanité dangereuse de la démarche, les officiels iraniens semblent refuser de faire le jeu d’un président décidé à souffler le chaud et le froid sur les cendres laissées en héritage par ses faucons[8] Tim WEINER, Des cendres en héritage. L’histoire de la CIA, Paris, De Fallois, 2009, 544 p.. Les risques de l’escalade n’en sont pas moins réels dans le golfe Persique :
- En mai dernier, les services de renseignement israéliens alertent les Etats-Unis quant à une possible attaque contre leurs intérêts au Moyen-Orient. Malgré la précarité de ce renseignement, Washington a déployé le porte-avion U.S.S. Abraham Lincoln et une force de bombardiers B-52 dans les eaux du golfe Persique.
- Or, le 12 mai, l’attaque de deux tankers saoudiens au large des Emirats arabes unis a prolongé la crainte d’une escalade. Elle a aussi fait resurgir les spectres du passé : à la fin du conflit Iran-Irak, la « guerre des tankers » avait fait 420 victimes.
- D’ailleurs, le 13 mai, le New York Times révèle que Patrick Shanahan avait à la demande de John Bolton présenté la semaine précédente un projet d’envoi de 120.000 hommes au Moyen-Orient si l’Iran persistait dans l’escalade des tensions ou dans sa volonté de se retirer du JCPOA.
- Le lendemain, des attaques de drones revendiquées par des rebelles yéménites provoquent la fermeture d’un oléoduc majeur en Arabie saoudite.
- Le jour suivant, le Département d’Etat annonce le rapatriement de tout son personnel diplomatique jugé non essentiel de l’ambassade américaine de Bagdad et du consulat d’Erbil.
- Le 21 mai, deux missiles balistiques yéménites tirés en direction de La Mecque sont interceptés par l’Arabie saoudite.
- Le 24 mai, invoquant encore la menace iranienne, les Etats-Unis reprennent leurs fournitures militaires à Riyad. Face au désastre humanitaire constitué par la guerre au Yémen, le Congrès avait voté en avril une résolution interrompant l’assistance américaine à la coalition saoudienne. Pour contrer cette opposition, Mike Pompeo a confirmé le recours à une procédure d’urgence, marginalisant encore une fois les contrepoids institutionnels à la présidence impériale.
- Le même jour, tout en professant des intentions non-belliqueuses, Washington a annoncé le déploiement de 1.500 soldats au Moyen-Orient au prétexte de la persistance de menaces en provenance des plus hauts niveaux du gouvernement iranien. Ce qui relève en réalité d’un simple redéploiement de forces déjà présentes dans la région a pu fournir l’argument d’une annonce supplémentaire pour accroître les tensions, dans la logique de « pression maximale ».
- Le 13 juin, l’attaque non revendiquée de deux pétroliers en mer d’Oman a provoqué un surcroît d’escalade puisque, le 17 juin, Patrick Shanahan annonce l’envoi de 1.000 militaires supplémentaires dans le golfe Persique en réaction à l’offensive, attribuée par les Etats-Unis à l’Iran. Le lendemain, son remplacement par Mark Esper, jusqu’à présent Secrétaire pour l’Armée, perpétue l’instabilité chronique à la direction du Département de la Défense. Ce vétéran de la guerre du Golfe, de la fondation Heritage et de la commission des Affaires étrangère du Sénat a fait carrière au groupe Raytheon, l’une des grandes entreprises américaines de systèmes de défense. Proche de Mike Pompeo, depuis leurs études à l’académie militaire de Westpoint dont ils sortent tous les deux diplômés en 1986, sa nomination ne manquera pas de renforcer l’influence des faucons du président dans la prise de décision, à quelques semaines de l’expiration de l’ultimatum formulé par Hassan Rohani.
- Enfin, le 21 juin, l’annonce de l’annulation à la dernière minute d’une riposte armée des Etats-Unis à la destruction par Téhéran d’un drone américain RQ-4 Globat Hawk, qui aurait survolé l’espace aérien iranien, augure mal un apaisement des tensions dans le golfe Persique. Elle témoigne tant de la capacité de réaction miliaire de la République islamique que de l’emprise de ceux qui aspirent depuis longtemps à la confrontation au sein de la Maison Blanche.
Des cendres en héritage
Face à cette obsession iranienne des faucons du président, que pèsent les autres parties signataires du JCPOA ainsi que l’Union européenne ? En amont d’une réunion organisée en urgence à Bruxelles au début du mois de mai, la cheffe sortante de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a rappelé son attachement sans réserve au compromis de Vienne. La Chine, en pleine guerre économique avec Washington, a appelé les autres signataires à la retenue. Les ministres français, allemand et britannique des Affaires étrangères, après avoir condamné fermement l’ultimatum de deux mois imposé par Téhéran, se sont alarmés de l’escalade des tensions dans le golfe Persique et ont exprimé leur inquiétude à leur partenaire américain. Mike Pompeo a été reçu fraîchement en Russie mais a réussi à faire pression sur les Européens.
Car la politique de « pression maximale », loin de concerner seulement la République islamique, se dirige également vers les partenaires occidentaux des Etats-Unis. La remontrance des « amis qui ne laissent pas leur amis faire des affaires avec l’Iran » de Mike Pompeo résonne ainsi en écho avec l’avertissement que George W. Bush avait lancé aux Occidentaux en amont de sa croisade contre « l’axe du mal ». L’Union semble n’avoir ni les moyens ni la volonté de s’opposer à la politique iranienne de l’administration Trump. Du reste, ni le douloureux divorce entre Londres et Bruxelles, ni la réception complaisante de Viktor Orban par Donald Trump ne donnent la meilleure image d’une Union dont les Etats-Unis ne prennent aujourd’hui plus la peine de chercher le numéro de téléphone.
L’attitude de la France ne se distingue guère de celle de ses partenaires. A ce titre, les déclarations du ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Lemaire, ont évolué de manière éloquente : « Voulons-nous être des vassaux des Etats-Unis qui obéissent le doigt sur la couture du pantalon à des décisions prises par les Etats-Unis ? », s’est-il interrogé au mois de mai 2018 en réaction à leur retrait unilatéral du JCPOA. Un an plus tard, le registre a changé et il évoque pudiquement une « pression très forte et très directe » de Washington « sur des responsables politiques, l’administration, tous ceux qui sont impliqués » contre la mise en place du mécanisme Instex. Le chantage des Etats-Unis sur leur plus ancien allié semble avoir réussi à décourager l’action d’une diplomatie qui n’a jamais embrassé une « préférence iranienne », du fait de la « menace » que la République islamique peut constituer depuis les années 1980 jusque dans l’hexagone[9] Pierre PEAN, La Menace, Paris, Fayard, 1987, 306 p..
En raison du choix des acteurs décisionnaires, des discours tenus et de la méthode employée, l’obsession iranienne des faucons du président renoue avec l’aventurisme américain dans une région devenue un terrain de discrédit pour la politique étrangère américaine et de défiance pour la diplomatie occidentale. Sans parvenir à choisir entre le déshonneur et la guerre, cette posture a institué le Moyen-Orient en berceau du dérèglement du monde. Depuis deux ans, usant d’un mépris consommé des institutions internationales et d’une instrumentalisation des hommes et des choses, les faucons encadrent de bruits de bottes des appels au dialogue.
La lutte contre la nucléarisation de l’Iran avive ainsi le sentiment d’insécurité de la République islamique, ce qui finit par justifier la nécessité de se doter de l’arme nucléaire aux yeux de nombreux dirigeants. Quand bien même serait-elle maîtrisée et n’aboutirait-elle pas à une guerre déclenchée « par inadvertance », les risques à long terme de cette escalade orchestrée par les faucons de Washington mettent en exergue les responsabilités partagées de la menace qu’ils se plaisent à agiter.
Notes
| ↑1 | Marie-Cécile NAVES, Trump, la revanche de l’homme blanc, Paris, Textuel, 2018, 156 p. |
| ↑2 | Vincent BOUCHER, « Les réalités parallèles de la politique étrangère de Donald Trump », Les Grands Dossiers de Diplomatie n°50, « Géopolitique des Etats-Unis : renouveau ou fin de l’hégémonie ? », avril-mai 2019, p. 36-40. |
| ↑3 | Sylvain GAILLAUD, « De fausses ruptures en retour du refoulé, la politique iranienne de Donald Trump », La Croix, 7-8 mai 2018. |
| ↑4 | Armin AREFI, Un printemps à Téhéran: la vraie vie en République islamique, Paris, Plon, 2019, 298 p. |
| ↑5 | cf. Sylvain GAILLAUD, « L’envol des faucons américains est de mauvais augure pour la stabilité du Golfe persique », L’Opinion, 25 mai 2018. |
| ↑6 | David RIGOULET-ROZE, « Le « fantôme » de l’Irangate dans les négociations sur le nucléaire iranien », Politique américaine, vol. 26, n° 2, 2015, p. 49-68. |
| ↑7 | Babak GANJI, Politics of Confrontation: The Foreign Policy of the USA And Revolutionary Iran, New York, I.B. Tauris, 2006. |
| ↑8 | Tim WEINER, Des cendres en héritage. L’histoire de la CIA, Paris, De Fallois, 2009, 544 p. |
| ↑9 | Pierre PEAN, La Menace, Paris, Fayard, 1987, 306 p. |