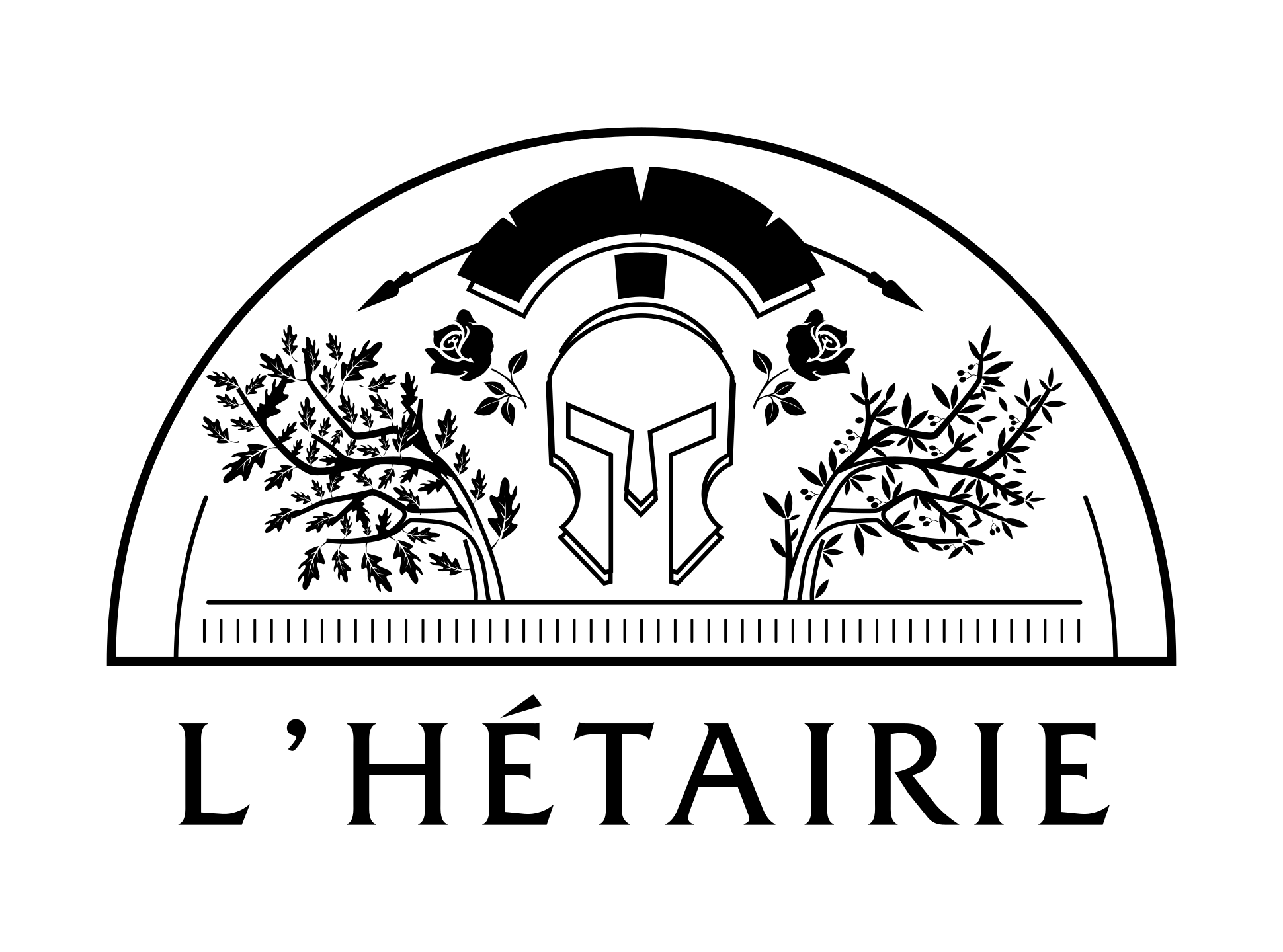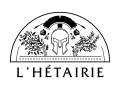Projet de loi Collomb : l’injustifiable agonie de nos droits [Note #2]
De manière fort courageuse, Emmanuel Macron a très tôt annoncé sa résolution de mettre fin à l’état d’urgence, estimant à juste titre qu’une démocratie ne pouvait durablement vivre sous un régime d’exception. Néanmoins, il a lié cette décision à l’adoption du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme déposé le 22 juin 2017.
Or, ce texte, bien que sans envergure, contient quatre articles éminemment problématiques en ce qu’ils achèvent la transposition de l’état d’urgence dans le droit commun sans que cela ne se justifie d’un point de vue opérationnel.
A nouveau, et comme depuis trente ans, la communication politique l’emporte sur le fond, mais surtout sur la liberté personnelle, sacrifiée au motif de la quête illusoire et infinie de la prédictibilité parfaite d’un passage à l’acte terroriste.
Ménageant une fallacieuse place au juge judiciaire, le projet de loi permet en réalité un contournement massif du dispositif judiciaire de lutte contre le terrorisme qui se distingue pourtant par sa souplesse et son efficacité.
Mais l’on ne saurait imputer l’entière responsabilité de ce conséquent recul au seul projet de loi. Car, en s’instituant comme « voiture-balai » de l’état d’urgence, il amplifie et parachève en réalité un mouvement entamé avant lui.
Enfin, le débat initié évite soigneusement la question de l’indispensable saut capacitaire technologique que devrait réaliser la police judiciaire française pour maintenir son indéniable efficacité.
La tragique dégénérescence législative du modèle français de lutte contre le terrorisme
De prime abord, le projet de loi déposé le 22 juin dernier par le Gouvernement ne semble receler aucune disposition d’une nouveauté déterminante. Il relève plutôt de la catégorie des législations de « fonds de tiroirs » et accueille à ce titre trois familles d’articles :
- Les articles orphelins et opportunistes : le projet de loi Collomb comprend plusieurs dispositions qui, sans lui, auraient été orphelines de vecteur législatif. Il s’agit de la transposition de la directive PNR[1] Acronyme pour passenger name record, ce traitement automatisé des données des passagers aériens destiné à surveiller les déplacements de certains individus. (articles 5 à 7 qui n’offrent toutefois pas les garanties maximales en matière de protection des données personnelles) ou encore de rédactions venant pallier deux censures constitutionnelles de la loi relative au renseignement (articles 8 et 9)[2] Décision n° 2016-590 QPC du 21 octobre 2016 qui a censuré l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure et Décision n° 2017-648 QPC du 4 août 2017 qui a censuré une phrase de … Continue reading.
C’est également le cas de l’article 8 ter qui soulève néanmoins une importante question de principe en ce qu’il procède à la prolongation subreptice de la surveillance algorithmique prévue par la loi renseignement sans qu’un rapport n’ait vraisemblablement été produit pour témoigner de sa mise en œuvre ou, le cas échéant, pour démontrer son efficacité. Le contrôle parlementaire des services de renseignement demeure décidément une gageure.
- Les articles de repentir anecdotique : le texte comporte des articles qui modifient à la marge des dispositions récemment votées. On citera l’article 12 relatif à la transmission des images enregistrées par les caméras-piétons des agents de la RATP ou de la SNCF[3] L’article modifié avait été initialement créé par la loi du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et … Continue reading ; l’article 4 ter qui retouche le dispositif introduit par la loi du 3 juin 2016 afin d’éviter une rupture de surveillance lors de la saisine d’un juge d’instruction ; ou encore l’article 4 quater quiaffine le régime de protection des témoins également issu de la loi du 3 juin 2016. Enfin, l’article 4 quinquies élargit le recours à des techniques spéciales d’enquête.
De ce point de vue, les débats parlementaires n’ont guère contribué à enrichir le projet de loi tant les articles additionnels paraissent mineurs en matière de lutte contre le terrorisme. A titre d’illustration supplémentaire, l’article 4 bis A (dont on peut douter qu’il relève du domaine de la loi), est supposé encadrer les initiatives privées en matière de lutte contre la radicalisation sans évoquer ni leur évaluation, ni leur encadrement, ni même leur coordination.
- Un article marginal mais utile : l’article 1er se distingue par son utilité. Dans un contexte où la menace terroriste cible particulièrement les événements de masse, qu’ils soient festifs, sportifs ou culturels, la tenue de ceux-ci implique des mesures d’ordre public particulières. Dans cette perspective, l’état d’urgence a indéniablement facilité la sécurisation de l’Euro de football 2016 ou d’autres événements sur le territoire, tels les marchés de Noël. Dès lors qu’il n’existe pas véritablement d’équivalent en droit commun et que d’autres Etats européens (Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne et Italie) recourent avec succès à des dispositions similaires, permettre aux autorités préfectorales de déterminer un périmètre de protection à l’occasion de grands événements postérieurement à la sortie de l’état d’urgence présente une véritable utilité opérationnelle.
Enfin, dans la mesure où l’expérience montre que ces grands événements ne peuvent plus se tenir sans la participation des polices municipales et des agents privés de sécurité en sus des policiers et gendarmes, il est pertinent que la loi acte le concours de ces forces et précise leurs prérogatives respectives au sein des périmètres de protection.
En définitive, l’examen parlementaire n’emporterait pas de difficulté majeure si quatre articles ne s’avéraient éminemment problématiques en ce qu’ils achèvent la transposition dans le droit commun des dispositions d’un état d’urgence « dopé ». Dans le détail :
- l’article 2 décrit la procédure administrative de fermeture des lieux de culte ;
- l’article 3 établit des « mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance » que l’on appelait jusqu’à il y a peu « des assignations à résidence » ;
- l’article 4 concerne les « visites et saisies » (nouveau nom des perquisitions administratives) ;
- enfin l’article 10 accroît les capacités de contrôles frontaliers, n’hésitant pas à établir sans vergogne un lien entre immigration et terrorisme.
Le lecteur notera d’emblée la taille de ces articles et le luxe de détails qui accompagne ces mesures directement transposées de l’état d’urgence dans le droit commun. Or, la première conséquence de ce droit bavard réside dans un accroissement considérable du risque contentieux, paralysant plus encore un dispositif inefficient. On citera l’article 10 qui, en définissant des périmètres de plusieurs kilomètres, donnera inévitablement lieu à des joutes géographiques devant des tribunaux médusés. Quant aux trois autres articles, ils posent des conditions procédurales si détaillées que certains avocats se feront une spécialité de débusquer des manquements.
Mais la lourdeur des articles traduit surtout le fait qu’ils se situent sur une ligne de crête constitutionnelle et que, pour ne pas encourir une censure, il était nécessaire de réaliser les plus grandes contorsions juridiques. A ce titre, le projet de loi a ménagé un rôle au juge judiciaire, que ce dernier soit informé d’une mesure où qu’il en autorise la mise en œuvre[4] Le texte prévoit ainsi la simple information du procureur de la République pour la mise en place des périmètres de sécurité (article 1er), la mise en œuvre de perquisitions (article 4), … Continue reading. Mais l’exercice est parfaitement fallacieux à quatre titres :
- En premier lieu, une simple information du Procureur de la République ne constitue en rien une garantie contre l’arbitraire, notamment dans la mesure où seule la juridiction administrative est compétente pour connaître du contentieux de ces mesures après leur édiction et leur prise d’effet.
- De même, les Juges des libertés et de la détention (JLD) recevront-ils des informations probantes pour délivrer des autorisations éclairées ? Assurément non, car les services à l’origine de la demande rechigneront à leur transmettre des éléments souvent protégés par le secret de la défense nationale ou très inconséquents (les justement décriées « notes blanches » propres à la justice administrative[5] Ces notes, qui ne mentionnent ni le service auteur, ni la source du renseignement, ont été utilisées pendant toute la durée de l’état d’urgence en matière de contentieux des assignations … Continue reading). D’ailleurs, si tel n’était pas le cas, les éléments produits mettraient immédiatement fin à cette phase administrative en permettant l’ouverture d’une procédure judiciaire, ce qui témoignerait de l’inutilité du dispositif voté.
- Les JLD seront-ils assez nombreux pour effectuer un réel contrôle ? A nouveau, assurément non ; et les activités de police administrative risquent d’engorger une juridiction parisienne (puisque c’est la seule visée par le texte) déjà très sollicitée. Toute nouvelle compétence doit être accompagnée de moyens en conséquence pour ne pas se résumer à un tigre de papier. Dans le même esprit, la souplesse opérationnelle recherchée sera déçue au regard de la lourdeur procédurale qui viendra, en définitive, entraver l’action des services non parisiens.
- Enfin, le fait qu’un mécanisme propre au droit des étrangers en matière d’assignation à résidence – avec l’intervention du JLD – soit applicable à des citoyens français ne semble heurter personne alors même que cela traduit la création d’un régime de moindres garanties pour une partie de nos concitoyens.
Au surplus, on peut s’interroger sur les mérites comparés de ces dispositifs par rapport aux capacités judiciaires actuelles. Les articles précités ne peuvent en effet se prévaloir de la même plus-value opérationnelle, loin s’en faut. Ils seront mis en œuvre en cas d’éléments insuffisants pour judiciariser les situations, c’est dire le risque d’arbitraire tant la législation française antiterroriste est souple et permet d’ores et déjà d’initier une procédure judiciaire avec des soupçons très peu matérialisés. A ce titre :
- la fermeture des lieux de culte interviendra donc à défaut d’être en capacité de poursuivre les individus concernés pour apologie du terrorisme (article 421-2-5 du code pénal modifié par la loi du 13 novembre 2014) ;
- l’assignation à résidence sera utilisée en cas d’impossibilité de recourir à une détention provisoire (article 143-1 et suivants du code de procédure pénale, CPP), à un contrôle judiciaire (article 138 et suivants du CPP) et, dans ce cadre, à une assignation à résidence judiciaire (article 142-5 et suivants du CPP) ;
- les perquisitions administratives seront quant à elles employées à défaut d’enquête judiciaire (article 706-89 et suivants du CPP, dont l’article 706-90 modifié par la loi du 3 juin 2016 afin d’autoriser ces actes d’enquêtes la nuit).
Pourtant, les services de police judiciaire ne se sont jamais plaints ni de la difficulté à recourir aux articles précités du CPP, ni de ne pouvoir enquêter convenablement dans le domaine de la lutte contre le terrorisme[6] Ils réclament par ailleurs une simplification de la procédure pénale classique qui devrait être opérée par un projet de loi annoncé par Gérard Collomb pour le premier semestre 2018.. Leurs besoins ne sont plus juridiques (cf. infra). Emmanuel Macron lui-même partage ce constat, comme il l’a évoqué devant le Parlement réuni en Congrès le 3 juillet dernier : « Le code pénal tel qu’il est, les pouvoirs des magistrats tels qu’ils sont, peuvent, si le système est bien ordonné, bien organisé, nous permettre d’anéantir nos adversaires. Donner en revanche à l’administration des pouvoirs illimités sur la vie des personnes, sans aucune discrimination, n’a aucun sens, ni en termes de principes, ni en termes d’efficacité ».
En dépit de cette juste observation, son Gouvernement aura favorisé le retour de la loi des suspects[7] Loi votée en août 1793, au cours de la Terreur. Elle permettait l’arrestation, sans motif et sans preuves, de ceux qui « n’ont pas constamment manifesté leur attachement à la … Continue reading. Le projet de loi amplifie donc une logique délétère et inefficace : il consacre le triomphe d’une police administrative peu soucieuse de la liberté personnelle, d’un modèle où un faisceau de présomptions suffit à déclencher des mesures lourdes mais dénuées de bénéfice opérationnel. Et leur évaluation en 2020 (article 4 bis), d’une part ne réparera pas les dommages qui auront été causés et, d’autre part, ne présente aucune garantie de révision du dispositif quand on sait le soin concédé, tant par l’exécutif que par les parlementaires, à cette clause de style lorsqu’arrive l’échéance prévue par la loi (à l’image de la surveillance algorithmique déjà évoquée).
Si ce projet de loi est dangereux en raison de ce qu’il apporte au droit commun, il l’est aussi pour les horizons qu’il ouvre en cas de nouvel attentat. Il aura en effet continué à déplacer la limite de l’acceptable. Quelle sera donc la prochaine liberté rognée au prétexte – illusoire – de mieux lutter contre le terrorisme que ne l’aurait fait l’autorité judiciaire ? Instaurera-t-on les camps d’internement prônés par certains députés de droite ?[8] Pour illustrer cette dérive infinie, on se reportera aux dernières propositions de Laurent Wauquiez : Jean-Marc Leclerc et Marion Mourgue, « Laurent Wauquiez : «Sur le … Continue reading
Mais l’on ne saurait imputer l’entière responsabilité de ce conséquent recul de la liberté personnelle au seul projet de loi. Car, en s’instituant comme « voiture-balai » de l’état d’urgence, il amplifie et parachève en réalité un mouvement entamé avant lui.
Genèse du projet de loi Collomb (I) : les déviances de l’antiterrorisme français
Depuis plus de trente ans, notre pays a façonné un dispositif de prévention et de répression du terrorisme au centre duquel il a placé l’autorité judiciaire. En effet, la loi du 9 septembre 1986 a introduit dans le droit pénal l’incrimination spécifique de terrorisme[9] Défini comme une « entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public, par l’intimidation ou la terreur » à laquelle se rattache une série … Continue reading en même temps qu’elle a consacré le rôle cardinal d’une juridiction d’enquête et de jugement spécialisée et centralisée à Paris[10] En amplifiant les effets de la loi du 21 juillet 1982 qui avait créé des cours d’assises spéciales (loi du 21 juillet 1982 relative à l’instruction et au jugement des infractions en … Continue reading.
Cette architecture a été complétée de manière décisive par la loi du 22 juillet 1996 qui a créé la notion d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (AMT) aux termes de l’article 421-2-1 du code pénal[11] Loi du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public … Continue reading. Articulé avec une définition extrêmement vaste du terrorisme, l’article permet de poursuivre l’ensemble des membres d’un réseau, quel que soit leur degré d’implication.
Pareille construction a su démontrer sa redoutable efficacité, d’autant que 22 lois sont venues combler les failles ou lacunes apparues à l’usage, preuve d’un investissement politique quasi sans égal. Néanmoins, cette recherche d’efficacité comporte sa part d’errements.
Le premier dévoiement réside dans l’instauration d’un droit de la preuve amoindri en matière d’antiterrorisme, conduisant les tribunaux à condamner des individus pour des intentions terroristes même faiblement matérialisées. Et précisément, l’histoire de la législation antiterroriste a consisté en une diminution des éléments de preuve requis pour caractériser une infraction terroriste avant la commission d’un attentat. C’est la raison pour laquelle, bien qu’envié par nombre de nos voisins, notre modèle n’a finalement été que très peu imité au regard du risque d’arbitraire qu’il charrie.
La seconde déviance s’avère plus préoccupante encore dans la mesure où elle suppose une excroissance de la lutte contre le terrorisme en dehors du contrôle de l’autorité judiciaire. En effet, la lutte contre le terrorisme a progressivement débordé du monde du renseignement ou de la justice pour irriguer le quotidien de l’ordre public. Ainsi, la police administrative traditionnelle (celle de l’ordre public, assurée par les autorités administratives et les forces de sécurité intérieure) a-t-elle été dotée de larges pouvoirs, créant les conditions d’une néfaste concurrence, notamment avec la police judiciaire ou la police administrative de souveraineté (celle pratiquée par les services de renseignement), sans plus-value opérationnelle dans la lutte contre le terrorisme.
Car, une réelle complémentarité existe entre police judiciaire et police administrative de souveraineté[12] Pour mémoire, elles exercent leurs fonctions selon la summa divisio dessinée dès 1951 par le Conseil d’Etat et le Tribunal des conflits (Conseil d’Etat, Section, 11 mai 1951, Consorts Baud ; … Continue reading. Dans cette perspective, la seconde doit nourrir les enquêtes menées par la première sous l’autorité des magistrats. La double compétence de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) illustre avec acuité ce processus puisque ses activités de renseignement étayent l’action de sa sous-direction de la police judiciaire dédiée au contre-terrorisme et au contre-espionnage.
Il s’agit d’ailleurs d’un des principes directeurs de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement : le texte favorise la complémentarité de la police administrative et de la police judiciaire sans que la première ne puisse empiéter sur la seconde ou diminuer sa sphère de compétence. Pour ce faire, il a doté les services de renseignement de capacités d’enquête modernes leur permettant, selon les cas d’espèce, de déclencher et d’alimenter utilement les enquêtes judiciaires.
Hélas, les lois antiterroristes ne se sont pas limitées à établir cet équilibre entre l’amont et l’aval du déclenchement d’une enquête judiciaire. Confrontés à l’impact social et médiatique d’un attentat, les responsables politiques ont préféré superposer les dispositifs afin de se prémunir contre toute accusation de n’avoir pas suffisamment œuvré. Le projet de loi Collomb en constitue un exemple symptomatique.
Mais la bascule remonte à la loi de janvier 2006[13] Loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. qui a, par sa construction, suscité la plus grande circonspection. A titre d’exemple, les universitaires Serge Slama et Frédéric Rolin se sont à l’époque interrogés : « l’on peut se demander si la « lutte contre le terrorisme » n’est pas désormais une composante nouvelle de l’ordre public qui autorise des restrictions aux droits et libertés sensiblement supérieures à ce qui était possible sous l’empire de la seule prévention des atteintes portées à la sécurité publique[14] Frédéric ROLIN et Serge SLAMA, « Les libertés dans l’entonnoir de la législation anti-terroriste », AJDA, 2006, p. 975. ».
Car les entorses à la liberté personnelle, tolérables lorsqu’elles concernent les activités de police administrative de souveraineté au regard du contingentement de celles-ci, des mécanismes de contrôle mis en œuvre, de l’application des principes de proportionnalité et de subsidiarité, de la spécialisation des services autorisés, se sont multipliées et massifiées au profit de l’ensemble des forces de sécurité intérieure sans être entourées des mêmes garanties.
La contamination du droit commun s’est opérée au gré de textes de loi qui ont repoussé toujours plus loin la limite de l’acceptabilité, agitant le spectre de la menace terroriste pour discréditer les opposants. Et la recherche de sérénité des responsables politiques face au terrorisme s’est payée au prix fort, alors même que le gain en efficacité s’avère plus que discutable.
De fait, ces outils, devenus surnuméraires, ne prémunissent guère contre les attentats tandis qu’ils abîment durablement notre modèle juridique. De ce point de vue, le recours durable à l’état d’urgence et sa transposition dans le droit commun sont emblématiques de ce glissement progressif.
Genèse du projet de loi Collomb (II) : l’injustifiable banalisation de l’état d’urgence
A la suite des attentats perpétrés le 13 novembre 2015, François Hollande a pris la décision de déclarer l’état d’urgence par décret en conseil des ministres pris en application de la loi du 3 avril 1955. Cet état d’exception sera par la suite prolongé à six reprises[15] Loi du 20 novembre 2015 ; loi du 19 février 2016 ; loi du 20 mai 2016 ; loi du 21 juillet 2016 ; loi du 19 décembre 2016 ; loi du 11 juillet 2017., jusqu’à l’annonce du Président Macron d’une levée prévue le 1er novembre 2017, après une prorogation présentée comme la dernière.
Loin de se borner à le reconduire de manière sèche, les textes successivement votés par le Parlement en ont aussi considérablement élargi le cadre (déjà modifié à la marge en 1960 et 2011), conférant au pouvoir exécutif des prérogatives bien plus larges que celles dont il disposait pendant la guerre d’Algérie.
Seulement, la déclaration de l’état d’urgence a constitué une réponse plus politique qu’opérationnelle. La sidération provoquée par les 130 morts de novembre 2015 nécessitait une réaction politique forte et le recours à la loi du 3 avril 1955 permettait indéniablement de marquer les esprits, de poser un acte d’autorité tout en perturbant d’éventuels réseaux dormants. La massivité des perquisitions administratives a ainsi permis de lever des doutes concernant des individus contre lesquels des éléments insuffisants ne permettaient pas d’étayer les soupçons des services de renseignement.
Cependant, le faible nombre de condamnations prononcées à l’issue de ces perquisitions administratives prouve à lui seul le caractère symbolique de l’action et son utilité marginale. Seules 30 procédures judiciaires ont été ouvertes par la section antiterroriste du parquet de Paris[16] Projet de loi prorogeant l’application de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, exposé des motifs, 22 juin 2017, p. 9. à l’issue des 4 300 perquisitions administratives réalisées depuis le début de l’état d’urgence[17] Pour plus de détails, se reporter à l’excellent travail de contrôle de l’état d’urgence réalisé par l’Assemblée nationale qui a publié toutes les statistiques relatives aux mesures … Continue reading. Et à la faiblesse de ce ratio (à peine 0,7%), s’ajoute le fait que la perquisition administrative ne permettait pas toujours, à elle seule, de justifier l’ouverture d’une procédure.
En matière de lutte antiterroriste, la plus-value de la perquisition administrative est définitivement bien mince d’autant que la loi du 3 juin 2016 a étendu de manière significative les possibilités de recourir, en enquête judiciaire, aux perquisitions domiciliaires – y compris de nuit – et que, de manière générale, la législation antiterroriste fait preuve d’une (très) grande souplesse.
Au surplus, la tragique survenance de nouveaux attentats depuis novembre 2015 démontre le caractère illusoire de la quête du dispositif infaillible. L’argument de l’efficacité recherchée, sans cesse répété par les responsables politiques de tous bords, ne tient guère ; pas plus que la supposée aisance de services affranchis de contraintes légales dont ils s’accommodaient fort bien. En somme, l’état d’urgence aurait pu être levé sans risque supplémentaire dès le début de l’année 2016[18] Voir en ce sens les écrits de Christian VIGOUROUX, in Du juste exercice de la force, Paris, Odile Jacob, 2017, 304p..
Car, qui peut affirmer sans ciller que le dispositif français de lutte contre le terrorisme était lacunaire ? Sans verser dans un fatalisme exacerbé, il convient de souligner une nouvelle fois qu’aucun dispositif législatif ou technique n’entravera jamais un individu ou un groupe d’individus dans la volonté de commettre des actes criminels. Ce serait folie et démesure de laisser accroire cela à nos concitoyens. La fuite en avant dans la quête d’une prédictibilité parfaite est une chimère.
Aussi, la survenance des attentats de novembre 2015 ou des suivants ne saurait trouver son origine dans un défaut d’outils. Au demeurant, des efforts conséquents avaient été déployés entre 2012 et 2015 pour aller plus loin dans le perfectionnement de notre modèle :
- cinq lois avaient pris soin d’accroître les capacités d’enquête judiciaire ou de renseignement[19] Loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (notamment son … Continue reading, de créer une compétence universelle en matière de poursuite d’auteurs terroristes[20] Loi du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, ou encore de conférer pour la première fois un cadre complet et moderne aux activités de renseignement[21] Loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement et loi du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales. ;
- sans compter le plan de lutte contre la radicalisation violente et les filières terroristes qui avait été présenté au conseil des ministres du 23 avril 2014 et mis en œuvre dans la foulée ;
- sans compter non plus la restructuration profonde du renseignement intérieur avec la création de la DGSI et du Service central du renseignement territorial (SCRT) entre la fin avril et le début mai 2014.
Et les amendements déposés par l’opposition à l’occasion de l’examen des textes précités avaient été repoussés parce qu’ils proposaient soit des solutions inconstitutionnelles, soit des perspectives plus proches du Patriot Act étatsunien, sans gain opérationnel. Sous ces plumes déliées, les libertés individuelles étaient aisément sacrifiées au profit d’un Etat policier inefficace, elles étaient uniquement considérées comme des « arguties juridiques », selon les termes employés par Nicolas Sarkozy.
L’inconséquence de cette opposition et la peur frénétique de ne satisfaire ni la presse ni une opinion publique déboussolée ont pourtant servi d’aiguillon à cette fuite en avant qui s’est traduite par la pérennisation de l’état d’urgence.
Or, le piège politique de l’état d’urgence réside dans un effet cliquet puisqu’il est plus simple d’y entrer que d’en sortir. Et comme une pérennisation ad vitam aeternam était politiquement insoutenable à long terme, les responsables politiques ont recouru à l’artifice qui consiste à transposer l’exception dans le droit commun. Le bénéfice opérationnel demeure proche du néant, à l’inverse de l’assurance politique octroyée.
La première transposition, très parcellaire, a été réalisée par la loi du 3 juin 2016. Cette dernière a par exemple introduit :
- une définition du cadre juridique de l’inspection visuelle et de la fouille des bagages opérées par un officier de police judiciaire lors d’un contrôle d’identité ;
- un nouveau cas de retenue administrative (pendant un délai maximal de quatre heures) des personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles représentent une menace pour la sûreté de l’État ou qu’elles sont en relation directe et non fortuite avec de telles personnes ;
- un contrôle administratif des personnes qui se sont rendues ou ont manifesté l’intention de se rendre sur des théâtres d’opérations terroristes ;
- ou encore un renforcement des contrôles d’accès aux lieux accueillant de grands évènements.
Toutefois, dans un souci d’équilibre, le texte législatif a également renforcé de manière considérable les activités de police judiciaire (cf. infra). Il avait d’ailleurs été bâti pour permettre la sortie de l’état d’urgence, en vain. De fait, la loi du 3 juin 2016 porte en elle les germes du projet de loi Collomb.
Or, ce mouvement irraisonné en faveur d’une police administrative crée un véritable cercle vicieux : en éclipsant les sujets d’avenir de la police judiciaire, il empêche cette dernière de gagner une efficacité incomparable, efficacité à laquelle ne pourront juridiquement jamais avoir accès les services de police administrative en l’absence d’autorisation et de contrôle de l’autorité judiciaire, sauf à changer de cadre constitutionnel
Les techniques d’enquêtes judiciaires face au défi technologique : un coupable oubli
Comme évoqué plus haut, le dispositif judiciaire de lutte contre le terrorisme suppose une police administrative de souveraineté efficace (la loi relative au renseignement y pourvoit) et une police judiciaire apte à prendre le relai d’enquêtes de plus en plus complexes lors du déclenchement des procédures. Or, si les responsables politiques n’œuvrent pas à la constante modernisation de la police judiciaire, celle-ci risque d’accumuler un retard extraordinairement néfaste en ce qu’il légitimerait a posteriori le transfert de compétences réalisé au profit des forces de sécurité intérieure.
A rebours, en 2004, à l’initiative de Dominique Perben, alors Garde des Sceaux, la police judiciaire française a bénéficié d’une remise à niveau de ses techniques d’enquête. En effet, la loi du 10 juillet 1991 avait fondé le régime juridique des interceptions judiciaires (les écoutes téléphoniques), puis la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a introduit dans le code de procédure pénale d’utiles techniques spéciales d’enquête à l’instar de la surveillance physique humaine, l’infiltration ou la sonorisation.
Par la suite, la loi du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure a ajouté la captation de données informatiques (schématiquement, les logiciels espions). Cette disposition sera modernisée par la loi du 13 novembre 2014, laquelle introduira également les enquêtes sous pseudonyme. Entre-temps, la loi du 28 mars 2014 a fixé un cadre à la géolocalisation téléphonique ou par balisage. Enfin, la loi du 3 juin 2016 a permis l’usage d’IMSI catchers (une fausse antenne-relai qui permet soit le recueil de données de connexion, soit une interception).
Ces efforts d’adaptation ont été absolument capitaux mais trouvent aujourd’hui leur limite dans les progrès technologiques considérables qui ont été réalisés dans le secteur des communications électroniques.
Il en va ainsi de la question du chiffrement des communications électroniques. En voie de généralisation, cette pratique constitue un frein majeur à la conduite des enquêtes. A titre d’exemple, 80% des interceptions de données sont aujourd’hui chiffrées, réduisant considérablement la capacité des enquêteurs à collecter du renseignement utile aux procédures judiciaires.
Naturellement, le chiffrement correspond à une protection indispensable de la vie privée et rien ne doit être fait pour diminuer sa progression ou créer des failles (les portes dérobées) dans lesquelles s’engouffreraient des services de renseignement comme la NSA. Nonobstant, il est capital d’offrir aux juges judiciaires la possibilité d’accroître leur capacité d’accès à des données en clair.
Cela suppose en premier lieu d’effectuer un saut capacitaire en développant :
- les capacités de déchiffrement de la Plateforme nationale des interceptions judicaires (PNIJ). Il faudra donc consacrer des budgets idoines à ce projet technologique structurant et trop souvent attaqué de manière injuste (même s’il a indéniablement rencontré nombre d’avanies) ;
- l’offre étatique dans le domaine de la captation de données informatiques. Celle-ci s’avère éminemment stratégique puisqu’elle permet de contourner le chiffrement en prélevant les informations directement sur le terminal de communication au moment de leur saisie. Mais, introduite dans le CPP en 2011 (article 706-102-1 et suivants), elle n’a jamais été mise en œuvre, faute d’offre technologique. Néanmoins, les services de renseignement ont développé des compétences en la matière, preuve qu’il n’existe pas d’obstacle technique. C’est dans cet esprit que les ministères de la Justice et de l’Intérieur, après plusieurs mois de travail, sont parvenus à un accord en mars 2017 afin de structurer l’offre étatique de logiciels espions au profit de la police judiciaire. Le texte issu de ce consensus semble s’être perdu dans les limbes, victime de la fin du quinquennat. Sa publication est pourtant déterminante dans la mesure où il prévoit la création d’un service chargé de développer et de mettre à disposition des enquêteurs des solutions informatiques. Il devient urgent de le publier et de le mettre en œuvre.
Mais au-delà des investissements à consentir, cette question suppose également de réfléchir aux moyens d’action des magistrats face aux géants du secteur des communications électroniques. Dans cette optique, il pourrait être envisageable :
- d’obliger les entreprises concernées à disposer d’un réservoir de clés de chiffrement que pourraient solliciter les magistrats pour mettre au clair les données d’un individu faisant l’objet d’une surveillance. Certaines le font déjà afin de déférer aux réquisitions des magistrats sans abaisser leurs standards de sécurité ;
- de conférer le statut d’opérateur de communications électroniques à certaines entreprises (WhatsApp, Hangouts, Messenger, Skype…) afin de pouvoir pratiquer des interceptions judiciaires, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui ;
- d’accroître considérablement les sanctions en cas de refus de déférer à des réquisitions judiciaires en avançant notamment sur le principe d’amendes proportionnelles au chiffre d’affaires de l’entreprise concernée. Si le Conseil constitutionnel a restreint cette possibilité[22] Cf. la Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013., il ne l’a pas éteinte et elle mériterait d’être approfondie.
La question de la multiplication des terminaux de communication s’impose elle aussi. On observe en effet que les terroristes et apprentis terroristes multiplient les téléphones à cartes qu’ils changent très régulièrement. Dans cette configuration, il ne paraîtrait pas aberrant d’obliger les vendeurs à tenir un registre dans lequel ils inscriraient l’identité de l’acheteur (sur présentation d’une pièce d’identité) et le numéro de la carte (IMSI). Lors d’enquêtes, ces informations pourraient s’avérer très utiles.
Par ailleurs, il est important d’encourager la judiciarisation d’une partie du renseignement administratif sans déclassification systématique. Cela renforcerait plus encore la complémentarité déjà évoquée. Dans cette configuration, une réflexion pourrait être nouée autour de la question du dossier distinct créé par la loi précitée relative à la géolocalisation. Celui-ci permet de soustraire au débat contradictoire certaines informations sensibles, accessibles uniquement aux magistrats. Si le Conseil constitutionnel a considérablement restreint la portée de cette disposition[23] Décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014., il existe une voie à suivre pour, par exemple, créer un contrôle juridictionnel des informations contenues dans ce dossier ou s’inspirer du special advocate britannique qui, sans être avocat des parties et sans appartenir à l’autorité judiciaire, s’assure de la loyauté des informations. De ce fait, l’aménagement du débat contradictoire pourrait permettre la communication, par les services de renseignement, d’éléments décisifs pour la compréhension du dossier sans toutefois fonder une condamnation sur leur seule foi. Une évolution de ce type serait d’autant plus opportune qu’elle pourrait bénéficier de la question préjudicielle introduite dans la loi relative au renseignement et qui permet de s’assurer de la légalité des données collectées (article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure).
Ces quatre thématiques, si elles ne sont pas les seules, seront déterminantes pour l’avenir de la police judiciaire. Le voile pudique que les responsables politiques ont pour l’instant jeté sur elles, au regard de leur complexité, mais également des intérêts en jeu, ne saurait tenir lieu de réponse définitive. Il est désormais indispensable de progresser sur ces sujets.
Le projet de loi Collomb s’inscrit donc dans le droit fil de dix années de législation qui, de manière inégale et erratique, ont créé les conditions de l’actuel contournement de l’autorité judiciaire dans la prévention du terrorisme, d’une mise en concurrence faussée à tout le moins.
Pareille œuvre législative a d’ailleurs révélé sa pleine mesure avec la déclaration et la prolongation abusive de l’état d’urgence, puis sa transposition dans le droit commun.
Or, loin de rétablir un précaire équilibre, le projet de loi vient consacrer les dévoiements qui étaient en germe ou partiellement révélés. Il fait fi des libertés pour une recherche désespérée d’efficacité.
Mais l’entreprise est vaine et la logique qui l’anime s’avère opérationnellement incompréhensible, sauf à témoigner de la volonté de puissance d’un pouvoir exécutif terrifié à l’idée d’être accusé de n’avoir pas suffisamment œuvré dans le domaine de l’antiterrorisme.
Si le terrorisme abîme les corps et corrompt les esprits, il participe également à l’affaissement de nos systèmes démocratiques qui se fourvoient dans les mécanismes de défense mis en œuvre pour parer à toute forme de menace. Dans ce contexte, la plus belle des victoires contre le terrorisme consisterait finalement à résister à notre pente funeste.
Notes
| ↑1 | Acronyme pour passenger name record, ce traitement automatisé des données des passagers aériens destiné à surveiller les déplacements de certains individus. |
| ↑2 | Décision n° 2016-590 QPC du 21 octobre 2016 qui a censuré l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure et Décision n° 2017-648 QPC du 4 août 2017 qui a censuré une phrase de l’article L. 851-2 du même code. |
| ↑3 | L’article modifié avait été initialement créé par la loi du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs. |
| ↑4 | Le texte prévoit ainsi la simple information du procureur de la République pour la mise en place des périmètres de sécurité (article 1er), la mise en œuvre de perquisitions (article 4), la décision de soumettre une personne assignée à résidence à certaines obligations (« pointage » au commissariat ou à la gendarmerie, interdiction de se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique, déclaration de son lieu d’habitation ou changement de lieu d’habitation ou encore son placement sous surveillance électronique mobile (article 3). Il requiert l’autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD) pour les perquisitions et saisies documentaires tandis que la retenue sur les lieux de la perquisition (pendant un délai maximal de quatre heures) ne donne plus lieu qu’à une information du JLD depuis le passage du texte en Commission des Lois de l’Assemblée nationale (article 4). |
| ↑5 | Ces notes, qui ne mentionnent ni le service auteur, ni la source du renseignement, ont été utilisées pendant toute la durée de l’état d’urgence en matière de contentieux des assignations à résidence (CE, 23 décembre 2015, Rachedi, n° 395229). Elles ont été vivement critiquées, à juste titre. Elles ne permettent en effet d’établir aucune certitude judiciaire et placent ainsi le magistrat devant un choix impossible : soit octroyer une confiance quasi-aveugle au(x) service(s) à l’origine de la note, soit décider en son âme et conscience d’annuler la mesure fondée sur des informations invérifiables. |
| ↑6 | Ils réclament par ailleurs une simplification de la procédure pénale classique qui devrait être opérée par un projet de loi annoncé par Gérard Collomb pour le premier semestre 2018. |
| ↑7 | Loi votée en août 1793, au cours de la Terreur. Elle permettait l’arrestation, sans motif et sans preuves, de ceux qui « n’ont pas constamment manifesté leur attachement à la Révolution » ou qui, « n’ayant rien fait contre la Liberté, n’ont rien fait pour elle ». |
| ↑8 | Pour illustrer cette dérive infinie, on se reportera aux dernières propositions de Laurent Wauquiez : Jean-Marc Leclerc et Marion Mourgue, « Laurent Wauquiez : «Sur le terrorisme, je veux des actes» », Le Figaro, 19 septembre 2017. |
| ↑9 | Défini comme une « entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public, par l’intimidation ou la terreur » à laquelle se rattache une série d’infractions pénales. |
| ↑10 | En amplifiant les effets de la loi du 21 juillet 1982 qui avait créé des cours d’assises spéciales (loi du 21 juillet 1982 relative à l’instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l’Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire). |
| ↑11 | Loi du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire. |
| ↑12 | Pour mémoire, elles exercent leurs fonctions selon la summa divisio dessinée dès 1951 par le Conseil d’Etat et le Tribunal des conflits (Conseil d’Etat, Section, 11 mai 1951, Consorts Baud ; Tribunal des conflits, 7 juin 1951, Dame Noualek). A cet égard, en janvier 2006, le Conseil constitutionnel offrait une efficace synthèse de cette répartition des rôles en rappelant que la police administrative :
« • se rattache non à la répression d’une infraction déterminée, mais à la protection de l’ordre public pour faire cesser un trouble déjà né, fût-il constitutif d’infraction, et à la prévention des infractions, • est susceptible d’affecter la liberté de la personne (droit d’aller et venir, enregistrement de données personnelles etc..), mais n’implique ni rétention, ni détention. Elle se distingue donc de la police judiciaire non en ce qu’elle peut affecter la liberté, mais en ce qu’elle n’a pour objet ni la constatation d’une infraction pénale particulière, ni la recherche de ses auteurs, ni le rassemblement de preuves, missions assignées à la police judiciaire par l’article 14 du code de procédure pénale » (« Commentaire de la décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006 », Cahiers du Conseil constitutionnel, n°20, p. 1-2). |
| ↑13 | Loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. |
| ↑14 | Frédéric ROLIN et Serge SLAMA, « Les libertés dans l’entonnoir de la législation anti-terroriste », AJDA, 2006, p. 975. |
| ↑15 | Loi du 20 novembre 2015 ; loi du 19 février 2016 ; loi du 20 mai 2016 ; loi du 21 juillet 2016 ; loi du 19 décembre 2016 ; loi du 11 juillet 2017. |
| ↑16 | Projet de loi prorogeant l’application de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, exposé des motifs, 22 juin 2017, p. 9. |
| ↑17 | Pour plus de détails, se reporter à l’excellent travail de contrôle de l’état d’urgence réalisé par l’Assemblée nationale qui a publié toutes les statistiques relatives aux mesures de celui-ci. |
| ↑18 | Voir en ce sens les écrits de Christian VIGOUROUX, in Du juste exercice de la force, Paris, Odile Jacob, 2017, 304p. |
| ↑19 | Loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (notamment son chapitre III) ; loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. |
| ↑20 | Loi du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme |
| ↑21 | Loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement et loi du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales. |
| ↑22 | Cf. la Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013. |
| ↑23 | Décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014. |