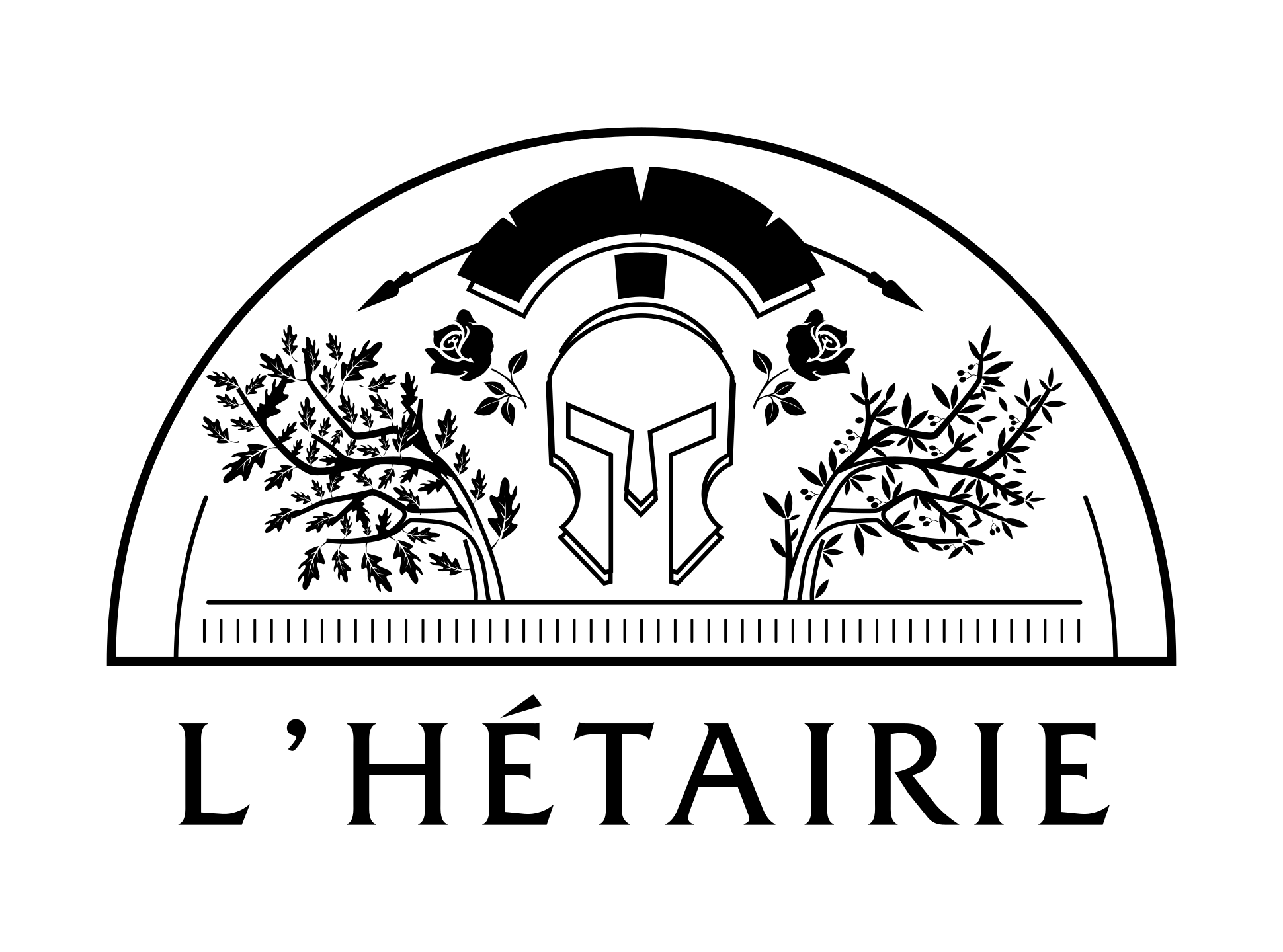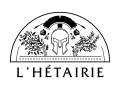Retour d’expérience sur la police de proximité : entretien avec Gilles Sanson [Note #47]
Gilles Sanson est l’un des principaux théoriciens de la police de proximité. Nommé directeur central de la sécurité publique en 1997, il a pour mission de déployer cette novation issue du programme du Parti socialiste.
Mais les difficultés s’accumulent qui finissent par laisser planer un doute sur la volonté du ministère de l’Intérieur de se réformer. De fait, la mise en œuvre du projet revient à l’édulcorer au point de créer les conditions des vives critiques qui seront par la suite formulées.
Gilles Sanson analyse cette réforme de l’Etat qui achoppe. Les enseignements tirés s’avèrent d’une brulante actualité et en tous points transposables à la police de sécurité du quotidien. Aux mêmes objectifs et causes, les mêmes effets ? L’expérience permet toutefois de dessiner une réforme idéale.
Floran Vadillo (FV), Guillaume Farde (GF) : Pouvez-vous revenir sur la genèse de la police de proximité ?
Gilles Sanson : L’idée de promouvoir une police de proximité avait été lancée, avant même la nomination de Jean-Pierre Chevènement au ministère de l’Intérieur, au cours de la campagne électorale de Lionel Jospin. Elle procédait d’un groupe de travail dirigé par Bruno Le Roux, Clotilde Valter et Daniel Vaillant, qui avait mis en avant un tel projet, sans plus définir le concept de police de proximité mais en évoquant un certain nombre de points d’ancrage pour cette dernière. Parmi ceux-ci, figurait son déploiement dans le cadre d’une coproduction repensée de la sécurité locale, formalisée par des contrats plus consistants conclus avec les collectivités territoriales et les acteurs privés. En outre, elle devait pouvoir bénéficier de ressources nouvelles. Il avait été imaginé, à ce titre, de procéder au recrutement d’une catégorie inédite d’emplois aidés, intermédiaires entre des policiers de plein exercice et des acteurs sociaux : les adjoints de sécurité (ADS). Au stade de la campagne, l’idée de police de proximité se résumait à cela. Il s’agissait plutôt d’une intuition, issue d’un feuillet de quelques pages sur la sécurité.
De fait, lorsque Jean-Pierre Chevènement arrive place Beauvau, il reprend ce dessein sans pour autant savoir encore comment l’étoffer et il cherche donc à conforter la réflexion à ce sujet.
Il décide dès le mois de juillet 1997 d’organiser un colloque sur les problèmes de sécurité, et notamment de police de proximité, précédé d’importants travaux préparatoires. Au sein de l’Inspection générale de l’administration, j’ai été désigné pour assumer des fonctions de rapporteur et superviser la préparation. Ce colloque dit « de Villepinte » constituera une réussite. Beaucoup de gens y participeront. Il sera considéré comme fondateur de la nouvelle pensée de la gauche en matière de sécurité publique.
Le ministre avait une vision très républicaine et centralisatrice de la police. Or, les exemples étrangers de police de proximité (Allemagne, Canada, Royaume-Uni, Etats-Unis) auxquels on pouvait de prime abord se référer ont été initiés et fonctionnent dans le cadre d’organisations policières décentralisées. Le rapport à la population s’y exprime de façon plus simple. La réforme au plus près du terrain est plus aisée, l’expérimentation facilitée par des circuits courts de décision.
Pour autant, ces exemples restaient susceptibles de constituer une source d’inspiration : des pétitions telles que la police « est là pour résoudre les problèmes tels qu’ils se présentent localement », et qu’à cette fin, « pour être en phase avec la demande sociale, elle doit se montrer pragmatique et afficher une sympathie étroite avec son environnement d’intervention » méritaient reprises et déclinaisons.Mais lorsque moi ou d’autres évoquions la possibilité de s’inspirer des polices communautaires anglo-saxonnes, le ministre marquait une certaine hostilité traduisant une incompréhension ou une méconnaissance de ce qu’elles représentaient. Il ne souhaitait pas s’engager dans cette voie.
Pour des républicains plus traditionalistes (au cabinet du ministre comme au sein du ministère ou à la Préfecture de police de Paris), cela n’était pas très audible ; ils s’en tenaient avant tout, initialement, à l’objectif d’un déploiement reformulé de la police nationale qui favorise simplement une plus grande visibilité des personnels en tenue sur la voie publique. L’îlotage constituait ainsi la forme idéalisée mais limitée de ce que pourrait être une police de proximité. Et en ce sens, l’un des critères régulièrement mis en avant à l’époque, notamment par le ministre, était le ratio de secteurs d’îlotage créés. Il s’agissait d’une vision somme toute assez peu imaginative, raisonnant prioritairement en termes de répartition territoriale des forces et prônant un maillage d’intervention le plus serré qui soit. Il fallait « montrer du bleu » le plus possible pour rassurer les gens. On retirait des personnels des états-majors pour les mettre sur le terrain, on faisait un peu moins de BAC et un peu plus de relations publiques, on développait l’accueil dans les commissariats. Cela correspondait à une conception managériale finalement pas très riche sur le plan politique et social. Du côté des partenaires sociaux, les syndicats ne se montraient guère productifs pour conceptualiser une réforme de ce type ; la plupart d’entre eux n’envisageait pareillement la police de proximité que sous le seul angle de l’ilotage.
D’autres, au contraire, notamment au cabinet du Premier Ministre (comme Clotilde Valter) ou moi-même à la direction centrale de la sécurité publique, poussions à une réforme plus ambitieuse qui conduise à une révolution de culture de la police, spécifiquement de ses modalités d’exercice dans les quartiers.
Dès le début, ce projet de réforme s’est donc heurté, au sein de la chaîne hiérarchique, à une absence de consensus autour du concept à mettre en œuvre. La police de proximité a fait l’objet de débats internes et d’analyses non totalement superposables. Or, il a fallu du temps pour arbitrer entre ces différentes visions. Un flou a longtemps régné.
FV et GF : Quelles étaient les principales caractéristiques de votre projet de police de proximité ?
GS : Je souhaitais pour ma part qu’on ne s’en tienne pas à un schéma classique de seul redéploiement des effectifs, d’arbitrages de zones de compétences entre la police et la gendarmerie ou de répartition de responsabilités entre les différentes directions (moins de CRS, plus de sécurité publique…) ou de quadrillage territorial plus fin, bien que tout ceci ne soit pas dénué d’importance et de difficultés de mise en œuvre.
J’étais partisan d’une police plus attentive à la multiplicité de nature des besoins exprimés localement par les habitants des quartiers. La population au service de laquelle nous œuvrions devait être considérée de façon systématiquement moins globalisante, mais traitée au travers de politiques plus sectorielles ou différenciées : qu’il s’agisse des d’actions à mener à l’égard des victimes, des jeunes, des femmes, des professions à risques etc. Il fallait scinder et analyser mieux les attentes de chacun. Celles-ci ne se réduisent pas à la seule diminution des taux de délinquance. Elles appellent une meilleure prise en compte de demandes segmentées. Cela conduisait, par exemple, à favoriser et démultiplier l’installation dans les commissariats de psychologues, de référents jeunesse, à porter une extrême attention à l’accueil et à la prise de plaintes.
Il convenait aussi d’instituer plus de proximité dans les schémas de prise de décisions : il fallait à ce titre déconcentrer l’appareil administratif, organiser les commissariats de manière règlementairement moins stéréotypée avec un plus grand souci des spécificités de terrain, octroyer aux échelons intermédiaires des capacités propres de gestion et d’intervention plus étendues, introduire plus de flexibilité dans l’organisation des cycles de travail. La police souffre d’une hypertrophie de la tête et d’un manque de confiance dans les échelons subalternes. Cela requerrait un réaménagement profond des niveaux de responsabilités.
Au demeurant, rien que le calibrage local des effectifs reste un exercice complexe. Ainsi, la préconisation d’indexer le nombre de policiers dans un commissariat sur le nombre d’habitants était-elle d’évidence trop rigide. Toutefois, dans le cadre des discussions budgétaires avec Bercy, si vous ne présentez pas un modèle standardisé d’organisation territoriale, vous vous faîtes « laminer ». Les administrations qui gèrent des réseaux déconcentrés importants rencontrent des problèmes identiques, à l’instar des Affaires étrangères qui peuvent avoir un mal fou à justifier le nombre souhaitable de personnes en poste à Oulan-Bator ou à Lagos. Les facteurs ponctuels avec lesquels il convient de composer sont multiples (poids de l’histoire, viscosités politiques, spécificités sociologiques ou géographiques). En même temps, il était vital de procéder à un rééquilibrage en faveur des banlieues oubliées.
A ce stade déjà, il s’agissait donc d’évolutions lourdes, appelant l’engagement de tout l’appareil administratif et non de la seule DCSP. Mais au fond, ces trois premiers aspects relevaient d’une gestion de l’administration et de types de préoccupations malgré tout plutôt classiques. Les choses se corsaient dès lors qu’il apparaissait nécessaire d’introduire un modèle de police plus novateur encore, seul susceptible de garantir une efficacité de l’institution et une satisfaction effective des usagers. Un modèle qui ne butte plus par exemple sur des spirales stériles et chroniques d’affrontements avec les jeunes dans les banlieues ou sur le sentiment des citoyens qu’on ne traite pas, ou pas avec suffisamment d’attention, leurs problèmes, ceux auxquels ils sont personnellement confrontés.
Ainsi, police d’ordre et politique du chiffre ne font pas bon ménage au traitement du sentiment d’insécurité. Ce dernier, certes difficilement mesurable, exige un traitement. Une réponse sécuritaire doit être apportée dans un endroit où certes, en termes de statistiques délictuelles, il peut ne rien se passer mais où pourtant tous la réclament. Or, ce type de considération était traditionnellement tout à fait étranger aux autorités centrales.
On devait donc passer par un renversement complet de la hiérarchisation des priorités d’action de la police. Il fallait faire admettre que désormais la demande sociale locale en matière de sécurité quotidienne devait primer sur celle des autorités ministérielles, centrales ou départementales. Il fallait s’organiser à ce titre pour appréhender mieux cette attente de la population, en mettant au point de nouveaux outils. La réalisation de diagnostics de sécurité dans le cadre des politiques contractuelles se mettant parallèlement en place en était l’un d’entre eux. Elle nécessitait un travail sérieux, sans précipitation, permettant à chacun de s’inscrire dans une démarche partagée.
Or, l’histoire a témoigné d’une précipitation fâcheuse. Les diagnostics de sécurité, qui auraient dû faire l’objet d’une appropriation démocratique, ont été le plus souvent des exercices bâclés et confisqués par des officines. Les contrats locaux eux-mêmes, dont la nature devait être chaque fois singulière, ont été standardisés et leur élaboration stéréotypée accaparée par un trio institutionnel, celui des préfets, des maires et des procureurs. L’exercice n’est jamais lui-même descendu au niveau des quartiers, alors qu’on aurait pu rêver que leur discussion se fasse jusqu’à celui des cages d’escaliers.
Surtout, au bout du bout, je pensais que la caractéristique fondamentale de la police de proximité et son enjeu principal devaient résider dans l’affirmation complémentaire d’un mode de présence et d’intervention dans les quartiers radicalement autre. Plus exactement, il s’agissait de repenser le principe d’autorité et ses modalités de déploiement.
Il convenait de faire en sorte que l’action de la police ne repose plus aussi exclusivement sur deux ressorts immédiats mais à chaque fois à hauts risques : l’ordre (autrement dit, l’imposition sans nuances de la force) et le renseignement (administratif ou judiciaire), prologue à la sanction ; mais qu’elle compose plus couramment avec un troisième ressort, plus subtil et plus approprié à la vie quotidienne en société, où l’injonction doit être, vaille que vaille spontanément, consentie, c’est-à-dire sans génération mécanique de conflit, par ceux-là même à l’encontre desquels elle s’adresse : qu’elle compose donc avec une autorité naturelle retrouvée.
Pour l’illustrer, on peut recourir à l’image symbolique des rapports des parents à leurs enfants. N’asseoir au sein d’une famille le respect des règles de vie au jour le jour par les enfants que sur l’expression brutale de la contrainte, la surveillance exacerbée et la sanction ne peut conduire qu’à la multiplication de tensions névrotiques. Heureusement, s’impose le plus souvent une autorité qui, parce qu’elle est expliquée et parce qu’elle ne s’affirme ni abusive ni arbitraire, ne voit pas systématiquement sa légitimité contestée et permet ainsi de ne pas transformer chaque admonestation parentale en drame particulier et en affrontement récurrent.
Le projet de police de proximité portait principalement cette ambition de restauration de l’autorité. Mais elle était soumise à une série de conditions très importantes et complexes à mettre en œuvre. Elle impliquait une police plus transparente, qui écoute, informe et rende compte mieux ; une police déontologiquement irréprochable, aux interventions mieux ancrées dans la vie des citées grâce à une connaissance au plus près de l’environnement. Car l’efficacité de long terme de la police ne peut dépendre que du lien de confiance tissé avec la population et de l’approbation, voire de l’appropriation, par cette dernière de ses actions. Ce qui ne manquait pas de soulever à la fois :
- la question du recrutement, de la formation et de la fidélisation des effectifs dans les zones sensibles ;
- des problèmes opérationnels (développer la polyvalence des agents, articuler les forces de première ligne et d’appui, généraliser les techniques de gestion situationnelle des conflits, etc.) ;
En même temps, il fallait mener de très grands efforts de pédagogie au sein des personnels pour susciter leur adhésion, pour ne pas donner l’impression aux unités qu’on les désarmait face à des conditions d’intervention dangereuses ou menaçantes, que promouvoir la proximité ne se réduisait pas au développement exclusif de la prévention mais intégrait tout autant les volets de répression et de protection. Des politiques de fond s’imposaient donc pour accompagner ce déploiement.
Mais le rythme lui-même de la réforme a suscité des débats. Je prônais une mise en place progressive, au travers du lancement d’un certain nombre d’expérimentations locales où l’on aurait testé différentes formules imaginatives. L’idée consistait à démarrer d’abord sur une vingtaine de sites, puis de passer avec circonspection à 40-50, sans négliger des étapes de retours d’expériences et de validation avant d’envisager d’aller plus loin. Mais le temps politique n’est pas le temps administratif. Une généralisation du dispositif bien trop hâtive a finalement primé à l’échelle nationale.
L’effet de taille a été particulièrement complexe à maîtriser. Supervision en des temps très courts des multiples contrats locaux de sécurité en cours d’élaboration, formation et intégration de 20 000 ADS, réouverture d’écoles de formation, redéfinition de leurs programmes, recrutement de formateurs, reformulation d’une doctrine d’emploi…). Cela alors même que cette politique publique procédait d’une direction au cœur de métier opérationnel (avec cette année-là, la sécurité, par exemple, de la coupe du monde de football de 1998 à assurer tout en gardant un œil vigilant en même temps sur les statistiques de la délinquance.)
FV et GF : Vous l’avez évoqué, la police de proximité aurait également nécessité une réflexion pénale…
GS : Oui, mais cette conviction n’a fait l’objet d’un partage que bien plus tardivement. Ainsi, dans le cadre de la dernière campagne présidentielle, le programme du candidat élu prévoyait-il justement de mettre à disposition des outils plus adaptés aux exigences de « la répression de proximité ». Mais à l’époque, il faut bien voir que la réforme de la police de proximité relevait exclusivement du ministère de l’Intérieur qui l’a conduite, sinon contre, du moins sans concertation avec le ministère de la Justice. Il n’y avait pas d’impulsion ministérielle pour réaliser ce travail en commun. Une gestion interministérielle a incontestablement manqué. Or, dans un ministère aussi respectueux des lignes hiérarchiques, on ne pouvait se contenter de bricoler dans son coin avec le ministère de la Justice.
Ainsi, aurait-il fallu à ce moment-là rassurer les policiers dans une situation de transition où les doutes pouvaient naître, en leur donnant la certitude qu’on ne s’engageait pas par ailleurs vers plus de laxisme. Or, simultanément, le ministère de la Justice conduisait les discussions sur la loi relative à la présomption d’innocence, sur la réforme de la garde à vue…, autant de projets qui ont pu générer l’impression aux policiers – à tort ou à raison – d’une politique à contretemps.
FV, GF : La réforme de la sécurité du Grand Paris a-t-elle permis d’améliorer la pratique policière ?
GS : L’extension du périmètre de compétences de la Préfecture de Police fournissait une occasion idéale pour opérer un changement de paradigme dans les pratiques. Elle autorisait une éventuelle récupération d’effectifs des sites les mieux dotés au profit des banlieues les plus à la peine. Pareille péréquation aurait pu permettre de promouvoir une police de proximité dans la petite couronne, ordinairement sous-dotée et de sortir de logiques de la seule police d’ordre au service de l’Etat.
Mais ce n’est pas du tout ce qui a été réalisé. Au contraire, on a privilégié un objectif où toute émeute urbaine devait pouvoir être systématiquement noyée sous un jet d’extincteur par une projection massive de forces d’intervention : BAC mutualisées, compagnies d’intervention (CSI) mutualisées. De fait, après cette réforme, il n’y a pratiquement plus eu de violences urbaines qui fassent tache d’huile. Mais on est resté très loin du compte en matière de politique novatrice de protection et de prévention de la délinquance quotidienne dans les quartiers qui réponde aux besoins de la population.
FV et GF : En définitive, le ministère de l’Intérieur sait-il innover ?
GS : Il a connu des périodes plus riches que d’autres en termes d’innovation. Je pense que Pierre Joxe a incarné, de ce point de vue, un exemple à suivre. Il a engagé un nombre considérable de réformes : la mise en œuvre d’une loi de programmation assortie de moyens budgétaires considérables, une conceptualisation des objectifs, la mise à disposition d’instruments de réflexion comme l’INHESI, la mise en place de l’UCLAT, une refonte totale de la formation… On partait du Moyen-âge sur ce dernier point et, notamment grâce au travail de Jean-Marc Erbès, le produit final demeure très solide.
Par conséquent, le ministère de l’Intérieur peut innover si s’affirment à son sommet une vision cohérente d’ensemble couplée d’une volonté forte. Cela nécessite un investissement personnel, tenace et en profondeur de l’autorité politique, qui assume de prendre en compte les contraintes de gestion d’une politique publique sur du long terme ; qui sache de façon responsable composer entre temps politique et administratif différents ; qui sache dépasser le tropisme naturel de ce ministère qui reste celui de l’opérationnel immédiat.