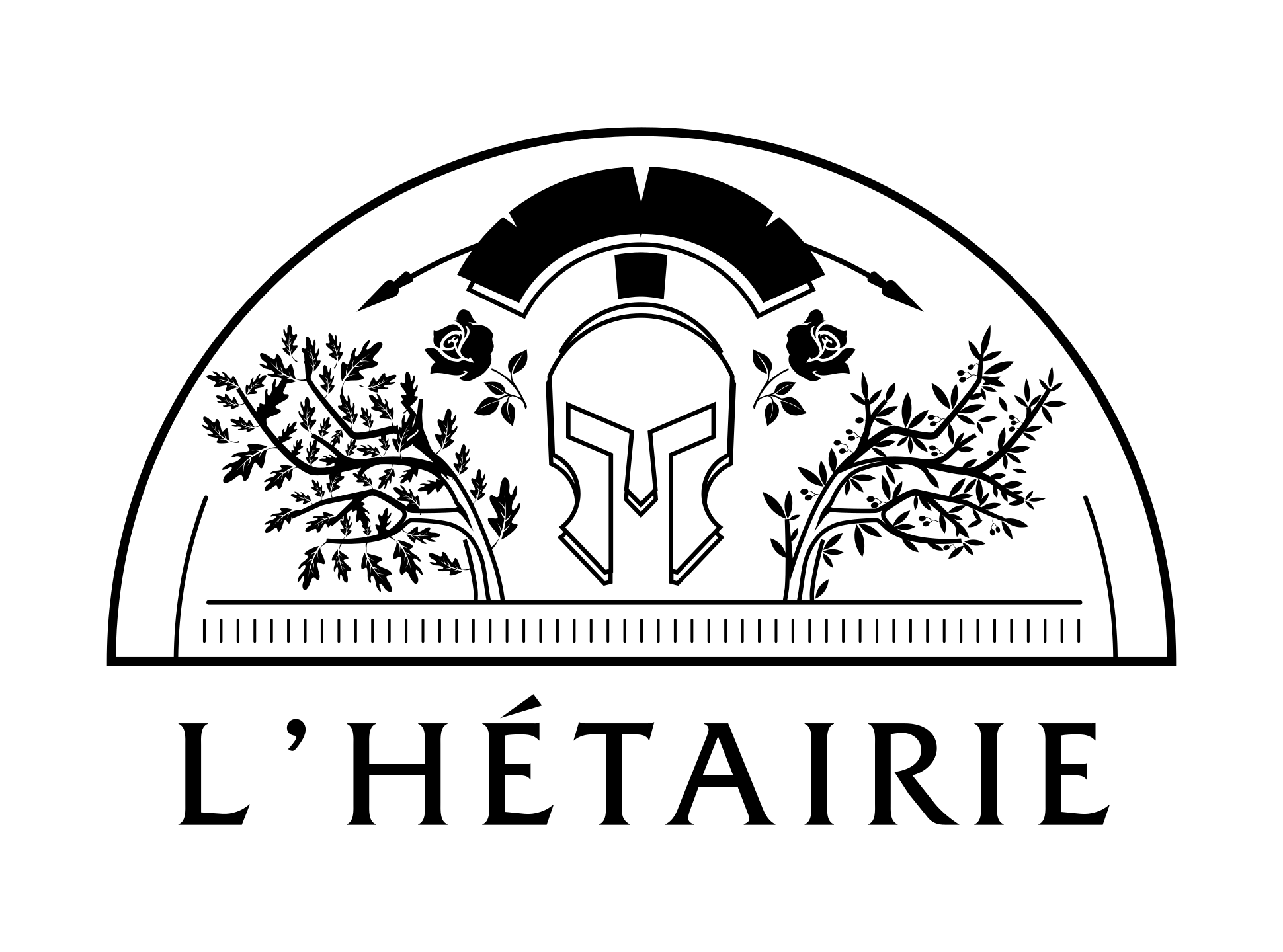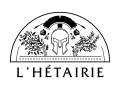De la légalisation du cannabis [Note #14]
A nos lecteurs
L’Hétairie souhaite nourrir le débat d’idées en publiant des contributions de sensibilités très différentes sur la même thématique, y compris lorsqu’elles sont éloignées de l’approche que nous privilégions.
C’est le cas de la présente note qui s’insère dans une série de publications (cf. la note n°11 d’Henri Mica*, la n°12 de Danièle Jourdain-Menninger ou la n°13 de Jean-Pierre Couteron et Nathalie Latour). Car une politique publique ne saurait être définie et mise en œuvre dans l’ignorance des opinions divergentes.
La lutte contre le cannabis se situe aujourd’hui dans une impasse. Depuis l’adoption des premières lois contre les stupéfiants, dans les années 1970, la consommation de drogues n’a cessé d’augmenter. La France se place désormais en tête des pays européens pour la consommation de cannabis : ainsi, en 2014, 17 millions de Français déclaraient-ils en avoir déjà consommé (dont 4.6 millions au cours de l’année et plus de 700.000 quotidiennement) selon l’observatoire français des drogues et des toxicomanies. Plus inquiétant encore, dès l’âge de seize ans, les Français sont les premiers consommateurs de cannabis en Europe[1] Avis « Usage de drogues et droits de l’homme », Commission nationale consultative des droits de l’homme, JORF du 5 mars 2017..
Le choix fait par l’Etat et ses représentants de privilégier le volet répressif, consacrant au passage plus de 568 millions d’euros annuels au maintien de l’ordre et au traitement judiciaire des infractions relatives aux stupéfiants[2] « Cannabis : réguler le marché pour sortir de l’impasse », Terra nova, 19 décembre 2014., explique en partie cette situation catastrophique : la dimension sanitaire, pourtant incontournable, demeure le parent pauvre, comme le traduisent les très insuffisants moyens qui lui sont alloués.
Un changement de paradigme semble dès lors nécessaire afin de basculer d’une logique sécuritaire à une logique sanitaire. Si la politique répressive mise en œuvre depuis de longues années n’a pas permis de lutter efficacement contre la consommation de cannabis – conduisant au contraire à accroître considérablement son coût social -, une politique volontariste et courageuse axée sur la prévention et le traitement des addictions liées au cannabis apparaît désormais comme l’approche la plus cohérente et la plus efficace pour réduire la consommation globale de drogue dans le pays.
Le régime juridique du cannabis : une priorité à la répression sans discernement
Si l’actuel cadre juridique connaît indéniablement un échec au regard de la massivité et de la permanence de ce problème de santé publique, les annonces du gouvernement Philippe ne changeront rien à la situation ; elles correspondent à la perpétuation de l’impasse de la politique publique en ce domaine.
Un cadre juridique qui a fait les preuves de son inefficacité
En France, le cannabis n’a pas de régime juridique propre, même si sa consommation est bien plus répandue que les autres produits considérés comme des drogues et vient en troisième position après le tabac et l’alcool, comme l’illustre le tableau suivant[3] Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017, http://www.drogues.gouv.fr/la-mildeca/le-plan-gouvernemental/priorite-2013-2017.
Ce constat est d’autant plus édifiant que, à l’inverse, « moins de 1 % de la population âgée de 18 à 64 ans a fait usage dans l’année de cocaïne et de poppers. Les chiffres relatifs aux autres substances sont encore plus faibles : moins de 0,5 % pour l’usage d’héroïne dans l’année[4] Ibid. ». Par conséquent, le problème réside moins dans la consommation de drogues que dans celle du seul cannabis.
Son usage extrêmement répandu s’explique d’ailleurs en partie par l’image de drogue douce qu’il charrie, le cannabis n’induisant pas les mêmes conséquences que la consommation de drogues dites dures, à l’instar de la cocaïne. En effet, contrairement à cette dernière, le risque d’overdose mortelle paraît inexistant et sa consommation génère plutôt « une augmentation des temps de réaction et des troubles de la coordination motrice, avec dans certains cas des attaques de panique et des hallucinations[5] Ibid. ». Aussi, ne semble-t-il pas déraisonnable d’établir un parallèle avec une surconsommation d’alcool. A titre d’exemple, au volant, le cannabis multiplie par deux le risque d’accident[6]“The health and social effects of nonmedical cannabis use”, Organisation mondiale de la santé, http://www.who.int/substance_abuse/publications/msbcannabis.pdf, dans les mêmes proportions que l’alcool.
En outre, comme le relève l’Organisation mondiale de la santé, le manque d’études sur les conséquences de l’utilisation du cannabis ne permet pas de cerner ses effets à long-terme, et notamment son impact sur la mortalité.
Ainsi, considéré comme un produit stupéfiant semblable aux autres, obéit-il au même régime fixé tant par le Code de la santé publique que le Code pénal. En effet, les articles 222-34 à 222-43-1 du Code pénal répriment l’ensemble de la chaîne de production des stupéfiants de l’importation à la vente, quand l’article L.3421-1 du Code de la santé publique en prohibe l’usage et prévoit que l’usager s’expose à une peine d’amende et d’emprisonnement.
En conformité avec cette optique, la loi du 31 décembre 1970 fut la première à encadrer l’usage des drogues en France. Ce texte entendait développer une réponse à la fois pénale et sanitaire, comme traduit dans le préambule : « toute personne usant d’une façon illicite de substances classées comme stupéfiants est placée sous la surveillance de l’autorité sanitaire ».
L’injonction de soins relève de cette logique. Pareille mesure se révèle particulièrement adaptée aux enjeux de la toxicomanie, à la lutte contre une éventuelle récidive mais, surtout, à la nécessaire réinsertion du toxicomane au sein de la société. Pourtant, en pratique :
- l’accent est assez largement mis sur les rappels à la loi (66% en 2014), alors que les mesures d’orientation vers des structures sanitaires ne sont prononcées qu’à hauteur de 14% des cas [7] Rapport d’information n°3317 d’Anne-Yvonne LE DAIN et de Laurent MARCANGELI, Assemblée nationale. http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i3317.asp ;
- Plus dramatique encore, le manque de moyens alloués à ces dispositifs fait que, dans 30% des cas, ces mesures ne peuvent être assurées en raison de l’absence de professionnels qualifiés[8] Avis précité de la CNCDH, p. 18..
De surcroît, il a fallu attendre 2007 pour adjoindre à titre de peine complémentaire un stage de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants. Près de quarante ans auront donc passé avant que la dépendance liée à l’usage de ces produits stupéfiants ne soit théoriquement prise en compte. Car, en réalité, cela n’a guère infléchi la politique du tout-répressif et il a fallu attendre dix années de plus pour que la loi du 26 janvier 2016 pérennise les politiques de prévention et de réduction des risques[9] Laquelle loi a créé l’article L3411-8 du Code de la santé publique. !
Quoi qu’il en soit, les évolutions politiques et législatives successives ont aggravé les peines encourues et accentué le taux de poursuite, la circulaire du 16 février 2012[10] Circulaire du 16 février 2012 relative à l’amélioration du traitement judiciaire de l’usage de produits stupéfiants. http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1204745C.pdf allant jusqu’à exiger une réponse pénale systématique à la constatation d’usage de stupéfiants. Ce texte appliqué, le nombre de personnes inquiétées pour simple usage de stupéfiants s’établissait, en 2016, à 140 000 individus, avec un taux de poursuite atteignant 98,2%[11] Cf. Rapport parlementaire d’Eric POULLIAT et Robin REDA du 25 janvier 2018, http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i0595.asp. En outre, 90% des interpellations en matière de stupéfiants sont relatives à l’usage simple et non au trafic ou à des infractions connexes[12] Rapport d’information n°3317, op. cit. (conduite sous l’effet de produits stupéfiants, blanchiment, importations, etc…). Au demeurant, la consommation de cannabis constitue un « délit sans victime : la plupart du temps, les services de police et de gendarmerie n’interviennent pas après le dépôt d’une plainte mais de leur propre initiative[13] Avis précité de la CNCDH, p. 15. ».
Cette logique juridique centrée sur la peine plus que sur le traitement n’est pas isolée. La Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme elle-même reprend l’idée enAsonson son article 5, lequel dispose : « 1. […] Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales […] (e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ». La détention d’un toxicomane est tolérée dès lors que celui-ci représente une menace pour l’ordre public. Pareille position, naturellement justifiée pour des individus violents, traduit néanmoins l’assimilation systématique du toxicomane au délinquant alors que, dans l’immense majorité des cas, il s’agit plutôt d’un malade nécessitant une attention médicale.
Et, de manière générale, les politiques de répression ont conduit à déchirer un tissu social déjà fragile : on relève ainsi que, parmi les individus interpellés en matière de stupéfiants, seulement 3% appartiennent à la catégorie des cadres, artisans ou professions libérales et artistiques, quand les ouvriers constituent 20% de la population concernée. De telles statistiques ne se justifient aucunement par des différences comportementales : le taux de consommation est à peu près uniforme parmi les différentes catégories socioprofessionnelles. La politique du tout répressif conduit donc à sanctionner plus sévèrement des populations qui, de par leur origine ethnique, géographique ou sociale, ont une probabilité plus importante de faire l’objet d’un contrôle de police, c’est-à-dire les populations constituant en quelque sorte une « clientèle policière » habituelle.
En outre, la récidive fait l’objet d’un traitement plus dur encore puisque la politique pénale de ces dernières années a consisté à favoriser « les poursuites devant le tribunal correctionnel[14] Circulaire précitée du 16 février 2012. ». Or, au sens du Code pénal, sera considéré comme récidiviste l’usager préalablement condamné pour un même délit qu’il commet de nouveau avant l’expiration du délai de prescription ; si cette conception s’avère cohérente et utile pour les infractions telles que le vol ou l’escroquerie, elle ne se justifie pas en matière de consommation de stupéfiants ; elle est même particulièrement contre-productive :
- En particulier en raison du potentiel état de dépendance de l’usager ; l’enfermement n’a alors aucun sens puisque l’usage ne répond pas à une volonté propre de ces individus ;
- L’offre de soins, extraordinairement limitée, ne contribue pas à mettre à profit le temps d’incarcération qui se réduit à son expression purement répressive ;
- De fait, le sevrage brutal dû à l’emprisonnement – à supposer que l’on ne puisse se procurer du cannabis en prison, hypothèse parfaitement chimérique – ne sert pas une logique de réinsertion, pourtant l’un des fondements théoriques de la détention ;
- La surpopulation carcérale en France fait de la détention un milieu particulièrement criminogène et l’incarcération encourage ainsi d’autres formes de délinquance.
On le constate, « notre droit est tout entier fondé sur l’idée que la consommation de stupéfiants est, par nature, et quelle qu’en soit l’ampleur, à proscrire[15] Stephane DETRAZ, Gazette du Palais, 21 avril 2012. », délaissant systématiquement la dimension sanitaire et sociale de cette question, pourtant omniprésente en cas de consommation problématique.
Pourtant, en choisissant de privilégier la répression, le législateur a engendré un droit mal taillé, insuffisant pour cerner les enjeux de la lutte contre la toxicomanie. L’accroissement de l’offre pénale, comme la mise en place de mesures alternatives aux poursuites, n’ont pas eu les effets escomptés et ont pâti de moyens défaillants. Et, de ce point de vue, le Gouvernement Philippe s’inscrit parfaitement dans cet héritage délétère.
L’amende délictuelle forfaitaire du Gouvernement Philippe ou la continuation des pratiques actuelles
En dépit des contradictions du dispositif pénal français, voire même de ses effets contreproductifs, le Gouvernement a de nouveau porté son choix sur l’adoption de dispositifs pénaux, revendiqués plus efficaces et moins consommateurs de temps et de moyens pour la force publique. Si l’objectif répressif est clairement affirmé, nous sommes loin de l’objectif de réduction de la consommation de stupéfiants dans l’esprit d’une politique de santé publique efficiente.
D’ailleurs, on peine à saisir la justification d’une sévérité revendiquée : alors que l’état d’ivresse manifeste sur la voie publique n’est réprimé que par une contravention de la deuxième classe (35€) en vertu de l’article R.3353-1 du Code de la santé publique, la consommation de cannabis mérite-t-elle de constituer un délit passible, non seulement d’une amende élevée, mais aussi d’une peine d’emprisonnement ferme ? La rigueur d’une telle répression potentielle nuit indiscutablement à la crédibilité du dispositif et, par là même, à celle du législateur…
Ces annonces se rangent, une fois encore, dans la catégorie des effets de communication finement calibrés pour donner l’impression d’une évolution salutaire dans la lutte contre le trafic de drogue. Elles reposent d’ailleurs sur des principes discutables.
En effet, souvent comparées aux infractions routières, les délits relatifs aux stupéfiants, s’ils constituent eux aussi un contentieux de masse, ne relèvent pas de la même philosophie pénale. Car, si la répression des délits routiers a fait l’objet d’une très large automatisation de la répression (avec l’instauration de radars automatiques, des mécanismes de retraits de points et de la forfaitisation des amendes délictuelles), il semble insensé de reproduire ce régime en matière de lutte contre les stupéfiants : là où la répression routière a pour objectif de sauver des vies, et où les comportements dangereux portant une atteinte considérable à l’ordre public ne se justifient pas, la lutte contre le trafic et l’usage de stupéfiants a, quant à elle, pour but de préserver la santé des consommateurs éventuels et, en cas d’addiction, de les aider à trouver des solutions de désintoxication. Dans ce cadre, la préservation de l’ordre public est – ou du moins était – une finalité tout-à-fait secondaire, à raison.
L’abandon de l’objectif sanitaire, pourtant affirmé par les gouvernements successifs pour justifier de la prohibition de ces substances, s’exprime avec la plus grande acuité dans cet alignement de deux régimes différents. En effet, sans considération pour la situation personnelle du fautif, le rythme de sa consommation, son niveau de dépendance et sa condition sociale, comment penser qu’une telle réponse pénale, mécanique, encouragera quiconque à recourir à des soins appropriés ?
De surcroît, le ministère public appréciera la possibilité de compléter ou non cette première sanction par des mesures allant de l’obligation de soins à une peine de prison ferme et décidera d’éventuelles poursuites supplémentaires. Si, à première vue, cette solution semble davantage pertinente au regard des objectifs de santé publique et de l’individualisation de la peine, il est fort probable, au regard des moyens actuels de la justice, que les magistrats ne s’encombreront pas de procédures supplémentaires et se contenteront du prononcé de l’amende forfaitaire délictuelle. A contrario, dans l’hypothèse de l’engagement de poursuites postérieures, on assisterait alors à un cumul de peines autrement plus lourdes que celles existant aujourd’hui, et ce pour une infraction dont l’importance apparaît fortement discutable.
Il est donc nécessaire d’envisager d’autres pistes. Or, l’assimilation du cannabis aux autres drogues ne favorise guère une politique publique efficiente. Par conséquent, la question de sa légalisation semble légitime, notamment au regard du coût social que la consommation comme la répression ont engendré. Car une réforme pertinente pourrait apporter des solutions efficaces aux lourds problèmes évoqués précédemment, sans entraîner mécaniquement une hausse significative et dangereuse de la consommation de substances illicites
La légalisation du commerce et de la consommation de cannabis sous conditions : une solution courageuse et pertinente
Légaliser le cannabis sous certaines conditions est une mesure de bon sens, conforme aux objectifs d’ordre et de santé publics, à condition de parvenir à mettre en place des schémas de consommation et de commerce adaptés. En outre, cette légalisation pourrait améliorer significativement les politiques de santé publique afférentes à la consommation de stupéfiants.
Une légalisation pour une consommation adaptée et vertueuse
Afin de s’assurer de la profitabilité optimale d’une telle légalisation, il s’agirait non seulement d’encadrer les possibilités d’acquisition des matières stupéfiantes, mais également de circonscrire les lieux et les modes d’achat à certaines zones.
En premier lieu, sur le plan de la stricte consommation, il conviendrait de s’assurer que les individus concernés ne connaissent pas de dérives sociales et psychologiques. Cela implique bien entendu de maintenir l’interdiction totale de ce type de produit pour les mineurs.
En outre, il semble nécessaire de soumettre la consommation à une autorisation préalable afin d’attester de l’absence de contre-indication au regard de l’état psychologique et psychiatrique de l’intéressé. Cette autorisation, nominative et temporaire, serait nécessaire pour acheter et transporter du cannabis. Ne pourrait la délivrer qu’un membre du corps médical habilité et reconnu comme tel (en particulier des psychiatres), à l’occasion d’une consultation dont le patient supporterait intégralement le coût : indépendante du traitement d’une pathologie, cette consultation et les actes afférents à la consommation de cannabis ne sauraient incomber à la sécurité sociale. De plus, le caractère temporaire et renouvelable annuellement de cette autorisation favoriserait le suivi des consommateurs et de l’absence de dérives.
Seules des boutiques agréées par les services de l’Etat pourraient vendre du cannabis[16] Cette question fera l’objet de plus amples développements dans une prochaine publication, en particulier sous l’ange de l’implantation géographique des boutiques envisagées. En effet, elle … Continue reading. L’agrément devra ainsi permettre de contrôler la qualité des substances proposées au public, comme le pratiquent tous les pays ayant d’ores et déjà légalisé la consommation de cannabis.
Au surplus, l’achat de substances s’opérerait uniquement via un moyen de paiement sécurisé et traçable, et ce pour s’assurer de la légalité de l’acquisition de la marchandise. Lors de tout contrôle ultérieur du consommateur par des forces de sécurité intérieure, celui-ci devrait présenter non seulement l’autorisation mais aussi la preuve de l’achat de sa substance dans une boutique agréée. En cas de violation de ces obligations, il y a lieu de maintenir la qualification pénale aujourd’hui applicable.
Enfin, pareille option offre également l’avantage d’officialiser une économie jusqu’ici souterraine mais bien réelle, mais aussi de dégager des recettes fiscales du fait des taxes sur la consommation et de l’imposition des bénéfices.
Une légalisation induisant de nouvelles possibilités d’action publique
Comme évoqué, la légalisation du cannabis dégagerait des marges budgétaires nouvelles réemployables, d’une part, pour sensibiliser davantage les populations vulnérables sur les risques sanitaires du cannabis, et d’autre part, pour financer des infrastructures de soin plus performantes au profit des personnes toxicomanes.
Au regard de l’âge des premières expérimentations, il s’avère indispensable d’exposer en particulier aux jeunes les risques liés à la consommation de cannabis, notamment dans les établissements scolaires. En effet, alors que près d’un quart des élèves ont déjà consommé du cannabis lorsqu’ils sortent du collège, les politiques de prévention mises en place apparaissent largement sous dimensionnées[17]« Synthèse des connaissances », Observatoire français des drogues et des toxicomanies, septembre 2017.. La juste contrepartie d’une légalisation réside donc dans des politiques de prévention déployées plus massivement, notamment grâce aux revenus induits par ces nouvelles activités.
Sur le plan judiciaire, la légalisation du cannabis allègerait considérablement la quantité de travail et les missions des forces de l’ordre. Avec 111 376 procédures initiées dans l’année 2015 pour simple usage de stupéfiants[18] Assemblée Nationale, Question écrite avec réponse n° 80374, 2 juin 2015., le temps consacré par la force publique à la question du cannabis s’avère colossal, de même que le gaspillage d’argent public puisque ces procédures coûtent chaque année près de 450 millions d’euros aux ministères de l’Intérieur et de la Justice[19] Document de politique transversale (DPT) annexé au projet de loi de finances 2015 et intitulé « Politique de lutte contre les drogues et la toxicomanie », programmes 176 et 152..
De plus, la part de détenus dans les prisons françaises pour trafic de stupéfiants s’élevait à environ 14% en 2013, soit 8 500 personnes sur 60 344 personnes détenues. La surpopulation carcérale chronique en France pourrait trouver dans la légalisation un bol d’air inattendu afin de réduire la pression supportée par l’administration pénitentiaire.
Par conséquent, la légalisation du cannabis favoriserait le redéploiement de marges de manœuvre budgétaires et humaines vers d’autres missions plus importantes pour les missions de police et de gendarmerie, dans un contexte budgétaire contraint et alors que le besoin sécuritaire est particulièrement pressant. Elle conférerait également de la cohérence à la politique pénitentiaire à l’heure où le gouvernement Philippe a renoncé à la construction des places de prison supplémentaires pourtant prévues par la précédente législature.
En substance, à ce jour, la politique répressive en matière de consommation de cannabis ne se justifie ni par un risque sérieux de trouble à l’ordre public, ni par des risques sanitaires excessifs, ni par une diminution significative de la consommation de ces produits. Elle nécessite en revanche des moyens considérables d’enquête et de poursuites et alourdit inutilement les missions qui pèsent sur les forces de sécurité intérieure et les autorités judiciaires.
Les récentes annonces du Gouvernement Philippe ne remettent malheureusement pas en cause le caractère purement répressif des politiques appliquées jusqu’à présent, alors même qu’elles n’ont abouti qu’à des échecs. En proposant de systématiser les sanctions sans même évoquer d’autres hypothèses, le risque est grand de passer une nouvelle fois à côté de la seule solution efficace, celle d’une légalisation encadrée.
En effet, en autorisant la consommation de cannabis sur le territoire national tout en limitant les points de vente, l’Etat s’assurerait le contrôle d’un phénomène aujourd’hui hors de sa portée. L’accès à ces produits ferait l’objet d’un contrôle par le biais d’un système d’autorisation préalable et temporaire, et un suivi médical des consommateurs serait assuré aux frais de ces derniers. En outre, les moyens humains et financiers ainsi récupérés permettraient la mise en place de politiques préventives et curatives autrement plus efficientes que celles appliquées actuellement.
Notes
| ↑1 | Avis « Usage de drogues et droits de l’homme », Commission nationale consultative des droits de l’homme, JORF du 5 mars 2017. |
| ↑2 | « Cannabis : réguler le marché pour sortir de l’impasse », Terra nova, 19 décembre 2014. |
| ↑3 | Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017, http://www.drogues.gouv.fr/la-mildeca/le-plan-gouvernemental/priorite-2013-2017 |
| ↑4, ↑5 | Ibid. |
| ↑6 | “The health and social effects of nonmedical cannabis use”, Organisation mondiale de la santé, http://www.who.int/substance_abuse/publications/msbcannabis.pdf |
| ↑7 | Rapport d’information n°3317 d’Anne-Yvonne LE DAIN et de Laurent MARCANGELI, Assemblée nationale. http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i3317.asp |
| ↑8 | Avis précité de la CNCDH, p. 18. |
| ↑9 | Laquelle loi a créé l’article L3411-8 du Code de la santé publique. |
| ↑10 | Circulaire du 16 février 2012 relative à l’amélioration du traitement judiciaire de l’usage de produits stupéfiants. http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1204745C.pdf |
| ↑11 | Cf. Rapport parlementaire d’Eric POULLIAT et Robin REDA du 25 janvier 2018, http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i0595.asp |
| ↑12 | Rapport d’information n°3317, op. cit. |
| ↑13 | Avis précité de la CNCDH, p. 15. |
| ↑14 | Circulaire précitée du 16 février 2012. |
| ↑15 | Stephane DETRAZ, Gazette du Palais, 21 avril 2012. |
| ↑16 | Cette question fera l’objet de plus amples développements dans une prochaine publication, en particulier sous l’ange de l’implantation géographique des boutiques envisagées. En effet, elle soulève notamment des problématiques lourdes en matière de transition d’une économie souterraine vers une économie officielle. |
| ↑17 | « Synthèse des connaissances », Observatoire français des drogues et des toxicomanies, septembre 2017. |
| ↑18 | Assemblée Nationale, Question écrite avec réponse n° 80374, 2 juin 2015. |
| ↑19 | Document de politique transversale (DPT) annexé au projet de loi de finances 2015 et intitulé « Politique de lutte contre les drogues et la toxicomanie », programmes 176 et 152. |