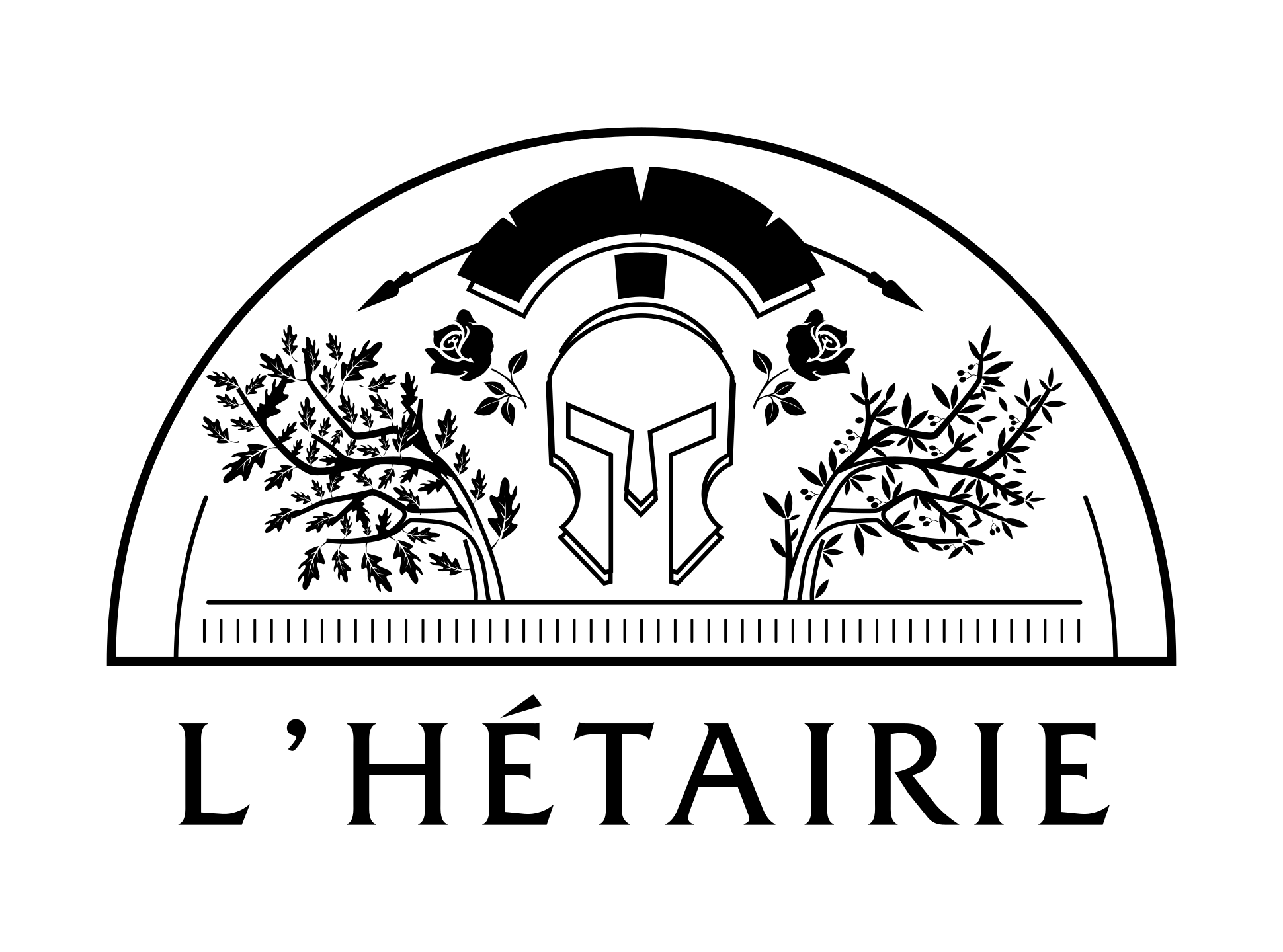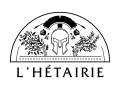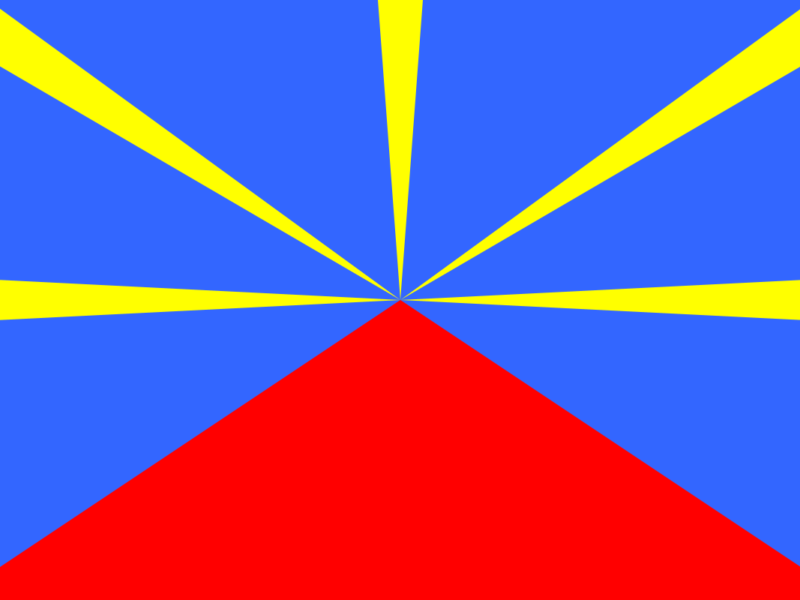Contrôle de constitutionnalité : débat autour d’une clause de dernier mot au profit du Parlement [Livret #9]
Série « La réforme des Institutions » (8)
Introduction : à qui revient le dernier mot ?
par Jean-Philippe Derosier
Au début du XXe siècle, une controverse doctrinale agita les théoriciens de l’État et du droit constitutionnel pour savoir qui devait être le gardien de la Constitution. Les deux positions, respectivement incarnées par Hans Kelsen et Carl Schmitt, s’opposaient sur la nature juridictionnelle ou politique de ce gardien :
- Kelsen soutenait que le gardien de la norme juridique suprême ne devait avoir qu’une vocation et une existence juridiques, en n’étant subordonné à aucun autre pouvoir ;
- Schmitt considérait pour sa part que le gardien de la norme politique fondamentale de l’État coïncidait avec l’autorité politique fondamentale.
Si désormais la controverse paraît globalement tranchée au profit du juge constitutionnel, on en retrouve toutefois une trace dans la Constitution de la Ve République, l’une des rares à encore établir un « double gardiennage » :
- D’une part, en créant un Conseil constitutionnel et à travers le contentieux que ce dernier a développé — surtout depuis 1971 —, il existe un juge constitutionnel en charge de la préservation des droits et libertés que la Constitution garantit ;
- D’autre part, l’article 5 de la Constitution confie au Président de la République le soin de « veille[r] au respect de la Constitution ».
Néanmoins, on assiste à une résurgence de cette controverse ancienne qui paraît aujourd’hui évoluer : l’interrogation n’est plus « qui doit être le gardien de la Constitution ? », mais « à qui doit revenir le dernier mot en matière constitutionnelle ? » ou, plus précisément, en matière de préservation des droits et libertés constitutionnellement garantis.
Le débat qui vous est proposé en constitue la parfaite illustration. Il souligne que, si la question du « gardien » semble désormais tranchée, celle de sa légitimité, quant à elle, ne l’est toujours pas.
Car c’est bien cela qui ressort de ces deux controverses qui, au final, pourraient n’en former qu’une seule. La figure du « juge », indépendant mais nommé – et sans doute indépendant parce que nommé – continue de poser question en termes de légitimité démocratique, du moins dans notre modèle européen de justice constitutionnelle. Les défenseurs d’un droit de dernier mot au profit du Parlement considèrent ainsi qu’un tel juge ne saurait remettre en cause l’expression de la volonté générale, car elle correspond à l’expression de la souveraineté nationale. Ou alors, si le juge est en mesure de le faire, en application du principe de la séparation des pouvoirs justifiant que le pouvoir du juge « arrête » le pouvoir du législateur, selon la terminologie de Montesquieu, ce législateur doit être en mesure, à son tour, de passer outre, en imposant sa position.
Et à ceux qui seraient alors tentés d’ajouter qu’il faudra quelqu’un pour freiner le législateur qui lui-même freina le juge qui avait arrêté le législateur, il est aisé de répondre que cette circularité doit bien cesser un jour et qu’il est logique, dans une démocratie, qu’elle cesse au niveau de la représentation nationale.
Toute cette argumentation repose ainsi sur le principe de souveraineté nationale (ou populaire), qui gouverna d’ailleurs toute la doctrine du culte de la loi au cours du XIXe siècle et qui justifiait, surtout, la souveraineté parlementaire. Le raisonnement était simple : la Nation est souveraine, le parlement représente la Nation, donc le parlement est souverain.
Mais la question peut être abordée différemment : non en termes de légitimité démocratique, mais en termes de légitimité constitutionnelle. Car la démocratie ne garantit pas davantage une légitimité que la légitimité ne suppose systématiquement la démocratie.
La légitimité d’un pouvoir c’est l’exercer de telle sorte qu’il soit accepté par ceux auxquels il est destiné. Ainsi, la démocratie assure-t-elle sans doute un haut degré de légitimité du pouvoir, puisque les destinataires de ce dernier sont également ceux qui en sont la source, voire qui l’exercent.
Néanmoins, un pouvoir qui a vocation à préserver l’ordre fondamental (c’est-à-dire la Constitution) peut se prévaloir d’une autre légitimité, le plaçant au-delà des aléas partisans et des soubresauts institutionnels que la démocratie favorise inévitablement et heureusement. Or la consécration constitutionnelle du juge du même nom, permettant de lui conférer autonomie et indépendance (et à condition de le faire effectivement), octroie à ce juge une légitimité certes moins démocratique, mais tout aussi effective.
En effet, sa légitimité constitutionnelle lui permet de préserver les droits et libertés des individus et d’être ainsi lui-même accepté par ceux auxquels son pouvoir s’adresse. Et si tel ne devait plus être le cas, la légitimité démocratique surgirait à nouveau, non plus alors en termes de « dernier mot » à l’égard d’une décision du juge, mais de remise en cause de son propre positionnement, par une intervention du souverain et d’une modification de l’ordre constitutionnel.
Ce débat vieux d’au moins un siècle, mais toujours actuel, concerne donc le fondement même de notre démocratie, car il interroge l’expression du souverain. Les contributeurs le prouvent à travers leurs riches réflexions et L’Hétairie les en remercie.
Pour une clause constitutionnelle de « dernier mot » au profit du Parlement
par Jean-Eric Schoettl
Le bouleversement de nos démocraties par l’hypertrophie des droits fondamentaux
L’hypertrophie des droits fondamentaux, et plus précisément des droits subjectifs, opposables par un particulier à une personne publique, caractérise l’évolution du droit, en France comme partout en Occident, depuis un demi-siècle. Le droit devient en effet, pour les militants de la transformation radicale de la société, le champ de bataille principal, alors qu’il n’était, pour leurs prédécesseurs marxistes, qu’une superstructure bourgeoise dont il fallait dénoncer les faux semblants. Or, tout en mettant un point d’honneur à respecter les droits et libertés individuels, notre système juridique ne doit pas tout leur sacrifier, notamment pas la solidarité et la cohésion sociales.
Dans le détail, les origines des droits fondamentaux sont multiples :
- Les uns ont leur siège dans des textes constitutionnels ou conventionnels anciens (comme le droit de propriété, le respect de la vie privée ou la liberté religieuse), mais la jurisprudence les décline dans des contextes nouveaux ou leur donne une portée inédite ;
- D’autres sont ajoutés à l’ordonnancement juridique par la révision constitutionnelle (droit du public à participer aux décisions ayant une incidence sur l’environnement), le traité (recours individuels devant la Cour de Strasbourg) ou la loi (droit au logement opposable de la loi du 5 mars 2007, droit de tous les enfants scolarisés à l’’inscription à la cantine des écoles primaires, institué par l’article 186 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté, etc.) ;
- D’autres enfin sont « découverts » par le juge, sans ancrage textuel véritable (principe de confiance légitime, vie familiale normale, principe de fraternité…).
Selon leur nature, les droits fondamentaux contraignent différemment le législateur :
- Les droits-libertés limitent toujours plus strictement les marges de manœuvre de l’Etat régalien, lorsque celui-ci entend faire prévaloir l’intérêt général ou sauvegarder l’ordre public ;
- Les droits-créances assujettissent les pouvoirs publics en général et le législateur en particulier à une obligation de résultat, les transformant en simples courroies de transmission d’un logiciel rédempteur supra-législatif qui dénie aux élus de la Nation leurs prérogatives d’arbitrage.
Là en effet où un droit est proclamé, surtout si c’est un droit créance, le pouvoir politique et son bras administratif sont sommés d’exaucer. Ils ne peuvent plus arbitrer, ce qui est pourtant au coeur du politique.
La subséquente hypertophie de la place du juge
Car l’engouement pour les droits fondamentaux, pavé des meilleures intentions humanistes, évince toujours davantage l’intérêt général, les devoirs et les valeurs collectives au profit de prétentions individuelles et catégorielles. Il produit une société contentieuse où chacun est en guerre contre tous. Il fait naître des créances et suscite des doléances dont seul le juge, national ou supranational, fixera effectivement la portée.
Cette dernière observation est fondamentale pour l’avenir des démocraties libérales : en effet, les dispositions supra-législatives dans lesquelles le juge va chercher l’énoncé d’un droit font l’objet de formulations le plus souvent vagues. Le juge en est l’ultime exégète. Sa jurisprudence déterminera donc à la fois les implications véritables et la force contraignante de l’énoncé constitutionnel ou conventionnal en cause.
Il en résulte que c’est le juge, dûment actionné par les gardiens des colonnes du temple (autorités administratives indépendantes comme le Défenseur des droits ou la CNIL, organismes européens, associations militantes dotées de la capacité de se porter partie civile, doctrine juridique acquise à l’expansion indéfinie des droits de l’homme), qui prescrira in fine le contenu des politiques publiques.
Qui plus est, le droit nouvellement proclamé entre tôt ou tard en conflit avec des droits concurrents ou avec l’intérêt général. Seul le juge saura dire (toujours trop tard d’ailleurs pour que la sécurité juridique y trouve son compte) comment il convient de les concilier.
S’opère ainsi un déplacement du centre de gravité de la vie publique des deux premiers pouvoirs vers le troisième et vers d’autres, dépouillant les représentants directs de la souveraineté populaire (Gouvernement et Parlement) au bénéfice d’un pouvoir juridictionnel polycéphale (non moins de cinq cours suprêmes, dont trois nationales [1] Conseil constitutionnel, Conseil d’Etat et Cour de Cassation. et deux européennes [2] CEDH et CJUE.) et d’autres instances non élues, nationales ou supranationales (comité des droits de l’homme de l’ONU par exemple), chargées de veiller à la suprématie des droits et au respect des traités.
Même les politiques régaliennes se voient « préformatées » par une jurisprudence poussant toujours plus loin le contrôle de proportionnalité et par un droit humanitaire toujours plus invasif, par exemple en matière d’immigration.
La religion des droits fondamentaux et, plus généralement, ce que Marcel Gauchet a appelé l’« abouchement du droit des juristes et du droit des philosophes », ont fait émerger un juge démiurge, à l’image de la Cour suprême des USA, du Verfassungsgericht [3] Cour constitutionnelle allemande., des cours de Strasbourg et de Luxembourg et de leurs divers zélateurs en Occident.
Comme évoqué, ce juge thaumaturge, non content d’imposer la prépondérance des droits individuels sur l’intérêt général, en énonce de nouveaux en produisant à jet continu, par-dessus la tête du Représentant, un droit supra-législatif ineffable et arborescent, élaboré sans garde-fou à partir des formulations très générales qui abondent dans nos textes constitutionnels et conventionnels.
Cette apothéose du juge (que les politiques ignorent ou feignent d’ignorer) est saluée par la nouvelle doxa juridique, avec des accents eschatologiques, comme l’accomplissement de l’Etat de droit.
Le républicain y voit au contraire une régression : le retour des parlements d’ancien régime, contre lesquels la Révolution française s’est en partie faite. Car la souveraineté populaire, c’est la démocratie représentative avant la jurisprudence, l’élection avant le pouvoir juridictionnel. La règle commune ne peut résulter de l’exécution contrainte d’un catalogue de droits et principes pré-institués par des chartes et grossis sans contrepoids démocratique par la jurisprudence des cours. Au contraire, la recherche du bien commun par les représentants de la Nation, au travers du vote de la loi, est l’expression de la volonté générale.
La mission du juge est d’appliquer la loi ainsi que de l’interpréter, certes, mais sans la dénaturer, ni la compléter indûment. Le juge constitutionnel ou conventionnel ne devrait s’autoriser à censurer que les dérapages manifestes du législateur dans l’exercice de la conciliation qui lui incombe entre droits et libertés (des uns et des autres) et intérêts généraux.
En France, Conseil d’Etat et Conseil constitutionnel ont d’abord résisté sur le terrain de l’intérêt général, de l’égalité des droits et de la conception universaliste de la citoyenneté (notamment en matière de discriminations positives ou à l’encontre d’une conception illimitée de la liberté individuelle…). Mais la digue est rompue. Des notions vagues comme le « respect de la vie privée et familiale » (convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme) ou « l’importance primordiale devant être accordée à l’intérêt supérieur de l’enfant » (convention de New York sur les droits de l’enfant) fondent, en France comme ailleurs, ce pouvoir juridictionnel (conventionnel, judiciaire ou administratif) impressionniste, désinvolte envers le législateur, plus souvent bienveillant pour le requérant que soucieux des enjeux collectifs.
Le Conseil constitutionnel, qui pourtant n’a pas à appliquer les traités et dont le contentieux normatif, même a posteriori (QPC), est objectif (cf. sa jurisprudence ultra-restrictive sur les traitements de données personnelles ou l’intensité de son contrôle de proportionnalité en matière de procédure pénale et de police administrative), n’échappe pas à cet empressement.
Les deux ailes du Palais-Royal jouent donc aujourd’hui les bons élèves de Luxembourg et de Strasbourg, rejoignant ainsi les juges judiciaires, depuis longtemps émules des cours supranationales. Tous les juges de France, de Navarre et de Lotharingie, communient désormais dans la suprématie des droits subjectifs et, au nom du « principe de proportionnalité », dans un contrôle toujours plus poussé des choix du législateur.
Ainsi, la procédure pénale, la législation fiscale, les règles relatives aux traitements de données personnelles, la politique migratoire sont-elles en grande partie dictées depuis une quarantaine d’années par la jurisprudence des cours suprêmes. Le juge était la bouche de la loi pour Montesquieu ; c’est désormais la loi qui est la bouche du juge.
Les politiques se taisent. Les seuls à en parler, marqués du sceau ignominieux du populisme, prennent des engagements que seul pourrait tenir un Etat intérieurement et extérieurement souverain.
Les gens ordinaires, quant à eux, sont bien loin de se douter de tout cela. Ils formulent bien sûr des récriminations contre l’impuissance de l’Etat et la faiblesse de la justice, mais ils attribuent celles-ci à des causes subalternes (absence de volonté politique des dirigeants, manque de moyens, erreurs matérielles commises par l’administration ou par les tribunaux). Ils pensent encore naïvement que l’Etat de droit c’est d’abord un Etat qui les protège contre les prédateurs et qui veille souverainement à leur sécurité.
La vérité est que la loi promulguée n’est plus une valeur sûre. Elle est devenue un énoncé précaire et révocable, grevé de la double hypothèque du droit européen et (surtout avec la QPC) du droit constitutionnel. Elle n’exprime plus une volonté générale durable, mais une règle du jeu provisoire, perpétuellement discutable, continuellement à la merci d’une habileté contentieuse placée au service d’intérêts ou de passions privés.
Comment rétablir la prééminence de la loi dans le droit ?
Un remède peut être recherché dans le pouvoir donné au Représentant de faire prévaloir ses choix à tout moment, moyennant un vote de confirmation solennel acquis selon une majorité qualifiée. Car pour restaurer la souveraineté populaire, il convient de recourir à des solutions plus expédientes que la révision constitutionnelle au coup par coup, moins lourdes et dramatiques que le référendum et plus franches qu’un éventuel dialogue interprétatif entre législateur et Conseil constitutionnel que d’aucuns appellent de leurs vœux en désespoir de cause. Une telle procédure serait compliquée à mettre en œuvre, illisible pour nos concitoyens, bourrée d’aléas et surtout, faisant une part trop belle à l’entêtement du Conseil constitutionnel ; elle ne créerait pas un véritable dernier mot du Représentant.
Ainsi, pourquoi ne pas faire dire à la Constitution (comme le propose un amendement à la loi constitutionnelle en instance déposé par MM E. Ciotti et G. Larrivé) que : « Une disposition législative déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, ou ayant fait l’objet de réserves d’interprétation par ce dernier, ou jugée contraire à un traité par une juridiction française ou européenne statuant en dernier recours, est maintenue en vigueur si, dans les six mois suivant cette décision ou ce jugement, elle est confirmée par une loi adoptée dans les mêmes termes par la majorité des députés et la majorité des sénateurs » ?
La loi de confirmation précise selon quelles modalités la disposition en cause demeure en vigueur ou reprend vigueur. Elle ne peut faire l’objet d’aucun des recours prévus aux articles 61 et 61-1 » ?
Une telle règle permettrait au politique de reprendre la main en toute connaissance de cause, peut-être au terme d’un dialogue informel avec le juge, sans avoir (comme pour le droit d’asile en 1993) ni à convoquer le Congrès, ni à modifier la Constitution à chaque « lit de justice ».
Elle n’en paraîtra pas moins hérétique à tous ceux pour lesquels le respect des droits et libertés exclut que le politique – fût-ce à une majorité qualifiée – puisse priver d’effets une décision juridictionnelle. Les lois de validation ne sont-elles pas déjà un affront à l’Etat de droit ? Que les élus puissent avoir le dernier mot sur le juge, même au terme d’une procédure exigeante, ne priverait-il pas l’Etat de droit de sa garantie essentielle ? Ne livrerait-on pas les droits fondamentaux aux pulsions illibérales et populistes qui, comme l’enseigne l’histoire, peuvent devenir majoritaires dans les chambres ?
Le scandale leur paraîtrait plus grand encore si le Parlement pouvait faire fi du jugement d’une cour supranationale. Ne serait-ce pas là violer les traités que nous avons soucrits et créer une contradiction inexpiable entre droit interne et droit international ? Le « passer outre » envisagé ne heurterait-il pas de front nos engagements européens ? N’entrerait-il pas en contradiction, au sein de la Constitution, avec plusieurs articles : 55 (supériorité des traités), 62 (autorité s’attachant aux décisions du CC) et 88-1 (primauté du droit de l’Union) ? Sur ce dernier point, notre texte fondamental recèle déjà des contradictions de ce type, introduites précisément à la suite de lits de justice : parité femme/homme (collision avec l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen), restriction du corps électoral en Nouvelle-Calédonie (collision avec le droit de suffrage)… Quoique non bloquantes (car la disposition spéciale prévaut sur la disposition générale), ces discordances introduisent comme des fausses notes dans la partition constitutionnelle.
L’auteur de ces lignes ne l’ignore pas : l’instauration d’un dernier mot parlementaire révulserait les esprits orthodoxes et susciterait un psycho-drame à l’intérieur comme en dehors de nos frontières. L’idée l’aurait choqué aussi il y a quelques années.
S’il soutient un tel changement de paradigme, c’est parce qu’il a acquis la conviction qu’il fallait mettre un terme, dans l’intérêt supérieur de la démocratie, à l’érosion de la souveraineté populaire à l’oeuvre depuis une quarantaine d’années. Parce qu’il pense qu’en laissant cette érosion se poursuivre, la confiance citoyenne ira en se délitant et quelque chose d’essentiel s’effondrera dans la Cité.
La règle du passer outre parlementaire serait, à tout prendre, un remède moins brutal pour restaurer la souveraineté populaire, que le frexit, ou la dénonciation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ou que la suppression pure et simple du contrôle de constitutionnalité.
Pour un équilibre entre constitutionnalisme politique et constitutionnalisme juridique
par Benoît Schmaltz
Les débats sur la réforme constitutionnelle, avant de choir sur l’affaire Benalla, ont révélé un intérêt limité des parlementaires pour le contrôle de constitutionnalité, ses modalités et ses enjeux. Pourtant, le Conseil constitutionnel, installé en juge constitutionnel de plein exercice depuis les années 1970, semble depuis lors satisfaire ceux qui défendent un Etat de droit moderne, fondé sur la hiérarchie des normes. Dans ce contexte, l’amendement déposé par Guillaume Larrivé et Éric Ciotti afin de proposer une « clause de dernier mot », permettant aux parlementaires de s’opposer à une décision du Conseil constitutionnel, a certes suscité de vives oppositions, mais a le mérite d’aborder la question franchement.
En effet, les deux députés proposent que, dans les six mois suivant une censure, le Parlement puisse voter à nouveau la disposition concernée à la majorité des députés et des sénateurs (et non à la majorité des seuls votants) [4] Amendement de Guillaume Larrivé et Éric Ciotti, 5 juillet 2018 : « Art. 33-1 : Une disposition législative déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel … Continue reading. L’initiative ne retiendrait pas l’attention si elle se résumait à une nouvelle foucade de ces élus ; toutefois, elle a été appuyée (et sans doute inspirée) par l’ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, Jean-Eric Schoettl. Ce dernier soutient que l’Etat n’a plus les prérogatives juridiques nécessaires pour assurer la sécurité des Français – postulat éminemment discutable – et propose de redonner le dernier mot au Parlement [5]« L’État est menacé d’impuissance dans l’exercice de ses fonctions régaliennes », Le Figaro, 17 mai 2018, ainsi que la précédente contribution..
Sans s’attarder ici sur le dernier mot face aux cours européennes et internationales (lequel pose d’autres questions, s’agissant ni plus ni moins que de revenir sur le principe selon lequel la France respecte ses engagements internationaux…), le présent propos se concentrera sur la dimension de droit interne du problème : la possibilité pour les organes politiques de s’affranchir de la censure d’une disposition législative par le Conseil constitutionnel [6] Même si, chaque fois qu’un droit garanti par la Constitution l’est aussi en droit de l’Union européenne et en droit de la CEDH, la question peut se poser à nouveau à ce niveau de … Continue reading.
Si, en France, le dernier mot n’appartient pour l’heure qu’au peuple souverain ou au pouvoir constituant (I), d’autres pays connaissent des clauses accordant le dernier mot aux organes politiques. Cependant, les parlements ne les mettent pas en œuvre, et suivent les décisions des juges constitutionnels (II). Surtout, il faut évaluer la réalité du problème car, à bien y regarder, le Conseil constitutionnel n’apparaît pas vraiment comme un réel obstacle à la volonté politique (III). La question du dernier mot mérite toutefois d’être prise au sérieux et l’on proposera, à cet égard, une amélioration du dialogue entre le Parlement et le Conseil en matière d’interprétation constitutionnelle (IV).
Le dernier mot appartient déjà au peuple souverain et au pouvoir constituant
Lorsqu’une loi est déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, le gouvernement doit choisir parmi les quatre alternatives suivantes :
- Se soumettre à l’interprétation donnée par le Conseil et renoncer à la disposition censurée.
- Proposer une nouvelle rédaction de la loi, en espérant satisfaire les exigences de constitutionnalité, mais au risque d’encourir une nouvelle censure du Conseil comme ce fut récemment le cas s’agissant du délit de consultation habituelle de sites terroristes [7] Introduit par la loi n°2016-731 du 3 juin 2016, la disposition fut censurée, sans surprise pour les spécialistes tant l’inconstitutionnalité de la mesure est manifeste, par une première … Continue reading.
- Adopter la loi par référendum législatif (article 11 de la Constitution), puisque le Conseil s’interdit de contrôler la constitutionnalité d’une loi adoptée par référendum [8]C.C. 62-20 DC du 6 novembre 1962, et CE, 30 oct. 1998, Sarran, Levacher et autres.. Aucun des 9 référendums n’a cependant été organisé pour passer outre une censure du juge constitutionnel.
- Réviser la Constitution puis adopter la loi : par le référendum (article 89… ou 11 de la Constitution puisque l’immunité contre un recours autorise, de facto, le Président à réviser la Constitution par cette voie alors que la lettre du texte semble ne pas le lui permettre [9] On renverra sur ce point à la récente note publiée par l’Hétairie : M. TROPER et J.-Ph. DEROSIER, « Quelle voie pour la réforme constitutionnelle ? Echanges autour du référendum … Continue reading) ou par un vote du Congrès afin de modifier le texte de la Constitution pour rendre caduque l’interprétation du Conseil.
Le propos de Georges Vedel que citent Guillaume Larrivé et Eric Ciotti dans leur exposé des motifs mérite d’être rapporté intégralement et illustre bien l’idée générale : « L’obstacle que la loi rencontre dans la Constitution peut être levé par le peuple souverain ou ses représentants s’ils recourent au mode d’expression suprême : la révision constitutionnelle. Si les juges ne gouvernent pas, c’est parce qu’à tout moment, le souverain, à la condition de paraître en majesté comme constituant, peut d’une sorte de lit de justice, briser leurs arrêts » [10] Georges VEDEL, « Schengen et Maastricht, À propos de la décision n° 91-294 DC du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1991 », RFDA, mars-avril, 1992, p. 173..
Les Congrès et les référendums destinés à ratifier les traités européens se situent à part, notamment pour Maastricht. L’idée était de considérer que l’intégration européenne constitue une décision trop importante pour ne pas relever du pouvoir constituant lui-même. Ce qu’il fit à chaque fois, à l’exception notable du référendum de 2005 qu’escamota le Congrès en permettant un peu plus tard la ratification du traité de Lisbonne. Si dernier mot il y eut, ce fut plutôt celui des élus du Parlement réunis en Congrès qui l’emportèrent sur le peuple s’étant exprimé par référendum sans que ledit peuple, redevenu simple opinion publique, n’y trouve réellement à redire.
Le premier cas véritable de « dernier mot » du Parlement contre le Conseil remonte à 1993 et au projet de loi de Charles Pasqua visant à assurer l’application des accords de Schengen et de Dublin en matière d’immigration. Le Conseil constitutionnel a partiellement censuré ce texte dans sa décision n° 93-325 du 13 août 1993 ; en réaction le Gouvernement a mis en œuvre une révision constitutionnelle adoptée par le Congrès le 19 novembre 1993. Edouard Balladur soulignait alors le caractère inédit de la situation : « Pour la première fois dans notre histoire, le pouvoir constituant se réunit pour permettre le vote et la promulgation d’une disposition législative censurée par le Conseil constitutionnel. Cette situation est inédite » [11] Discours prononcé par Edouard Balladur, le 19 novembre 1993, devant le Congrès.. Il faut cependant mesurer la portée toute relative de la question en débat. Le dernier mot portait seulement sur les modalités de cette garantie, et non sur l’effectivité du droit d’asile [12] Il s’agissait seulement de déterminer si sa mise en œuvre doit relever des autorités françaises, ou s’il peut être envisagé de le voir mis en œuvre par des autorités italiennes, grecques … Continue reading.
Une autre révision a été motivée pour promouvoir le principe de parité au moyen de quotas. En effet, la conception française de l’égalité s’oppose, en principe, à des mécanismes de discrimination positive destinés à favoriser une catégorie de la population, non en raison d’une différence objective de sa situation par rapport aux autres catégories dans un contexte donné (comme les familles nombreuses pour le prix du billet de train), mais en raison d’une appréciation subjective de cette catégorie en tant que telle. C’est pourquoi la première tentative d’imposer la parité sur les listes électorales s’est heurtée à une censure du Conseil constitutionnel avec la décision « quotas par sexe » n° 146 DC du 18 novembre 1982. Lorsque le Conseil a réitéré sa jurisprudence en 1999, le Gouvernement de Lionel Jospin a alors tenu « un lit de justice » en faisant adopter par le Congrès la révision constitutionnelle du 8 juillet 1999. Elle a ajouté à l’article 3 de la Constitution de 1958 la disposition suivante : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives » et prévoit que les partis doivent « contribuer à la mise en œuvre » de ce principe (art. 4). La loi sur la parité du 6 juin 2000 a donc pu entrer en vigueur. Là encore, le débat a porté non sur le principe même du droit garanti (le droit à l’égalité), mais sur la modalité de sa mise en œuvre.
Ces exemples montrent en premier lieu la rareté des « lits de justice » que le pouvoir constituant a « infligés » au Conseil constitutionnel. Ils soulignent en second lieu que de tels « lits de justice » n’ont pas consisté à imposer une atteinte importante aux droits et libertés garantis, mais simplement à imposer une mise en œuvre peut-être moins exigeante.
Qu’en serait-il si l’objet du débat était une atteinte autrement plus caractérisée aux droits de l’Homme ? Par exemple, Éric Ciotti a critiqué la décision du Conseil constitutionnel considérant que le principe de fraternité interdit au législateur de criminaliser l’assistance à personne en danger, même si la personne en question est un migrant [13] Après la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018 qui a considéré qu’une aide « désintéressée » au « séjour irrégulier » de … Continue reading. Il est clair qu’il ne s’agit pas, ici, d’une simple question de mise en œuvre des droits garantis mais de leur suppression pour toute une catégorie d’êtres humains. Que la Constitution puisse être modifiée afin de permettre cette évolution ne peut que demeurer la prérogative du pouvoir constituant et non du simple législateur. Les données du droit comparé permettent d’envisager cette hypothèse.
Des clauses de dernier mot peu utilisées à l’étranger
L’ordre juridique britannique repose fondamentalement sur le principe de souveraineté du Parlement qui, selon l’adage, « Peut tout faire sauf changer un homme en femme ». Mais il faut d’emblée affirmer que la souveraineté parlementaire n’est pas synonyme d’arbitraire ou d’une protection insatisfaisante des droits de l’Homme. En ce dernier domaine en particulier, la différence réside dans la méthode : alors que nous avons judiciarisé la protection des libertés par l’attribution de droits subjectifs à faire valoir devant des juges, les Britanniques ont plutôt choisi d’évaluer, en amont, l’impact d’une législation sur les libertés et de tendre autant que possible vers leur meilleure protection [14]« En permettant aux représentants politiques et à divers comités d’engager avant l’adoption de la loi un débat public autour de la garantie des droits, ces mécanismes assurent un … Continue reading.
Néanmoins, après d’importantes controverses, la méthode juridictionnelle s’est introduite en droit britannique, par l’importation de la protection internationale des droits de l’Homme impliquée par l’adhésion au Conseil de l’Europe que les Britanniques avaient contribué à fonder. Le Human Rights Acts (HRA) a ainsi octroyé aux juges britanniques la possibilité d’appliquer les droits de la Convention européenne des droits de l’Homme en tenant compte de l’interprétation de la Cour de Strasbourg.
Mais comme le Parlement est souverain, il peut évidemment déroger explicitement au HRA, ce qui a permis l’établissement d’une législation antiterroriste particulièrement extensive (et même liberticide aux yeux de certains).
Si le Parlement n’a pas entendu déroger explicitement au HRA, et que les juges ne parviennent pas à donner une interprétation à la loi qui la rende compatible avec la Convention, la section 4 du HRA autorise les juridictions suprêmes de Grande-Bretagne à adopter une déclaration d’incompatibilité. La loi reste en vigueur et s’applique au litige tandis que le Parlement est invité à intervenir pour modifier la loi et ainsi rendre le droit britannique conforme à la Convention.
Dans la pratique, la plupart des 20 déclarations d’incompatibilité devenues définitives ont donné lieu à une décision destinée à rendre le droit britannique compatible avec la Convention. Et, de fait, le nombre de condamnations du Royaume-Uni par la CEDH a sensiblement diminué depuis que les tribunaux britanniques font application de la Convention via le HRA. Il s’agit donc très certainement d’un perfectionnement de la protection des droits fondamentaux en Grande-Bretagne. Cet exemple pose en définitive la question de l’utilité d’une clause de dernier mot dès lors qu’elle n’a que peu d’intérêt pratique dans les pays qui l’ont instituée.
Plus topique encore est l’exemple canadien. L’article 33 de la Charte canadienne des droits fondamentaux de 1982 permet au législateur (fédéral ou fédéré) d’adopter une loi, sans condition particulière de majorité, en précisant qu’elle devra s’appliquer « nonobstant » (notwhithstanding) certaines dispositions de la Charte. Cette déclaration ne dure que cinq ans mais peut être reformulée indéfiniment, et ainsi empêcher la Cour Suprême du Canada d’invalider la loi (ou bien contrer une décision qui serait intervenue précédemment).
En réalité, cette clause n’est presque jamais mise en œuvre au point que certains la considèrent comme désuète (seul le Québec en a réalisé un usage politique dans le but d’imposer une exception culturelle et d’interdire notamment l’usage de la langue anglaise). Si bien que nombre d’auteurs considèrent la Cour suprême du Canada aussi puissante que celle des Etats-Unis, de facto sinon de jure, et que le système de protection constitutionnelle canadien s’aligne sur les modèles les plus forts.
Car recourir au dernier mot du politique devient beaucoup trop coûteux ou politiquement incorrect. La récente tentative du premier ministre de l’Ontario d’activer la clause en septembre 2018 a ainsi suscité une crise politique majeure, même si le noyau dur de son électorat conservateur semblait le soutenir.
Il y a donc fort à parier que l’introduction d’une clause de dernier mot dans la Constitution française n’aurait qu’une portée purement symbolique et que cette clause ne serait en pratique jamais mise en œuvre.
A l’inverse, même dans une situation où le juge peut imposer un blocage institutionnel par une censure d’inconstitutionnalité, les organes politiques ne sont pas dépourvus pour autant. Les Etats-Unis offrent ainsi le panel presque complet des moyens de résoudre un blocage né d’un conflit d’interprétation constitutionnelle :
- La révision constitutionnelle, puisque 4 amendements sont indiscutablement entrés en vigueur pour contrer une décision de la Cour suprême [15] Le blocage atteint cependant son paroxysme lorsque le juge constitutionnel contrôle de telles révisions constitutionnelles. C’est ce que prévoit la Constitution en Allemagne, en Italie ou bien … Continue reading.
- La persévérance, lorsque le Congrès revote une loi, conduisant parfois la Cour à adoucir son contrôle et à permettre une application partielle du texte.
- L’intimidation, quand le président Roosevelt menaça de nommer une fournée supplémentaire de juges et de couper les vivres de la Cour suprême qui s’opposait au New Deal.
- La guerre civile, puisque la Guerre de Sécession peut être lue comme le conflit relatif à la constitutionnalité ou non de l’esclavage aux Etats-Unis.
En somme, les Etats disposant d’une clause de dernier mot n’en font guère usage, et les Etats qui n’en bénéficient pas peuvent faire primer les moyens politiques sur les moyens juridiques pour dépasser le verdict d’une cour suprême. C’est donc bien le sens de l’opinion publique qui demeure la boussole véritable, ce que vérifie d’ailleurs l’observation du contrôle, souvent timoré, exercé par le Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel : un faible obstacle à la volonté politique
Si certains s’émeuvent parfois des décisions qui censurent une loi et en appellent à la souveraineté parlementaire, beaucoup plus nombreux sont ceux qui en appellent à l’Etat de droit pour s’émouvoir de la bienveillance du Conseil constitutionnel à l’égard des textes les plus liberticides votés dernièrement. Plusieurs exemples permettent de distinguer de la marge de manœuvre extrêmement étendue dont dispose le Gouvernement malgré l’existence de limites constitutionnelles, parfois purement formelles. La lutte contre l’immigration irrégulière et celle contre le terrorisme illustrent parfaitement le fait que les décisions de la justice constitutionnelle ne portent guère que sur des détails par rapport aux politiques publiques proposées.
Sur l’immigration, le Conseil constitutionnel a toujours reconnu le droit, pratiquement discrétionnaire, de poser des conditions à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Aucun principe ne confère le droit à un étranger de venir en France et le Gouvernement peut donc faire adopter tout l’arsenal législatif nécessaire à limiter l’immigration. Ni l’exigence d’un titre, ni la possibilité de procéder à l’expulsion des étrangers en situation irrégulière ne sont susceptibles d’une remise en cause devant le juge constitutionnel. Certes, le Défenseur des droits et le Conseil d’Etat rappellent qu’on ne peut pas brûler les effets personnels des migrants [16] Décision du Défenseur des droits du 13 novembre 2012, n° MDS 2011-113. et qu’on doit leur assurer un accès à l’eau potable [17] CE, 31 juillet 2017, n°412125, 412171.… Mais peut-on penser que le juge enjoindrait d’accueillir l’Aquarius dans un port français ? Il est permis d’en douter. Et pourtant, ne pourrait-on juger inconstitutionnel le principe même de la politique migratoire actuelle ? Est-il proportionnel de condamner des hommes, des femmes et des enfants à recourir aux services de passeurs, à risquer leur vie et à subir des conditions de vie indignes à la merci des exploiteurs, quand il s’agit de prémunir de troubles qui relèvent largement du fantasme ?
Quant à la lutte contre le terrorisme, le régime préventif et répressif actuel n’a été corrigé qu’à la marge par les juridictions. Il permet déjà des fouilles, des perquisitions, des interceptions de correspondances, une surveillance administrative au moyen notamment de plusieurs fichiers et des assignations à résidence, tout cela en amont d’une procédure pénale qui repose sur des infractions suffisamment vagues pour couvrir de très nombreuses situations [18] Mireille Delmas-Marty : « Le projet de loi antiterroriste, un mur de papier face au terrorisme », Philosophie Magazine du 31 juillet 2017.. L’ensemble permet de déjouer certains attentats [19]32 attentats déjoués dont 13 en 2017 selon Gérard Collomb, mais sans préciser quel type d’attentat. mais n’empêche en rien notre société de produire des terroristes, en grande partie par ses propres défaillances en termes de chômage, d’aménagement urbain et d’éducation. Là encore, la proportionnalité du dispositif interroge et les juges pourraient se montrer plus audacieux.
On pourrait encore mobiliser maints exemples : comme en matière de relations entre Etat et collectivités territoriales, lorsque le Conseil vide de toute substance le principe de libre administration et l’autonomie financière… mais respecte ce faisant le caractère unitaire de l’Etat.
On le voit, toutes ces affirmations sont sujettes à débat, et il serait périlleux pour le juge constitutionnel de trancher. C’est la raison pour laquelle il laisse son entière appréciation au législateur et ne substitue jamais la sienne, sur l’essentiel. Il intervient seulement ensuite – certains diront à la marge – en rappelant l’existence de tel principe ou en assurant le respect de telle garantie. Ce faisant, il impose la mise en œuvre la plus respectueuse possible des libertés d’une politique publique dont il ne discute pas le principe. Et c’est là sans doute son meilleur rôle.
Si l’on voulait chercher des blocages constitutionnels rédhibitoires pour le Gouvernement, il faudrait convoquer le déraisonnable (à l’instar du délit de consultation habituelle de sites terroristes) ou l’effroyable (comme la pénalisation de l’aide humanitaire, qui rapproche le migrant de l’homo sacer des Romains que l’on pouvait dépouiller ou exécuter sur place sans craindre de châtiment).
A l’inverse, de nombreuses censures peuvent être dépassées par une loi mieux rédigée et, dès lors, constitutionnelle. Ce fut le cas de la taxe carbone, peu souhaitée par Nicolas Sarkozy et par conséquent si mal rédigée (elle exonérait les plus gros émetteurs !) que tout étudiant de deuxième année aurait relevé la violation du principe d’égalité.
En réalité, on doit conclure de l’observation du contrôle de constitutionnalité en France qu’il permet à peu près tout ce que souhaite un Gouvernement de droite ou de gauche… à condition de rester dans le cadre des standards démocratiques. Le juge constitutionnel n’a empêché ni les nationalisations, ni les privatisations, il n’a interdit ni les 35h, ni les contrats à 0h. Autrement dit, ainsi que le souhaite Jean-Eric Schoettl, le juge ne censure bien « que les dérapages manifestes du législateur ».
Une clause de denier mot n’apporterait donc rien de plus à un tel gouvernement démocratique. Elle lui octroierait simplement le droit de violer la Constitution et les droits qu’elle garantit. Et cela, alors même qu’un Gouvernement bénéficiant du soutien de l’opinion publique pourrait le faire par le référendum, la révision constitutionnelle, ou tout autre moyen de droit ou de fait que l’ordre juridique lui confère. Néanmoins, prenons la proposition du dernier mot sérieusement, et indépendamment de son potentiel mésusage par un Gouvernement.
Prendre au sérieux l’hypothèse d’une clause de dernier mot : vers un dialogue interprétatif ?
Déterminer qui, du juge constitutionnel ou du Parlement, s’avère le plus compétent ou le plus légitime pour décider ce qui est conforme ou non à la Constitution représente une question de droit constitutionnel aussi fondamentale que bien débattue. Elle se pose en raison du conflit de légitimité qui oppose le Parlement au juge constitutionnel.
Le principe de souveraineté nationale ou populaire conduit à ériger la volonté politique en pouvoir suprême, devant triompher de tous les obstacles. La séparation des pouvoirs – les fameux « checks and balances » – vient tempérer ce principe qui n’est jamais vraiment remis en cause. Il faut, selon Montesquieu, « que le pouvoir arrête le pouvoir ». Si le juge arrête le législateur, le constituant peut arrêter le juge.
Plus généralement, la question oppose deux théories générales du droit constitutionnel : le constitutionnalisme politique et le constitutionnalisme juridique. Le second est celui qui conduit à la suprématie d’un juge constitutionnel investi du pouvoir d’interpréter en dernier ressort le sens et la portée des dispositions constitutionnelles. Il prévaut aujourd’hui mais fut longtemps minoritaire. Il est par nature antidémocratique et aristocratique puisqu’il a pour objet et pour effet d’interrompre la volonté politique, obéissant en cela à une défiance contre la « dictature de la majorité ». Sa dimension aristocratique correspond d’ailleurs à une défiance plus profonde encore contre la nature humaine et, partant, le peuple. Assimilé à la foule, mû par des sentiments irrationnels et susceptible d’éruptions violentes, il est sain de ne pas donner au peuple le champ libre. La Constitution doit donc poser des obstacles à la réalisation de la volonté politique lorsqu’elle met en cause les droits et principes fondamentaux de l’ordre social et politique. Les juges constitutionnels et le droit qu’ils appliquent y pourvoient avec pour avantage d’utiliser un discours formalisé répondant aux exigences de rationalité tout en prenant le temps et le recul nécessaires.
Le constitutionnalisme politique, qui a longtemps prévalu, répond quant à lui à une logique qui semble brutale aux contemporains. L’idée est que le peuple se donne à lui-même une constitution et qu’il lui revient donc, par tous les moyens possibles (représentation politique, expression, manifestation), de faire prévaloir telle ou telle interprétation. Un juge n’est donc jamais légitime à imposer à une nation une interprétation de la Constitution. Des voies doivent permettre de vaincre cet obstacle juridictionnel. L’idée est que la Constitution relève du droit politique et que le juge n’est pas une autorité politique.
Mais les errements du suffrage universel au XXe et les cataclysmes qui en ont résulté ont conduit les élites des Etats démocratiques à se rallier presque unanimement à la doctrine du constitutionnalisme juridique. C’est pourquoi, aux Etats-Unis, comme en Europe et même dans les pays du Commonwealth, les autorités politiques ont dû composer avec des juges constitutionnels pouvant, par leurs arrêts, opposer un obstacle plus ou moins complexe à lever.
Les débats constitutionnels correspondent moins à des controverses politiques que doctrinales et l’on finit toujours par se tourner vers les légistes, juges ou jurisconsultes, pour déterminer si telle ou telle option est conforme à la Constitution ou non. Le débat concernant la possibilité ou non de régler la question du mariage pour tous par la voie du référendum de l’article 11 en constitue un exemple emblématique. Il s’agit en effet d’un questionnement pour le moins ubuesque si l’on se réfère au principe démocratique suivant lequel le peuple souverain est nécessairement compétent pour adopter quelque loi que ce soit !
Ce juridisme en matière constitutionnelle atteint donc parfois ses limites. Prenons l’exemple de la parité : une nouvelle révision du 23 juillet 2008 est venue ouvrir l’établissement de la parité en dehors des seules élections politiques, au sein des instances dirigeantes de nombreuses structures de droit public ou de droit privé. Il a donc fallu deux révisions constitutionnelles pour que le législateur puisse imposer en toutes ces hypothèses de présenter des listes comprenant autant d’hommes que de femmes. Fallait-il vraiment que le pouvoir constituant intervienne et à deux reprises pour trancher cette question ? Le Conseil aurait ainsi très bien pu constater l’évolution de la conception du principe d’égalité implicitement adoptée par le Parlement, mais sans considérer pour autant qu’il y eût là une altération du texte constitutionnel.
Ces considérations invitent à envisager de combiner, en France, ce constitutionnalisme juridique et le constitutionnalisme politique à l’anglo-saxonne. Il s’agirait d’organiser, dans certains cas de conflit sur l’interprétation du texte constitutionnel, un dialogue entre juges constitutionnels et parlementaires.
Il est indéniable que la censure d’une loi par le Conseil constitutionnel relève parfois de l’argutie juridique et qu’on pourrait admettre cette loi sans pour autant mettre en péril l’ordre constitutionnel et devoir craindre un retour du fascisme. On peut donc admettre que le Parlement puisse exercer la souveraineté nationale en ayant une interprétation divergente du Conseil, mais sans pour autant s’autoriser un viol caractérisé de la Constitution [20] Ce qui recouvre beaucoup des propositions de Monsieur Ciotti… à commencer par l’internement administratif des fichés S..
Il faut souligner ici que le Conseil constitutionnel s’est lui-même arrogé un pouvoir quasi-constituant que ni le texte, ni l’intention des rédacteurs ne lui attribuaient. Chaque fois que son interprétation ajoute une règle de valeur constitutionnelle qui n’est présente ni dans les textes constitutionnels, ni dans l’esprit de leurs rédacteurs, il change la Constitution. Certains auteurs peuvent s’abriter derrière la formule ésotérique selon laquelle le juge révèle et ne crée pas, la Constitution a bien été modifiée par les décisions du Conseil à l’origine de ce qu’on appelle aujourd’hui le bloc de constitutionnalité. Le Conseil a exercé un pouvoir constituant en donnant valeur constitutionnelle aux Préambules de 1958 et 1946, à la DDHC de 1789, et plus encore en identifiant des principes (PRFLR et PVC) et des objectifs à valeur constitutionnelle.
Il a, ce faisant, considérablement enrichi la Constitution de règles matérielles assurant une garantie plus large et plus approfondie des droits et libertés des individus contre les empiètements et les dérives du pouvoir politique. C’est là le processus qui, en France comme ailleurs, conduit à assurer, du moins en théorie, la suprématie du droit… laquelle n’a cependant aucune assise textuelle explicite.
Si un tel pouvoir constituant appartient à des juges non élus, et si le peuple peut l’exercer par référendum de l’article 11, alors on peut convenir qu’il peut légitimement appartenir de même aux représentants élus de la nation. La clause de dernier mot a donc pour objet de permettre l’exercice de ce pouvoir constituant atténué par le Parlement, sans devoir le réunir en Congrès et modifier formellement la Constitution. Dans le système français, cela pourrait prendre la forme d’une loi de validation constitutionnelle [21] En référence aux lois de validation qui permettent déjà de « sauver » un acte administratif de la censure du juge administratif..
Pour ne point créer un doublon avec la procédure de révision, il faudrait imaginer une procédure intermédiaire entre la majorité simple des votants et les 3/5e du Congrès, à l’instar d’une majorité renforcée et un vote solennel de l’ensemble des députés (et non des seuls votants). Comme la chose n’est pas anodine, elle mérite d’être mise en œuvre par une procédure formalisée et transparente permettant l’information de l’opinion publique et un large débat sur la question (ce que ne permet pas, selon nous, la procédure accélérée suggérée par l’amendement Larrivé/Ciotti).
Pour être admissible, le processus doit correspondre à l’idée qu’il y a bien deux manières de lire le même texte constitutionnel. Si l’on considère qu’il n’y pas lieu de modifier la Constitution pour admettre la constitutionnalité de cette loi, on suppose donc qu’il existe au moins une interprétation alternative de la Constitution qui rende la loi désirée compatible avec le bloc de constitutionnalité actuel.
L’exigence procédurale consisterait à demander au pouvoir politique de formaliser cette interprétation de la Constitution rendant conforme la loi qu’il veut faire adopter [22] Sorte d’étude d’impact constitutionnelle, à l’image de ce qui se pratique au Royaume-Uni.. Après une décision du Conseil, DC ou QPC (sous réserve des aspects juridictionnels de cette procédure), le Parlement adopterait une interprétation explicite de la Constitution affirmant la conformité à celle-ci de la loi litigieuse. Le Conseil n’interviendrait alors que pour juger si, selon lui, et sans nécessairement y souscrire, l’interprétation proposée par le Gouvernement est recevable.
En somme, ce ne serait rien d’autre qu’une navette comparable à celle qui conduit à la commission mixte paritaire entre députés et sénateurs, avec dernier mot aux premiers. On pourrait d’ailleurs imaginer une telle commission mixte paritaire entre élus et juges constitutionnels, en lieu et place de la seconde décision DC évoquée. L’idée est simplement d’obliger le Gouvernement à expliciter son interprétation de la Constitution rendant la loi qu’il veut faire enregistrer constitutionnelle. Ce serait là, dans les formes du droit, faire du constitutionnalisme politique consistant à dire en quoi la politique menée est, pour le Gouvernement, conforme aux principes fondateurs de notre communauté politique.
On pourrait également prévoir comme garde-fou la nécessité d’un nouveau vote à la législature suivante, ou la possibilité d’organiser un référendum abrogatif d’initiative populaire. Mais en définitive, ce serait bien à l’autorité politique de prendre ses responsabilités.
Le Parlement agirait en toute connaissance de cause, attendant le verdict des prochaines élections. L’opinion publique constitue après tout un tribunal nécessairement légitime à défaut d’être compétent dans une démocratie.
Resterait, en tout état de cause, l’éventualité d’une condamnation par la Cour européenne des droits de l’Homme, laquelle appelle d’autres discussions…
Le « dernier mot » : un enjeu démocratique essentiel
par Bertrand Mathieu
Comme le relève Jean-Éric Schoettl dans son analyse [23] Cf. la contribution dans le présent ouvrage., nous sommes confrontés – et ce n’est pas propre à la France – à deux mouvements convergents : une hypertrophie des droits individuels et un renforcement considérable du pouvoir des juges.
Or les deux phénomènes sont liés à partir du moment où :
- les droits fondamentaux constituent des normes juridiques très générales pour lesquelles le pouvoir d’interprétation du juge s’avère considérable,
- ces mêmes droits irriguent l’ensemble des branches du droit (administratif, des contrats, du travail, fiscal…),
- et où, enfin, ces droits fondamentaux multiples et contradictoires doivent être conciliés entre eux (liberté d’expression et respect de la vie privée, par exemple) et qu’il appartient au juge de placer – au moyen de ce qu’il appelle un contrôle de proportionnalité – le curseur là où il l’entend.
Enfin la multiplication des sources du droit appartenant à des ordres juridiques non hiérarchisés ou différemment hiérarchisés (ordres juridiques, nationaux, européens, internationaux…), institue le juge en régulateur des rapports de systèmes et lui laisse une grande latitude dans le choix des normes juridiques qu’il applique.
Mais, d’un autre point de vue, le développement d’une conception essentiellement individualiste des droits fondamentaux participe au déchirement du tissu social, à l’éclatement de la notion d’intérêt général, à un système de valeurs communautaristes et concurrentielles qui affaiblissent la démocratie.
La césure entre la démocratie et le libéralisme
La démocratie représentative a longtemps constitué un modèle qui, pour l’essentiel, a apporté la cohésion sociale, la paix, et le développement des droits de l’Homme. Elle a traduit un équilibre bénéfique entre la démocratie et le libéralisme permettant ainsi une conciliation inédite entre légitimité, efficacité et protection des libertés individuelles. Or cet équilibre est rompu.
On ne peut comprendre les évolutions contemporaines si l’on ne considère pas que le terme de démocratie, tel que l’on s’y réfère aujourd’hui, recouvre en réalité deux concepts différents : la démocratie qui est mode de légitimation du pouvoir d’un côté, et le libéralisme qui est un mode d’exercice du pouvoir d’un autre côté. Cette distinction que j’avais soulignée dans l’ouvrage Le droit contre la démocratie ? [24] Bertrand MATHIEU, Le droit contre la démocratie, Paris, LGDJ, 2017, 304p. est également mise en exergue dans l’essai de l’auteur américain Yascha Mounk Le peuple contre la démocratie [25] Yascha MOUNK, Le peuple contre la démocratie, Paris, Editions de l’Observatoire, 2018, 528p..
Il faut en réalité admettre que le système occidental est un système mixte, démocratique et libéral. Il est démocratique en ce qu’il fonde la légitimité du pouvoir dans le peuple. Il est libéral, en ce qu’il prévoit des mécanismes de contrôle et de contrepoids visant à limiter l’exercice du pouvoir, à le modérer. Or l’utilisation contemporaine du terme démocratie confond ces deux aspects, masquant ainsi les contradictions, les conflits qui peuvent opposer la démocratie et le libéralisme.
Il en résulte que la doxa politique ne parvient pas à expliquer que des peuples accordent leur suffrage à des régimes de moins en moins libéraux, comme en Hongrie ou en Pologne, et que certains régimes libéraux soient de moins en moins démocratiques. La dénonciation du populisme – qui traduit au demeurant un certain mépris pour le Peuple – constitue un viatique aussi fragile que contreproductif.
La véritable séparation des pouvoirs entre le politique et le juge
De ce double mouvement, il résulte que la véritable séparation des pouvoirs est aujourd’hui entre le pouvoir politique – dont la légitimité est démocratique – et le pouvoir des juges – dont la légitimité est libérale -, abstraction faite de la concurrence que le pouvoir politique subit de la part d’autres pouvoirs, pouvoirs financiers, organisations internationales (gouvernementales ou non) qui contribuent ainsi à l’affaiblir globalement. La situation accentue la déconnection entre le vote populaire et la décision politique ; elle participe à la crise de confiance en la démocratie.
Le risque est double :
- délitement de l’Etat et de la société dans un cas, accompagné d’un retour à une société formée de groupes et d’individu entre lesquels le juge se livrera à un arbitrage aléatoire et conjoncturel qui présente bien des dangers d’instabilités et de conflits,
- ou mise en place d’un régime autoritaire ancré d’abord dans une véritable légitimité démocratique, mais soumis au risque de dérives autocratiques.
Redonner du pouvoir au politique
La question est de savoir comment retrouver l’équilibre entre un pouvoir libéral – nécessairement oligarchique – et un pouvoir démocratique – celui du peuple tel qu’il est, non d’un peuple idéologiquement reconstruit.
Le lit de justice parlementaire
De ce point de vue, J.-E. Schoettl propose de permettre aux représentants du peuple – le Parlement – de faire obstacle à une décision du juge constitutionnel par une loi de confirmation qui leur donnerait le dernier mot. Cette logique n’est pas nouvelle, c’est celle qui, dans un contexte de conflit entre la légitimité monarchique et les parlements d’Ancien Régime (des juridictions), permettait à un lit de justice du souverain de s’opposer à un arrêt de règlement du parlement.
Cette solution heurte cependant des principes juridiques bien établis, notamment celui selon lequel la souveraineté ne se situe pas entre les mains du parlement mais entre celle du Peuple dont l’expression de souveraineté la plus haute réside dans la Constitution. Comme l’a indiqué le Conseil constitutionnel, sous l’inspiration du Doyen Vedel, « la loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution [26] Décision n° 85-197 DC du 23 août 1985. ».
Si cette solution a le mérite de l’efficience et de redonner au politique toute sa place, elle a cependant peu de chance d’aboutir dans la mesure où le coût juridique est probablement trop élevé, et où elle pourrait être source d’un nouveau déséquilibre.
Deux pistes – peut-être moins efficaces, mais sans doute plus praticables – doivent être respectées. La première consiste à donner toute sa portée au lit de justice constitutionnel et la seconde à revivifier la procédure du référendum.
Le lit de justice référendaire
La révision constitutionnelle parlementaire a déjà été utilisée pour surmonter une jurisprudence du Conseil constitutionnel (à propos du droit d’asile ou des quotas par sexe). Elle est cependant d’un usage juridiquement lourd et politiquement difficile.
Le recours au référendum s’avère plus simple, même s’il est plus brutal. Toutefois, le référendum est la quintessence de l’instrument démocratique, il constitue l’expression directe de la souveraineté du peuple.
Recourir au référendum pour surmonter un veto du juge constitutionnel, voire un veto de la Cour européenne des droits de l’homme, implique le respect de deux présupposés :
- Le premier tient au fait qu’il convient d’admettre que la Constitution puisse être révisée par la procédure de l’article 11 de la Constitution, c’est-à-dire sans un vote préalable des assemblées parlementaires ;
- le second est de considérer que le Conseil constitutionnel ne puisse exercer de contrôle que procédural sur le référendum, sauf à établir à son profit le dernier mot qui en réalité revient au peuple.
Ainsi par un vote souverain, le peuple pourrait indiquer l’interprétation de la règle constitutionnelle qui doit être retenue, ou la règle qui doit prévaloir, en tant que pouvoir souverain.
Faut-il considérer le référendum comme un danger ou comme une solution ? Il peut être l’un et l’autre. Le référendum est un outil qui, par son caractère binaire, sa force et la brutalité de son résultat, peut être dangereux s’il est utilisé, par exemple, dans un contexte émotionnel. Face au déni de démocratie et de souveraineté qui se manifeste partout en Europe, utilisé comme instrument politique, il permet aux gouvernements de canaliser la colère latente des citoyens vers un repli nationaliste qui constitue une impasse. Mais continuer à faire l’impasse sur cette révolte sourde, en privant le peuple de la possibilité de s’exprimer, c’est courir le danger d’une explosion dont personne ne peut prédire les péripéties et les conséquences.
Revivifier la démocratie c’est revenir à son sens premier, rendre la parole au peuple. Le référendum est un outil de démocratie directe dans un système qui, par nature, éloigne les citoyens des mécanismes de décision. C’est un moment de respiration démocratique dans un monde technicisé. C’est l’occasion d’un débat autour de la détermination des valeurs qui constituent l’identité nationale.
On dénonce le risque de dérive plébiscitaire, pourtant, quoi de plus démocratique pour un responsable politique que de choisir d’engager sa responsabilité devant le peuple qui l’a élu en cours de mandat ? On invoque le risque de dérive populiste, mais priver le peuple de la faculté de s’exprimer ne peut que favoriser les partis populistes.
La question se pose alors de trouver un mécanisme qui permette de redonner la parole au peuple tout en évitant que ne soit remise en cause cette démocratie tempérée qui est le modèle de nos sociétés occidentales.
La première exigence porte sur la sincérité du processus référendaire. Le principe de clarté et d’intelligibilité doit s’imposer à la formulation de la question. Si le peuple peut répondre comme il l’entend, encore faut-il qu’il soit en mesure de le faire. Il convient ainsi d’éviter des questions trop complexes ou des questions multiples auxquelles une seule réponse peut être apportée, comme ce fut le cas en 1969 où l’on a demandé aux citoyens d’accepter à la fois la création des régions et la diminutio capitis du Sénat.
On peut, de ce point de vue, s’interroger sur le maintien du principe selon lequel le référendum ne peut porter que sur un texte. D’un certain côté, autoriser la ratification d’un traité, aussi complexe que ceux portant sur l’Union européenne, n’a guère de sens. D’un autre côté, il est facile de déguiser une question portant sur un « problème de société » en article unique de loi. Le mécanisme même de la démocratie directe suppose que la question soit simple, les enjeux clairement identifiés et qu’elle ne se prête pas à un nuancier de réponses. Le référendum doit également être précédé d’un véritable débat.
Il serait probablement nécessaire de prévoir que, outre le contrôle du juge constitutionnel sur la sincérité du débat, il puisse également exercer un contrôle sur la clarté et l’intelligibilité de la question.
Néanmoins, toute autre est la question de savoir si le juge constitutionnel doit pouvoir contrôler la substance de la question, c’est-à-dire sa conformité à la Constitution. Comme il a été relevé, la question est de savoir jusqu’où le juge peut s’immiscer dans le dialogue démocratique entre le chef de l’Etat et le Peuple.
S’agissant de l’objet du référendum, il conviendrait probablement d’en élargir le champ. Plusieurs pistes peuvent être explorées :
- D’abord redonner la parole au peuple sur des questions importantes, parmi lesquelles ces « questions de société » dont justement le Conseil constitutionnel estime qu’elles sont tellement politiques qu’il n’en contrôle pas la constitutionnalité. La question du mariage entre personnes de même sexe – qui a tant divisé l’opinion – aurait pu être tranchée par le peuple.
- Le référendum pourrait également valider les grandes lignes d’un projet économique et social…
- Mais sont aussi concernées les questions qui engagent l’avenir d’une Nation. La construction européenne est de celles-là. Redessiner une Europe politique, une Europe des droits et libertés, ambitieuse mais respectueuse des identités nationales, économiquement puissante, une Europe unie autour de positions géostratégiques communes, d’une monnaie commune soutenue par une politique sociale et fiscale commune, constitue une ambition qui pourrait réunir les peuples européens qui en auraient accepté le principe, après un véritable débat.
De la nécessité de poursuivre le débat sur le « dernier mot »
C’est ainsi la souveraineté du Peuple et non celle du parlement qui est affirmée. Il n’en reste pas moins que, convoquer le Peuple pour une question d’interprétation de la Constitution qui peut avoir des incidences majeures sans être perçues comme telle par l’opinion publique du fait par exemple de sa technicité, n’est guère satisfaisant. La situation peut conduire, comme le suggère Benoît Schmaltz, à chercher une solution intermédiaire, à l’instar de celle permettant au parlement – dans des conditions de réunion marquant la solennité de la décision et de majorité montrant un certain consensus politique – d’imposer au juge constitutionnel une certaine interprétation du texte constitutionnel en cause. Mais l’interprétation est parfois difficile à distinguer de la révision.
Quoi qu’il en soit, le populisme fait son lit du mépris exercé sur le peuple et de la manière dont une élite éclairée et auto-proclamée fait peu de cas de ses opinions. Un nouvel équilibre est à trouver entre cette oligarchie – au centre de laquelle se trouve le juge, y compris constitutionnel – et les risques d’une démocratie pure dont les excès peuvent être incontrôlables. L’heure est cependant venue de redonner au pouvoir politique la maîtrise de la décision, tout en conservant les garde-fous issus des procédures libérales. Mais aujourd’hui le pouvoir d’empêcher a pris le pas sur le pouvoir de décider, et il est temps d’inverser la situation.
Ce débat sur le « dernier mot » ici engagé doit être approfondi. Aucune solution ne s’impose d’elle-même, mais une solution doit assurément être trouvée. C’est la condition de la survie d’un système démocratique, laquelle n’est nullement acquise.
Conclusion : Repolitiser le débat constitutionnel
par Floran Vadillo
Le sujet de cette belle disputatio semble d’une technicité qui en rebutera plus d’un. Pourtant, il convoque ce qui fonde notre démocratie, la vertu et la capacité du pouvoir politique, mais également ce qui justifie une désaffection populaire à l’égard de ses représentants.
En effet, au-delà d’une controverse doctrinale autour des théories kelsennienne et schmittienne, des différents ordres de légitimité, du constitutionnalisme juridique ou politique, de la conciliation entre démocratie et libéralisme, d’une nouvelle séparation des pouvoirs ou de la judiciarisation des droits fondamentaux, la controverse vise à définir ce qu’est le politique et ce qu’il s’autorise à accomplir.
Or les responsables politiques, gagnés tant par une technicisation de leurs tâches que par une forme de résignation, ont eu tendance à adopter un discours de l’impossibilité de faire en raison de forces supérieures : l’économie, l’Union européenne, la CEDH, le Conseil constitutionnel, quand ils ne pensent pas au peuple lui-même. Le raisonnable a enflé jusqu’à devenir le défaitisme et laisser aux extrêmes le soin de porter des discours virilistes parcourus par les promesses de renversement d’un système d’incapables et d’incapacités. Le responsable politique a déserté ses responsabilités tandis que le politique désertait le débat public.
Mais face aux folles promesses des populistes, un volontarisme rationnel (raisonnable ?) doit s’imposer. L’alternative ne se situe pas entre le mensonge et la technique car, si complexes que soient les implications de grands choix, il incombe aux représentants de la Nation de donner à comprendre ce qui se joue dans ces choix. L’ordonnancement du monde, loin d’un plaisir de bureaucrate saint-simoniste, suppose de commencer par des idées accessibles à tous.
Dans cette optique, la prépondérance, voire la suprématie, du contrôle de constitutionnalité participe à la complexification du monde et à l’image de responsables politiques démonétisés. Le recours au juge contre le politique, les censures prononcées pour des motifs exégétiques complexes, mais aussi l’intériorisation par le législateur d’une supposée impossibilité de faire ont contribué à effriter la force d’imposition de la loi, à laisser planer un doute permanent sur elle. Jean-Eric Schoetl et Bertrand Mathieu analysent avec vigueur les conséquences populistes de cette évolution.
Néanmoins, on ne saurait nier que le rôle exercé par le Conseil constitutionnel depuis 1971 a également contribué à l’affermissement des droits et libertés fondamentaux et, surtout, à leur prise en compte par le législateur (notamment le législateur exécutif qui se réfugiait à l’envi derrière le principe de raison d’Etat). En quelques décennies, notre démocratie a progressé avec une détermination non moins grande qu’aux débuts de la République, et le Conseil constitutionnel y a concouru.
Mais après les charges héroïques sur une terra incognita, les sages de la rue de Montpensier ont parfois poussé leur avantage trop loin. La construction jurisprudentielle a tutoyé le juridisme virulent. Au point d’ériger le pouvoir des juges en contrepoids de la volonté générale dans une méfiance du peuple et de ses représentants, écueil d’une orthodoxie kelsennienne. En effet, à la Constitution de 1958 est venu s’adjoindre un bloc de constitutionnalité au service d’une jurisprudence foisonnante. Pourtant, le peuple constituant ne s’est jamais prononcé sur l’étendue de ce bloc de constitutionnalité, sur sa portée qui vient parfois limiter l’adaptation de notre droit. Il est donc des normes qui peuvent s’imposer sans son consentement ; des normes qui viennent faire mentir le noble article 28 de la Constitution du 24 juin 1793 (qui, elle ne figure pas au bloc de constitutionnalité) : « Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures ».
En réaction, une hostilité a cru, qui fonde souvent les espoirs d’un coup de force du politique contre le gouvernement des juges, discours factieux qui avilit la démocratie dans l’ochlocratie. Or, comme évoqué précédemment, la voie d’un volontarisme rationnel est possible.
Pour ce faire, l’idée a germé de remettre en balance la légitimité du Conseil constitutionnel quand elle contraint celle du législateur. A ce titre, Jean-Eric Schoetl plaide pour une clause de dernier mot adoptée à la majorité qualifiée à l’Assemblée nationale et au Sénat ; Benoît Schmaltz envisage une loi de validation constitutionnelle tandis que Bertrand Mathieu défend un plus ample recours au référendum.
Chaque solution comporte ses naturelles limites, ses risques et ses excès. Benoît Schmaltz signale avec raison le risque d’abaisser le pouvoir constituant au niveau du législateur si l’on s’affranchit du critère de quorum pour les révisions constitutionnelles. Il souligne, en outre, le risque politique encouru qui dissuade les Nations dotées d’une clause de dernier mot de l’activer.
Une voie médiane mérite donc examen. Il paraîtrait en effet raisonnable qu’en dehors des décisions découlant d’une application directe de la Constitution, les décisions promouvant une interprétation jurisprudentielle de la norme fondamentale et, surtout, celles recourant à d’autres corpus juridiques puissent faire l’objet d’un débat politique. Il s’agit non de couper les ailes au Conseil constitutionnel, mais de repolitiser le débat constitutionnel. En effet, au regard de ses impacts sur l’organisation de la vie de la Nation, il semble légitime que cette dernière puisse s’en saisir.
Ainsi, l’idée promue par Benoît Schmalz paraît-elle intéressante même si des inflexions pourraient y être apportées : à la suite d’une décision du Conseil (DC ou QPC) venant invalider un texte de loi, l’Assemblée nationale et le Sénat pourraient s’opposer à une interprétation jurisprudentielle en adoptant à la majorité simple, chacun dans les mêmes termes, une bulle interprétative de la Constitution. Celle-ci serait transmise au Conseil constitutionnel qui, en cas de désaccord à l’unanimité de ses membres pourrait, lorsqu’il l’estime nécessaire au regard des conséquences emportées par le sujet, solliciter du Président de la République l’organisation d’un référendum.
Le chef de l’Etat serait alors tenu de convoquer un référendum dans les trois mois qui suivent soit pour modifier la Constitution, soit pour trancher la controverse juridique. Dans ce dernier cas, la question posée devrait alors rappeler le point de droit débattu mais surtout exposer clairement ses conséquences concrètes. Le peuple viendrait trancher la controverse et choisir la jurisprudence applicable car, comme le souligne Bertrand Mathieu : « l’interprétation est parfois difficile à distinguer de la révision. »
Naturellement, les démocrates aristocratiques estimeront le peuple incompétent pour intervenir sur ces sujets. Aiment-ils seulement la démocratie pour se défier de celui qui la fonde ? La solution proposée présente de nombreux avantages :
- Elle réhabilite la pratique référendaire sans l’instaurer en absolu systématisme ;
- Elle confère une nouvelle prérogative au Parlement qui, s’il ne dispose plus de l’initiative législative, trouverait un nouveau rôle dans cette Cinquième République qui l’a corseté. La réflexion sur son rôle dans le contrôle de constitutionnalité a d’ailleurs été promue dans une précédente publication qui complète le présent propos [27] Cf. Floran Vadillo, « Absence des parlementaires dans le contrôle de constitutionnalité : une anomalie démocratique », Tribune n°25, L’Hétairie, 21 janvier 2019. ;
- Dans cette perspective, elle oblige Parlement et Conseil constitutionnel à établir des relations de travail, à œuvrer à une conciliation pour éviter les conflits inutiles (on pourrait même imaginer d’institutionnaliser ce dispositif de conciliation dans le processus évoqué plus haut) ;
- Elle amplifie la prise en compte des droits et libertés fondamentaux dans le processus législatif pour invalider le juste constat posé par Benoît Schmaltz : « alors que nous avons judiciarisé la protection des libertés par l’attribution de droits subjectifs à faire valoir devant des juges, les Britanniques ont plutôt choisi d’évaluer, en amont, l’impact d’une législation sur les libertés et de tendre autant que possible vers leur meilleure protection ». Dans ce cadre, on pourrait même imaginer la saisine pour avis du Conseil constitutionnel par le Parlement ;
- Elle place le Conseil constitutionnel au cœur du processus démocratique tout en l’exemptant de la charge critique qui trop souvent s’abat sur lui ;
- Enfin, elle invalide tout discours d’impossibilité de faire et place les responsables politiques en position de décider sans se défausser. Ce faisant, elle sape le discours des extrêmes.
En définitive, l’évolution proposée répond à une demande ardente, plus que jamais nécessaire : politiser l’Olympe du droit et, de manière toute prométhéenne, y faire pénétrer les citoyens.
Notes
| ↑1 | Conseil constitutionnel, Conseil d’Etat et Cour de Cassation. |
| ↑2 | CEDH et CJUE. |
| ↑3 | Cour constitutionnelle allemande. |
| ↑4 | Amendement de Guillaume Larrivé et Éric Ciotti, 5 juillet 2018 : « Art. 33-1 : Une disposition législative déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel ou jugée contraire à un traité par une juridiction française ou européenne statuant en dernier recours est maintenue en vigueur si, dans les six mois suivant cette décision ou ce jugement, elle est confirmée par une loi adoptée dans les mêmes termes par la majorité des députés et la majorité des sénateurs. La loi de confirmation précise selon quelles modalités la disposition en cause demeure en vigueur ou reprend vigueur. Elle ne peut faire l’objet d’aucun des recours prévus aux articles 61 et 61-1. » |
| ↑5 | « L’État est menacé d’impuissance dans l’exercice de ses fonctions régaliennes », Le Figaro, 17 mai 2018, ainsi que la précédente contribution. |
| ↑6 | Même si, chaque fois qu’un droit garanti par la Constitution l’est aussi en droit de l’Union européenne et en droit de la CEDH, la question peut se poser à nouveau à ce niveau de juridiction. Il faudrait cependant se livrer à une étude spécifique sur la mesure dans laquelle les contrôles des juridictions européennes entravent réellement les principales options politiques des Gouvernements. |
| ↑7 | Introduit par la loi n°2016-731 du 3 juin 2016, la disposition fut censurée, sans surprise pour les spécialistes tant l’inconstitutionnalité de la mesure est manifeste, par une première décision du 10 février 2017 (2016-611 QPC). Le législateur, persistant, dans le cadre de la loi n°2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, a entendu réécrire l’article afin de maintenir l’incrimination censurée quelques jours plus tôt. Il a provoqué une nouvelle censure avec la décision du 15 décembre 2017 (2017-682 QPC). On relèvera qu’Éric Ciotti avait alors proposé de modifier la Constitution en vue de permettre cette incrimination. |
| ↑8 | C.C. 62-20 DC du 6 novembre 1962, et CE, 30 oct. 1998, Sarran, Levacher et autres. |
| ↑9 | On renverra sur ce point à la récente note publiée par l’Hétairie : M. TROPER et J.-Ph. DEROSIER, « Quelle voie pour la réforme constitutionnelle ? Echanges autour du référendum constitutionnel direct », 12 décembre 2017. |
| ↑10 | Georges VEDEL, « Schengen et Maastricht, À propos de la décision n° 91-294 DC du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1991 », RFDA, mars-avril, 1992, p. 173. |
| ↑11 | Discours prononcé par Edouard Balladur, le 19 novembre 1993, devant le Congrès. |
| ↑12 | Il s’agissait seulement de déterminer si sa mise en œuvre doit relever des autorités françaises, ou s’il peut être envisagé de le voir mis en œuvre par des autorités italiennes, grecques ou de tout autre Etat partie aux accords Schengen ou Dublin. Il faut souligner que le Gouvernement avait négocié dans le cadre de l’accord, et a fait inscrire à la Constitution, le fait que « même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », conformément à l’alinéa 4 du Préambule de 1946. |
| ↑13 | Après la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018 qui a considéré qu’une aide « désintéressée » au « séjour irrégulier » de migrants ne saurait être passible de poursuites, le député des Alpes-Maritimes a dénoncé « cette décision politique » qui « affaiblit encore un peu plus l’autorité nécessaire de l’Etat et renforce le pouvoir d’associations pseudo-humanitaires qui profitent de leur exposition médiatique pour faire pression sur l’Etat ». Dans le même esprit, il faut signaler la tribune d’Anne–Marie LE POURHIET parue dans Le Figaro du 11 juillet 2018. |
| ↑14 | « En permettant aux représentants politiques et à divers comités d’engager avant l’adoption de la loi un débat public autour de la garantie des droits, ces mécanismes assurent un contrôle au sein des organes politiques avant même l’adoption de la loi et l’intervention des Cours », note sur ce point Manon ALTEWEGG-BOUSSAC, « Le concours des organes politique et juridictionnel à la garantie des droits. Regard sur une modélisation alternative de la justice constitutionnelle », Jus Politicum, n° 13. |
| ↑15 | Le blocage atteint cependant son paroxysme lorsque le juge constitutionnel contrôle de telles révisions constitutionnelles. C’est ce que prévoit la Constitution en Allemagne, en Italie ou bien encore en République Tchèque. Il est même arrivé qu’une Cour suprême se donne elle-même compétence pour contrôler les révisions. Ainsi, la Cour suprême indienne a développé une doctrine de la structure fondamentale (basic structure) de la constitution conduisant à contrôler les révisions constitutionnelles. Elle a notamment annulé l’amendement (le 42ème) qui entendait lui imposer de renoncer à un tel contrôle, ce qui souligne le pouvoir que s’est arrogé cette Cour en matière de dernier mot face aux autorités politiques. Sans pour autant que le système juridique indien ne soit véritablement enviable en termes de garanties des droits et libertés pour les individus… |
| ↑16 | Décision du Défenseur des droits du 13 novembre 2012, n° MDS 2011-113. |
| ↑17 | CE, 31 juillet 2017, n°412125, 412171. |
| ↑18 | Mireille Delmas-Marty : « Le projet de loi antiterroriste, un mur de papier face au terrorisme », Philosophie Magazine du 31 juillet 2017. |
| ↑19 | 32 attentats déjoués dont 13 en 2017 selon Gérard Collomb, mais sans préciser quel type d’attentat. |
| ↑20 | Ce qui recouvre beaucoup des propositions de Monsieur Ciotti… à commencer par l’internement administratif des fichés S. |
| ↑21 | En référence aux lois de validation qui permettent déjà de « sauver » un acte administratif de la censure du juge administratif. |
| ↑22 | Sorte d’étude d’impact constitutionnelle, à l’image de ce qui se pratique au Royaume-Uni. |
| ↑23 | Cf. la contribution dans le présent ouvrage. |
| ↑24 | Bertrand MATHIEU, Le droit contre la démocratie, Paris, LGDJ, 2017, 304p. |
| ↑25 | Yascha MOUNK, Le peuple contre la démocratie, Paris, Editions de l’Observatoire, 2018, 528p. |
| ↑26 | Décision n° 85-197 DC du 23 août 1985. |
| ↑27 | Cf. Floran Vadillo, « Absence des parlementaires dans le contrôle de constitutionnalité : une anomalie démocratique », Tribune n°25, L’Hétairie, 21 janvier 2019. |